





Une étude réalisée par Les Grignoux et consacrée au thème
Notions et prénotions
![]() L'étude présentée ici propose une réflexion méthodologique sur les notions qui sont couramment utilisées dans le débat public mais que les sciences humaines qualifient généralement de prénotions (parce que non scientifiques). Il n'est cependant pas possible de se passer complètement de ce genre de notions, et l'on suggère donc ici une approche multidiminsionnelle pour clarifier dans la mesure du possible leur utilisation.
L'étude présentée ici propose une réflexion méthodologique sur les notions qui sont couramment utilisées dans le débat public mais que les sciences humaines qualifient généralement de prénotions (parce que non scientifiques). Il n'est cependant pas possible de se passer complètement de ce genre de notions, et l'on suggère donc ici une approche multidiminsionnelle pour clarifier dans la mesure du possible leur utilisation.
Ce document est également disponible ici au format pdf facilement imprimable.
Les théoriciens des sciences sociales ont montré depuis longtemps que les notions couramment employées pour dénommer et penser le monde environnant, en particulier la société, sont relativement confuses, mêlant des significations multiples et désignant des choses mal délimitées. Ils ont dès lors proposé de nommer ces notions des prénotions pour les distinguer des concepts de nature scientifique qui seraient définis de manière claire et univoque.
Cette clarification se heurte cependant à au moins trois obstacles. Le premier est que tous les spécialistes des sciences sociales ne s'accordent pas sur la définition des notions qu'ils utilisent : la notion récente de radicalisation par exemple a fait l'objet de définitions diverses, parfois éloignées les unes des autres [1], mais a été rejetée comme une construction purement politique ou idéologique par d'autres sociologues [2]. La deuxième est que, si certaines des notions communes font l'objet d'une clarification, la plupart des notions utilisées dans les sciences sociales appartiennent encore et toujours au langage et au sens communs : des notions comme la domination, l'inégalité, les classes populaires, le néolibéralisme, le ressentiment, la violence (réelle ou symbolique), le mépris de classe ou autres, sont largement utilisées dans les travaux de sociologie sans faire l'objet de la moindre problématisation [3]. Bien entendu, une telle définition préalable de tous les concepts utilisés en sociologie et plus largement en sciences humaines serait sans doute aussi fastidieux que peu productif, mais cela permet certainement des approximations et, dans certains cas, des affirmations douteuses [4]. Enfin, les notions même clarifiées par les sciences humaines restent des notions sociales, des « prénotions » largement utilisées par les « profanes » sans tenir compte d'éventuelles précisions scientifiques. Et même des notions a priori savantes — anomie, stigmatisation, moyenne statistique, schizophrénie, inconscient, mondialisation, capitalisme financier, capital culturel… — peuvent faire rapidement l'objet d'une vulgarisation approximative et être reprises plus ou moins largement par un large public. Contrairement aux espoirs ou aux illusions des premiers sociologues, il n'est sans doute pas facile ni même possible de se débarrasser de ces « prénotions » ni dans l'univers de sens commun ni même sans doute dans le domaine spécialisé des sciences sociales.
On remarquera que l'effort de clarification qu'exigent généralement les théoriciens de sciences sociales n'est pas propre à ce domaine et accompagne toute démarche de réflexion, qu'elle soit de nature philosophique ou proprement scientifique ou simplement rationnelle. Une telle démarche vise alors très généralement à distinguer les traits supposés essentiels du concept ou de la chose [5], de ceux qui doivent être considérés comme secondaires ou inessentiels. Le chat serait ainsi défini comme un mammifère carnivore mais la couleur de son pelage serait inessentielle puisqu'elle est éminemment variable. De manière plus savante, si l'on suit Max Weber, l'État devrait être défini comme l'instance sociale ayant le monopole de la violence légitime.
Un tel processus de clarification conceptuelle est sans doute intéressant pour mettre en évidence des traits essentiels ou importants des réalités envisagées, mais apparaîtra aux yeux de la majorité des individus comme très pauvre sinon même insuffisant car négligeant des caractéristiques très présentes même si elles sont jugées « inessentielles » [6]. Ainsi, peu de nos contemporains peuvent rester insensibles au fait que les États modernes sont des « États de droit » dont l'activité législative et réglementaire est particulièrement importante : le code de la route est une invention moderne sinon contemporaine mais il nous serait bien difficile d'en faire abstraction dans la vie quotidienne même si nous sommes seulement piétons ! Quant aux impôts et autres taxes, nous les payons tous les jours sans que, pour cela, la menace d'une sanction policière soit réellement nécessaire… L'État ne se réduit évidemment pas au monopole de la violence légitime et, dans ses multiples variantes, présente d'autres caractéristiques (même si elles ne sont pas « essentielles ») dont on ne peut faire abstraction.
Nous proposerons donc ici une réflexion critique sur ce qu'on désigne comme des « prénotions », réflexion qui renoncera à définir abstraitement leur essence supposée et qui s'attachera plutôt à en décrire les différentes dimensions. Cette approche n'a pas de prétention universelle et s'inscrit plutôt dans une perspective historique et sociologique : il s'agit en particulier de tenir compte du fait que les « choses » mais également les « mots », qui nous permettent de les penser, varient — parfois grandement — selon les époques et les sociétés. On retrouve des approches similaires dans de nombreux travaux d'histoire et de sciences sociales mais elles ne portent généralement que sur l'une ou l'autre notion [7] sans que la démarche réflexive ne soit réellement explicitée. Dans une perspective d'éducation permanente, l'on suggère ici de décomposer les « prénotions » en différentes dimensions qui sont plus ou moins activées selon les contextes d'emploi. Une telle analyse s'inspire de la sémantique qui distingue dans chaque sémème (le sens des « mots ») plusieurs « sèmes » qui seront différemment actualisés selon les contextes : dans une phrase comme « Le port était tranquille », le sème /actif/ est actualisé (« un port est un lieu d'activité ») par la présence de l'adjectif « tranquille » (la tranquillité suppose que son contraire, l'activité, est possible) alors que ce même sème est absent (non actualisé) du même mot dans la phrase « Le cargo entra dans le port ».
Cette analyse sémantique en sèmes reste néanmoins cantonnée au domaine de la langue indépendamment du contexte socioculturel plus large où ces mots sont employés [8]. La démarche proposée ici, largement empirique, s'intéresse à des notions couramment utilisées dans le débat public où elles sont peu interrogées en tant que telles mais qui méritent certainement une réflexion critique même si celle-ci n'a pas la technicité d'une véritable étude sémantique ou philosophique. Pour distinguer ce qu'on appelle les différentes dimensions des prénotions, une telle réflexion pourra s'appuyer en particulier sur les différentes oppositions que chacune de ces prénotions met en jeu. Comme la démarche structuraliste l'a souligné, le sens se construit en effet comme un système de différences, même si un des termes de l'opposition reste souvent implicite. Ainsi, la civilisation est évidemment le contraire de la non-civilisation mais s'oppose surtout à la sauvagerie : c'est ainsi que la « civilisation » a longtemps été une des justifications de la colonisation imposée à des populations réputées « sauvages » (sauvagerie dont le cannibalisme était présentée comme la forme extrême). Dans un sens légèrement différent, la civilisation est associée au raffinement, à la douceur des mœurs, et se distingue de la rudesse et de la brutalité des couches inférieures de la population : ainsi, quand Eugène Sue évoque dans les Mystères de Paris les bas-fonds de la capitale, il compare ses habitants au sauvages indiens (on dirait aujourd'hui Amérindiens) décrits par James Fenimore Cooper dans ses romans. Un nouveau déplacement fait de la civilisation quelque choses de complexe, d'élaboré, d'historiquement construit, par opposition à des sociétés réputées simples et « sans histoire » : on parlera facilement de la civilisation chinoise, égyptienne, aztèque ou maya mais plus difficilement de la civilisation papoue ou jivaro [9]. L'image de grandes constructions — temples, pyramides ou gratte-ciels — s'impose presque naturellement à notre esprit lorsqu'on évoque de telles civilisations, et l'on parlera facilement de « grandes » civilisations alors que le contraire — une « petite civilisation » — semble absurde. La civilisation est une création collective, à la fois matérielle et culturelle, qui procède pour une part plus ou moins importante d'une histoire accumulée. La civilisation de la Renaissance par exemple n'est pas le fait d'un seul individu, mais résulte des créations de multiples artistes travaillant dans une continuité culturelle mais aussi matérielle. Enfin, aujourd'hui, sous l'influence des recherches en ethnologie, la notion de civilisation a pris une extension nouvelle au point d'englober pratiquement toutes les sociétés humaines, et l'on parlera sans problème des Civilisations des Indiens d'Amérique du Nord [10]. La frontière passera alors entre les humains et les animaux, et si l'on évoque couramment l'existence de certaines sociétés animales, aucune civilisation animale n'a encore été citée. Dans cette perspective, la civilisation n'est qu'une part de la société englobante : la notion désigne alors des traits suffisamment saillants pour constituer le caractère propre d'une société et la distinguer de toutes les autres.
Ces différents significations — on pourrait parler plus largement de constellations sémantiques — ne s'annulent pas les unes les autres, même si certaines sont plus présentes à certaines époques et si d'autres ne sont apparues que récemment. Il y a une sédimentation historique qui, selon les contextes, va activer l'une ou l'autre de ces « constellations ». Ainsi, l'opposition entre civilisation et sauvagerie peut sembler très ancienne (relevant d'une mentalité dite coloniale), et nous nous rappellerons par exemple que les Grecs antiques désignaient comme barbares — un terme que nous utilisons encore aujourd'hui — les peuples qui étaient étrangers à la civilisation hellénique. Mais une série télévisuelle actuelle très populaire comme Game of Thrones va également réactiver cette opposition, cette fois entre le « Royaume des sept couronnes » clairement inspiré de l'Occident médiéval et dont la « civilisation » (le terme est effectivement employé par un des personnages dans la première saison) est menacée par la horde sauvage des Dothrakis aux coutumes sanguinaires (on y mange le cœur saignant d'un cheval), vivant de rapines et dévastant les contrées qu'ils traversent, ainsi que par les « sauvages » du Nord qui nous rappellent les invasions barbares qui ont provoqué la chute de l'Empire romain.
Ce dernier exemple montre ainsi que des prénotions comme civilisation ne sont évidemment pas un simple reflet de la réalité, et que, si elles nous permettent de « penser » la réalité (ou du moins de la catégoriser), elles sont construites à travers toutes sortes de discours prétendant à la vérité (philosophie, politique, journalisme, sens commun…) mais également par les fictions, les mythes, les contes, les romans… En outre, de la même manière que lorsque nous parlons de façon générale des « oiseaux », nous privilégions plutôt l'image mentale d'un moineau ou d'une hirondelle que celle d'une autruche ou d'un pingouin [11], nous « pensons » des notions abstraites comme « civilisation » à travers des exemples privilégiés comme la « civilisation romaine ». Si, en toute logique, notre réflexion devrait tenir compte de la diversité des éléments subsumés sous le même concept, nous nous appuyons en réalité sur un seul de ces éléments, jugé « typique » ou représentatif de l'ensemble de la classe, ce qui est sinon faux du moins réducteur.
Tout ceci explique que les débats d'idées soient souvent confus, d'abord parce que, sous les mêmes mots, on met des choses ou plus exactement des notions différentes, ensuite parce que ces notions elles-mêmes peuvent renvoyer à des exemples (perçus comme « typiques ») différents. La démarche d'analyse des prénotions proposée ici consiste à déployer les différents nuances de sens qui se sont sédimentées au cours du temps mais également à travers l'espace social. Comme on l'a indiqué, c'est notamment par le jeu des oppositions qu'il est possible d'expliciter les différentes dimensions qui constituent ces prénotions. L'objectif d'une telle analyse est pourrait-on dire « anti-polémique » : il s'agit d'abord de comprendre ce que ces notions recouvrent pour mieux comprendre l'usage très souvent polémique qui est fait de ces notions.
L'approche pourrait être considérée comme banalement encyclopédique puisqu'il ne s'agit somme toute que de relever les différentes acceptions d'un même mot. Mais les rédacteurs d'encyclopédies plus ou moins savantes n'explicitent pas ou peu leur démarche, donnant seulement le résultat de leur travail de recherche. En outre, les encyclopédies privilégient naturellement le consensus, ce qui fait le « sens commun », plutôt que le dissensus qui nous intéresse plus particulièrement ici dans la mesure où la polémique est au cœur de la vie sociale. La démarche proposée reste néanmoins largement empirique et se fera à travers l'analyse de deux prénotions, l'une qui semble peu controversée, à savoir le sport, l'autre qui est sans doute au cœur des débats d'idées actuels : la nature (avec ou sans majuscule). La première sera analysée principalement en extension, c'est-à-dire que l'on essaiera de déterminer quelles sont les différentes réalités que recouvre cette notion, et la seconde en intension, c'est-à-dire en explicitant les différentes composantes du sens qui lui est attribué ou de ses différentes significations puisqu'il y a là dissensus.
Le sport se présente d'abord comme une activité corporelle, comme un exercice physique. On remarquera cependant immédiatement que cette dimension physique peut être plus ou moins importante et l'effort plus ou moins intense : comparons à ce propos les gestes d'un nageur, d'un golfeur, d'un cavalier ou d'un pilote automobile.
Dans la définition d'un sport, il faut donc tenir compte d'une dimension physique qui est primordiale mais différemment accentuée selon les disciplines. On représentera cet état de fait sous la forme suivante :
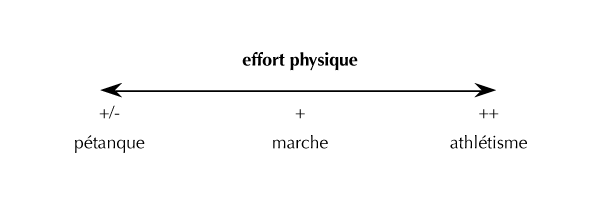
On peut donc distinguer les différents sports selon l'importance qu'ils accordent à la dimension physique et corporelle : si celle-ci est minime, le statut du sport en question pourra être contesté (comme dans le cas de la pétanque, de la chasse ou de la pêche).
À cette première dimension est généralement associée l'idée d'une amélioration de l'état physique (et parfois psychologique) du pratiquant sportif : faire du sport, c'est bon pour la santé, dit-on couramment. Cette idée largement répandue mérite néanmoins d'être nuancée : ce n'est pas le sport qui est bon pour la santé mais bien l'activité physique pratiquée régulièrement avec intensité mais sans excès. Or le sport notamment de compétition peut provoquer, à cause de l'importance ou de la durée des efforts, blessures et accidents, par exemple cardiaques, musculaires ou tendineux.
En outre, certains sports, du fait de leurs caractéristiques propres, comportent des risques : les chutes de ski peuvent provoquer des blessures graves, les accidents de parachute ou d'autos sont parfois mortels, les sports de contact comme le rugby, le football ou la boxe entraînent fréquemment des traumatismes plus ou moins importants et durables.
L'amélioration de la condition physique est donc à nuancer selon la discipline et selon la manière de pratiquer cette discipline (comme simple entraînement ou comme compétition) :
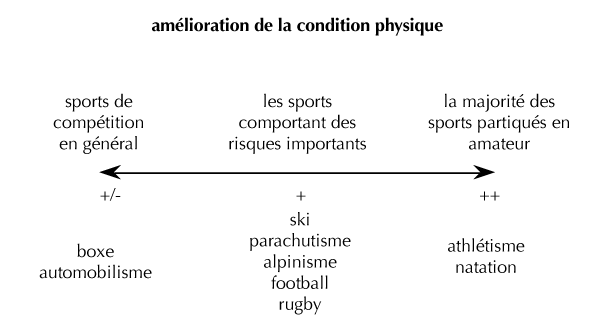
Il faut insister à ce propos sur le fait que, si l'amélioration de la condition physique accompagne généralement la pratique d'un sport, elle n'en constitue souvent pas le but mais simplement un moyen pour une autre finalité : c'est le cas en particulier de toutes les compétitions (d'amateurs ou de professionnels) dont le but premier est, pour les sportifs, la victoire (ce qui explique un phénomène comme le dopage) et, pour les spectateurs, les qualités du spectacle (comme l'incertitude et le suspense).
Parmi les buts de l'activité sportive, il en est un qui est sans doute plus important, notamment pour les jeunes et les amateurs, que l'amélioration de la condition physique : c'est l'aspect de jeu, c'est la dimension ludique qui nous fait taper dans un ballon pour le simple plaisir de l'exercice avec des copains…
À l'origine de toute pratique sportive, l'on trouve certainement ce plaisir du jeu, mais il faut aussi voir que cette dimension est souvent estompée lorsqu'apparaissent d'autres enjeux comme ceux inspirés de la compétition notamment professionnelle. Les pratiques sportives vont donc se distribuer de façon différenciée selon l'importance qu'elles accordent à la dimension ludique :
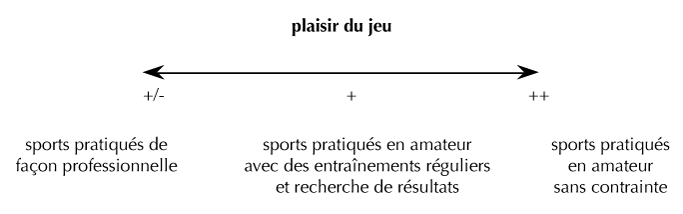
Avec la compétition, l'on aborde une autre dimension du sport, particulièrement importante. Il est rare en effet que nous pratiquions un sport de façon solitaire : le sport est généralement une activité collective qui se double souvent d'une compétition entre individus ou entre équipes. Même si l'on considère une activité aussi peu organisée que le jogging, l'on peut constater qu'elle conduit régulièrement à de grandes compétitions où l'on se bat contre les autres ou contre soi-même en cherchant à se surpasser. L'idée d'un temps à battre, d'un exploit à réaliser, d'une autre équipe ou d'un autre individu à vaincre anime quasiment toutes les activités sportives, même les plus solitaires apparemment comme l'alpinisme où il s'agit souvent d'escalader une montagne jusque-là inaccessible ou un versant impratiqué.
La dimension de compétition plus ou moins accentuée va donc permettre à son tour d'ordonner la diversité des activités sportives :
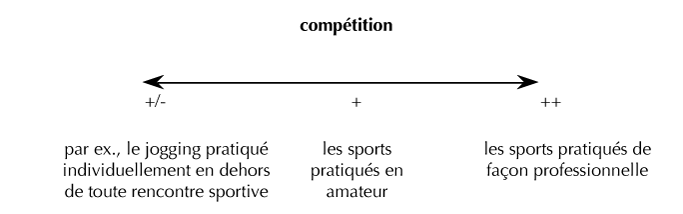
L'aspect de compétition des rencontres sportives a un corollaire immédiat, celui de la codification nécessaire des différents sports. Pour s'affronter, il faut que tous les participants soient d'accord sur les règles du jeu. Ces règles ne sont d'ailleurs pas le plus souvent laissées à l'appréciation des sportifs mais édictées par des institutions comme les fédérations sportives ou les comités olympiques. Ces fédérations, qui, pour les grandes disciplines sportives, datent de la fin du 19e siècle et du début 20e, ont pour la plupart un statut international, ce qui garantit la validité universelle des normes et des règlements qu'elles édictent.
On remarquera à ce propos que la définition des disciplines sportives n'est pas éternelle et remonte généralement au 19e siècle : nombre de disciplines en particulier ont disparu comme le, saut en hauteur ou en longueur sans élan, le lancement du disque ou du javelot à deux mains ou des courses définies par leur durée (1/2 heure, 1 heure, etc.), tandis que de nouvelles apparaissaient comme la planche à voile, la gymnastique rythmique ou la natation synchronisée.
On notera, à propos de la codification et de l'institutionnalisation des disciplines sportives, le rôle essentiel joué par les clubs qui, à l'échelon local, assurent l'encadrement nécessaire à la pratique sportive : ce sont eux qui, fournissant matériels et lieux sportifs, obligent également les pratiquants à respecter les règlements en vigueur.
Les différents sports peuvent donc être définis selon leur codification plus ou moins stricte et l'importance des institutions qui les encadrent :
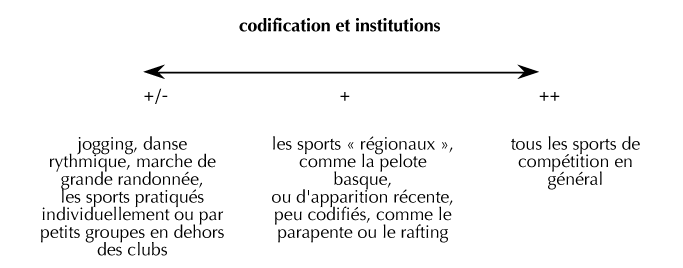
La dernière dimension que l'on envisagera pour la définition du sport est celle de spectacle. L'extraordinaire développement du sport au 20e siècle et notamment du sport professionnel ne s'explique que par cet aspect spectaculaire : on ne gravit pas les montagnes pour soi mais pour que cela soit montré à la télévision au journal de vingt heures qui paiera d'ailleurs les frais de l'expédition, et, à l'inverse, il n'y a autant de compétitions et de rencontres sportives de toutes sortes que parce qu'il y a des spectateurs qui veulent assister à ces exploits et voir battre des records ou des adversaires, et qui paient directement ou indirectement (par exemple par les redevances de télévision) pour que ces compétitions aient lieu.
Le sport est un spectacle, et le spectacle commande le sport. Les règlements édictés par les fédérations ont ainsi pour but essentiel de maintenir l'incertitude du résultat et donc le suspense pour le spectateur : les catégories de poids dans les sports de combat (boxe, lutte, judo… ) équilibrent ainsi les rencontres de la même façon qu'en sport automobile, de nouvelles normes sont introduites chaque fois qu'une innovation technique donne un avantage trop évident à certains concurrents (par exemple le turbocompresseur en formule 1, interdit à la fin des années 1980). Parfois, le spectacle impose même des modifications de règlement : ainsi, alors qu'un match d'un tennis pouvait théoriquement durer indéfiniment (si aucun des deux adversaires ne parvenait à affirmer durablement sa domination), on a introduit l'usage du «tie-break» pour limiter ces rencontres qui n'en finissaient pas et qui ne «rentraient» pas dans les horaires fixes des programmes de télévision.
L'aspect plus ou moins spectaculaire des différentes pratiques sportives nous permettra donc de les ordonner selon cette sixième dimension :
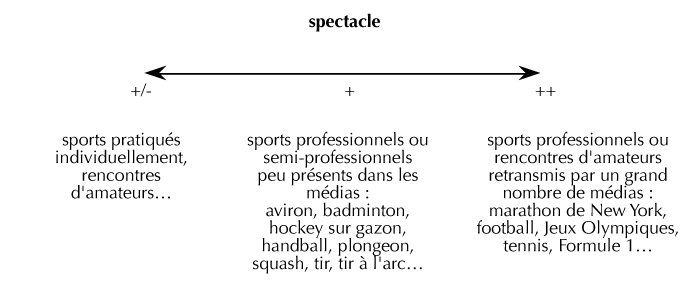
On insistera ici sur cet aspect spectaculaire qui est presque toujours présent dans les activités sportives mais dont l'influence est rarement perçue par les pratiquants eux-mêmes.
La nature est une notion centrale dans les débats et dans la pensée en Occident où l'opposition en particulier entre la nature et la culture s'impose comme une évidence qui n'est que difficilement mise en question [12]. Mais, avant d'aborder les définitions plus ou moins savantes de la nature (qui a fait l'objet d'une longue élaboration philosophique), l'on s'attardera brièvement sur les conceptions les plus ordinaires qu'on peut en avoir.
Ainsi, une première opposition qu'on peut facilement relever est celle de la ville et de la campagne identifiée alors à la « nature » ou la vie « naturelle » : pour nos contemporains, « être proche de la nature » signifie en fait s'éloigner de la vie citadine. C'est déjà cette opposition qu'illustrent l'œuvre de Jean-Jacques Rousseau et en particulier les Rêveries d'un promeneur solitaire. Ainsi, lorsqu'il découvre « les charmes de la nature » au bord du lac de Bienne, il sait bien que l'île où il trouve refuge est cultivée et même construite d'une seule maison, mais c'est l'éloignement, la distance de la vie citadine, perçue négativement comme un lieu de « corruption » morale, qui permet au promeneur d'y trouver un « un bonheur suffisant, parfait et plein, qui ne laisse dans l'âme aucun vide qu'elle sente le besoin de remplir ». Cette opposition soutenue par un fort jugement de valeur (la campagne étant jugée bonne et la ville mauvaise) peut paraître évidente et banale [13], mais elle explique aussi bien le fait que nos contemporains aillent se promener les dimanches « à la campagne » [14] ou dans la « nature » (c'est-à-dire le plus souvent en forêt), que leur prédilection pour les constructions dites « quatre façades » qui morcellent certains territoires périurbains (en particulier en Belgique).
Une telle conception peut paraître singulièrement affadie — elle repose d'ailleurs sur l'idée d'un continuum, d'un éloignement plus ou moins grand de la « ville » —, et d'aucuns évoqueront a contrario des « espaces naturels », c'est-à-dire sans présence humaine, même si les géographes affirment qu'en Europe occidentale, pratiquement tous les espaces notamment forestiers ont été façonnés par les hommes [15], même quand ils les « protègent ». L'opposition se durcit, et l'on privilégiera désormais l'idée d'une nature « sauvage », inexplorée, hostile à la présence humaine. Ce sont les espaces livrés aux « aventuriers » seuls capables d'affronter les périls d'un tel environnement [16]. Senancour avec son roman Oberman (1804) illustre déjà cette fascination pour des espaces « inviolés » comme celui des Hautes Alpes et du Mont Blanc. C'est toute une tradition littéraire qui se met en place avec les « explorateurs » de contrées sauvages ou les trappeurs du Grand Nord chez Jack London [17]. Bien qu'elle ne « fonctionne » pas seule (étant associée à d'autres idées comme l'aventure, le dépassement de soi, l'épreuve, etc.), la notion d'une nature sauvage explique pour une part le succès contemporain des explorateurs de toutes sortes, des navigateurs solitaires et des nombreux alpinistes qui se lancent à l'assaut d'un toit du monde bientôt couvert de tonnes de déchets. Mais de façon plus générale, des expressions courantes comme « se sentir proche de la nature », « être en phase avec la nature », « opérer un retour à la nature », « faire du tourisme nature » traduisent l'idée d'une distance plus ou moins grande de la ville, incarnation d'une vie densifiée en société. Et bien entendu, elles valorisent très généralement ce mouvement à la fois géographique et moral vers la nature.
Mais celle-ci n'est pas seulement un lieu, c'est aussi un principe. Elle s'oppose alors à l'artifice, c'est-à-dire à tout ce qui est construit ou fabriqué par les humains, surtout quand le processus apparaît comme long, complexe et invisible. On parlera aussi bien d'une coiffure naturelle que d'un produit naturel (sans additifs), d'un procédé naturel, d'un remède naturel, d'une médecine naturelle, d'un matériau naturel (le bois, la paille, la terre utilisée dans la construction)… Un téléphone, une auto, un building seront en revanche considérés comme artificiels. La nature se loge alors au cœur même des activités humaines. Ici, il faut remarquer que l'opposition conceptuelle recouvre des réalités qui sont nettement moins tranchées. Le béton est jugé artificiel parce qu'il résulte sans doute d'un processus de transformation chimique [18], mais la brique cuite nécessite également une transformation artificielle. La cuisson est d'ailleurs devenue un sujet de polémique, certains estimant qu'il s'agit d'un processus artificiel (même s'il est très ancien…) et recommandant dès lors de consommer des aliments crus.
Seule une minorité de personnes partagent sans doute ce point de vue radical [19], mais l'opposition entre le naturel et l'artificiel est néanmoins largement utilisée même si la plupart d'entre nous serions incapables de préciser les critères exacts de cette distinction. À la réflexion, deux critères plus ou moins implicites semblent être utilisés : le premier est l'opposition entre les processus physiques (mélange, broyage, perçage, assemblage…) et les processus chimiques (qui ne sont pas réversibles et modifient la composition des substances mises en présence et donnant lieu à de nouveaux composés) ; le second distingue les procédés qui n'ont pas besoin de force motrice (sinon humaine ou animale) et ceux qui recourent de façon importante à des moteurs électriques ou à combustion. Mais ces critères restent très approximatifs puisque le vin et le vinaigre sont considérés comme tout à fait naturels bien qu'ils résultent de processus biochimiques. Et les moulins hydrauliques comme les moulins à vent procurent évidemment une force motrice utilisable de façon mécanique. Pourtant un moulin à vent nous paraîtra sans doute plus naturel qu'une éolienne qui fonctionne sur le même principe…
Si l'opposition de la ville et de la campagne (ou de la « nature sauvage ») est l'objet d'évaluations contrastées (tout le monde ne dénigre pas la vie citadine), celle entre les produits « naturels » et artificiels (ou pire « chimiques ») est sous-tendue par des jugements de valeur très largement partagés : le naturel est réputé « bon » (bon pour la santé, bon pour la planète…), et l'artificiel « mauvais » ou en tout cas « douteux » ou « suspect ». Il ne s'agit évidemment pas ici de mettre en cause de tels jugements de valeur (même si l'on peut estimer que l'opposition est souvent caricaturale), mais de souligner qu'il s'agit là d'une renversement des conceptions dominantes en l'Occident où le « progrès » technique et civilisationnel a longtemps été jugé bénéfique. Si Rousseau avec son fameux Discours sur les sciences et les arts peut apparaître comme l'initiateur d'une telle critique [20], ce sont sans doute des événements récents qui ont le plus fortement contribué à ébranler la foi dans le progrès technique et scientifique, qu'il s'agisse des bombes atomiques larguées sur Hiroshima et Nagasaki, des catastrophes écologiques diverses (accidents nucléaires, pollutions multiples, erreurs médicales, modification profonde des paysages…) ou du réchauffement climatique. Il y a certainement une très grande ambivalence ou ambiguïté dans l'attitude de beaucoup de contemporains (du moins dans les pays occidentaux) qui à la fois dénoncent les « ravages » du progrès et continuent à consommer sans grande modération les produits de ce progrès. Mais il importe seulement ici de souligner l'utilisation rhétorique (sans nuance péjorative [21]) de la notion de nature (« c'est naturel ») perçue comme positive dans son opposition aux processus techniques (au sens le plus large) jugés négativement.
Mais la Nature (qu'on gratifiera ici d'une majuscule) s'inscrit également dans une dimension temporelle significative. Si personne sans doute ne croit plus à un état de nature tel que le décrivait Rousseau en particulier dans son Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité, l'idée persiste largement d'un état antérieur à la société où les humains auraient encore été proches des animaux, en particulier des « grands singes » auxquels ils sont apparentés : comme Darwin nous l'a appris [22], l'homme descend du singe, et il y a dû y avoir un moment où les premiers hominidés étaient encore « animaux » avant de s'en distinguer de façon essentielle, que ce soit grâce au feu, à la bipédie, aux outils, au langage ou à la prohibition de l'inceste… Sous une forme à peine renouvelée, l'on retrouve ici les réflexions sur l'essence supposée de l'homme (le rire, la raison, la conscience de la mort…) sans que l'on parvienne à fixer une limite claire ainsi qu'en témoignent les débats qui accompagnent les découvertes paléontologiques d'australopithèques ou d'autres espèces humaines à la fois proches et lointaines.
Si la distance spatiale entre la nature et la vie urbaine est, comme on l'a dit, sujette à variation, l'écart temporel qui est censé nous séparer de l'état de nature est lui aussi extrêmement flou. L'avant peut être préhistorique, mais il peut être beaucoup plus récent, remontant à moins d'un siècle ou même à un demi-siècle quand l'agriculture n'était pas encore industrielle ni mécanisée ni chimique… Le roman de Jean Giono, Regain (paru en 1930), illustre bien cette nostalgie d'un passé récent, l'époque pré-industrielle supposée proche de la nature, mais détruite par la vie moderne et l'exode rural. Sa nouvelle, L'Homme qui plantait des arbres (1953) [23], met en scène quant à elle un temporalité faussement cyclique en trois grands moments successifs : la forêt passée, la déforestation présente et une nouvelle forêt décrite comme une utopie positive [24]. Cette nouvelle généralement considérée comme un manifeste pré-écologiste conçoit l'histoire récente comme une dégradation plus ou moins importante, plus ou moins rapide, d'un état naturel dont la forêt est l'incarnation : encore une fois, il s'agit d'un renversement de valeurs par rapport aux conceptions anciennes qui voyaient positivement la « domestication » de la nature. On rappellera à ce propos que les forêts européennes largement présentes (même si c'était sous une forme de parcelles discontinues) avant la conquête romaine ont fait l'objet d'une exploitation progressive bien avant l'âge industriel : même si le rythme de la déforestation reste discuté par les historiens [25], elle est déjà bien entamée dès l'Antiquité et s'accentue au Moyen Âge (à partir de l'an mil) dans de nombreux pays comme la France, les Pays-Bas, l'Angleterre, l'Irlande, l'Espagne ou l'Allemagne et se prolonge jusqu'à la fin du 19e siècle [26]. Elle est évidemment liée à l'augmentation de la population qui défriche des nouvelles terres et utilise le bois pour le chauffage et la construction. Mais il s'agit là d'un processus antérieur à la révolution industrielle, dont la société paysanne en pleine expansion est la première cause. Et cette société paysanne considérait très généralement la forêt comme un lieu hostile et dangereux, même si c'était aussi une source de matière première. Aujourd'hui en revanche, la nature est perçue comme « amie », « paisible » et « accueillante » [27], contrairement aux villes perçues comme impersonnelles, froides et souvent violentes.
Le mythe du progrès [28] conçu comme une avancée régulière vers un meilleur-être cède ainsi la place à une vision beaucoup plus pessimiste d'une dégradation de l'environnement naturel, et non plus social comme le craignait la pensée réactionnaire au 19e puis au 20e siècle. C'est la grande différence entre les mouvements écologistes, qui émergent dans les années 1970, et cette pensée réactionnaire consécutive à la Révolution française qui, elle, se focalisait sur l'évolution supposée mauvaise (sinon maléfique) de la société présente [29]. Les écologistes évoquent une « nature » antérieure, supposée de meilleure qualité, et non un état social dépassé. Il y a néanmoins dans ce mode de pensée un jugement de valeur essentiel et constant qui conçoit le passé comme plus « naturel », plus « authentique », plus vrai et au final meilleur [30] : cela se traduit par exemple par la valorisation de produits et de procédés « artisanaux » anciens supposés plus naturels et donc meilleurs que les processus industriels [31].
Il ne s'agit pas ici de mettre en cause ces convictions écologistes mais d'expliciter un schème de pensée qui est aujourd'hui largement partagé au point de sembler évident à beaucoup, mais qui est forcément réducteur. Il ne suffit pas d'étiqueter un produit comme « naturel », « artisanal » ou « de tradition » pour qu'il soit garanti de meilleure qualité. En outre, l'opposition entre le passé et le présent est, comme on l'a déjà souligné, extrêmement floue : si, pour d'aucuns, il s'agit de renoncer à une agriculture industrielle qui détruit ou détruirait la « nature », pour d'autres, c'est la révolution néolithique avec le passage de sociétés de chasseurs-cueilleurs aux sociétés paysannes qui serait la source de tous nos maux (inégalités sociales accentuées, travail intensif, concentration des populations avec des épidémies opportunistes, etc.) [32].
Si la nature relève d'un passé plus ou moins proche, plus ou moins lointain, elle est également perçue comme l'expression d'un ordre, comme une ensemble équilibré sinon harmonieux. C'est l'humanité, la civilisation, le progrès qui seraient alors la source du désordre, et qui signifieraient la fin de l'équilibre et l'entrée dans une histoire devenue linéaire (et non plus cyclique), irréversible et globalement néfaste. On peut certainement pointer là une mésinterprétation de l'écologie scientifique qui met effectivement en évidence les nécessaires équilibres entre les différentes espèces végétales et animales occupant un même espace (notamment en termes de ressources alimentaires), mais qui n'en postule jamais la permanence : l'évolution des espèces décrite et expliquée par Darwin résulte des variations des traits héréditaires au sein des espèces, ce qui par le jeu de la sélection naturelle favorise les mieux adaptées et entraîne à terme la différenciation entre les espèces. L'équilibre n'est qu'un état provisoire, et il suffit de considérer les différents âges de la terre — paléozoïque où apparaissent invertébrés puis poissons, mésozoïque qui sera notamment l'époque des dinosaures, cénozoïque caractérisé par la multiplication des espèces de mammifères — pour apercevoir les transformations profondes de ce qu'on regroupe sous l'appellation générale de la Nature [33]. Et sans se projeter dans un passé lointain, on relèvera les débats qui entourent la notion d'espèces invasives qui sont des espèces exotiques ou étrangères introduites (le plus souvent par l'homme de façon volontaire ou involontaire) dans un milieu, une écosystème, qui n'est pas le leur et dont elles menacent « l'équilibre » : ces phénomènes sont généralement jugés négativement, ces espèces invasives étant souvent accusées de nuire à la biodiversité ou au moins à certaines espèces locales soumises à une concurrence nuisible ; néanmoins certains observateurs estiment que ces phénomènes sont plus complexes et qu'ils se caractérisent à terme par de nouvelles adaptations des espèces locales et donc par de nouveaux équilibres [34]. On ne tranchera évidemment pas ici ce débat qui est évoqué seulement pour souligner la difficulté à définir précisément ce qu'on entend par nature et par « équilibre de la Nature » [35].
La nature a été jusqu'à présent considérée comme un environnement dont l'être humain se serait éloigné, à la fois au niveau spatial et temporel. À cet éloignement, il faut des techniques de plus en plus complexes, de plus en plus savantes, elles aussi éloignées de la vie naturelle.
Apparaît cependant avec la technique une nouvelle opposition entre la nature et les comportements humains qui s'en distingueraient radicalement et que l'on dénomme alors culture (au sens anthropologique du terme), civilisation, mœurs, coutumes, société. Une série de nos comportements — sinon tous — apparaissent dans cette perspective comme éminemment variables (selon les groupes d'appartenance), arbitraires, résultant d'abord et avant tout de l'apprentissage. Dès le 16e siècle, dans le contexte notamment des guerres de religion, Montaigne soulignait déjà la variabilité des croyances en relevant : « Quelle vérité que ces montagnes bornent, qui est mensonge au monde qui se tient au-delà » (une idée reprise par Pascal sous la forme « Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au delà »). Évoquant même le cas des tribus amérindiennes réputées cannibales, il affirme que « chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage ; comme de vrai, il semble que nous n'avons autre mire de la vérité et de la raison que l'exemple et idée des opinions et usages du pays où nous sommes. » [36]. On pourrait presque qualifier cette conception d'ethnologique au sens moderne du texte : au regard des ethnologues en effet, toutes les cultures, aussi étranges puissent-elles paraître à nos yeux d'Occidentaux, sont aussi arbitraires les unes que les autres comme les langues diverses que parlent les groupes humains. Ce relativisme culturel considère qu'il n'y a pas de société ni de civilisation supérieure ou meilleure qu'une autre (même si les membres de chacune de ces sociétés, sous l'effet de l'habitude, a tendance à considérer ses propres mœurs comme « normales » et celles des autres comme étranges ou barbares).
Chez Rousseau cependant apparaît l'idée que certains de nos comportements sont plus proches de la nature que d'autres, ceux-ci étant caractérisés par le raffinement, la délicatesse, l'élégance et l'artifice qui nous en éloignent irrémédiablement : dans son Discours sur sciences et les arts, il affirme ainsi qu'« avant que l'art eût façonné nos manières et appris à nos passions à parler un langage apprêté́, nos mœurs étaient rustiques, mais naturelles ». Cet éloignement de l'état de nature, déjà évoqué, est sous-tendu par un fort jugement de valeur puisque l'écrivain y voit d'abord une corruption essentielle des mœurs marquées désormais par l'uniformité (ce qu'aujourd'hui on nommerait le conformisme), la dissimulation sinon le mensonge et le triomphe des vices cachés « sous ce voile uniforme et perfide de politesse ».
La question de la frontière entre la nature et la culture devient ainsi problématique : soit cette frontière isole toutes les sociétés humaines (perçues comme des créations arbitraires) de la nature, soit elle est au cœur même de ces sociétés, des êtres humains et de leur comportements. La première option est bien illustrée par le slogan « Tout est politique » qui implique que toutes les réalités humaines — comportementales, sociales, culturelles, privées, intimes, alimentaires, ludiques… — sont pour une part importante sinon en totalité des constructions sociales arbitraires et peuvent donc être transformées dans une perspective politique (au sens le plus large). Cette thèse largement partagée [37] est perçue généralement comme progressiste puisqu'elle postule que toutes les réalités sociales — notamment celles qui apparaissent comme injustes — peuvent être modifiées et éventuellement améliorées. À l'inverse, l'idée que certaines réalités humaines seraient fondées en nature est plutôt considérée comme conservatrice sinon réactionnaire comme on a pu le voir avec « la Manif pour tous » opposée au mariage entre personnes du même sexe et dont les représentants affirmaient que la famille est « naturellement » composée d'un père, d'une mère et de leurs enfants.
La problématique ne se résume cependant pas à une opposition politique. Il est en particulier assez rare que l'affirmation du caractère construit socialement et culturellement de toutes les réalités humaines soit maintenue en toutes circonstances. On a vu ainsi des militants gays se réjouir de découvrir des comportements homosexuels chez d'autres espèces animales, comme si cette observation naturaliste pouvait apporter une forme de légitimation ou de normalité (au sens le plus vague) à l'homosexualité humaine : un peu de réflexion suffit à montrer qu'il y a là une confusion entre les faits et le droit (à exercer librement sa sexualité), et que ce droit ne peut évidemment pas être affecté par des observations qui seraient inverses (l'absence de comportements homosexuels chez d'autres espèces animales). On n'a jamais observé d'animaux rouler à vélo ou conduire une auto, ce que nous considérons pourtant comme tout à fait « normal » (et légitime) pour des humains. Le recours à ce genre d'argumentation, aussi faible soit-elle, s'explique néanmoins par le fait que la « nature » est supposée constituer à la fois une norme et un « socle » de réalité non modifiable [38]. Dans une perspective similaire, beaucoup d'éditorialistes de gauche se sont emparés des thèses développées par l'éthologue Fans de Waal sur l'empathie qui serait une disposition naturelle commune à un grand nombre d'espères, en particulier les grands singes qui nous sont proches [39] : il s'agissait notamment pour eux de contrer l'image traditionnelle de l'homme qui serait un loup pour l'homme, ou celle plus « libérale » d'une société individualiste où la compétition serait le moteur de tous et en particulier des « meilleurs ». Mais là aussi, le recours à un fait (supposé) de nature masque difficilement une faiblesse du raisonnement qui repose sur un jugement de valeur implicite : l'empathie (ou, en termes classiques, la fraternité) serait en soi supérieure à l'égoïsme ou meilleure que l'individualisme. Mais un tel jugement de valeur doit être étayé par une argumentation de nature politique ou sociale, car, si les êtres humains ont une tendance naturelle à l'empathie (ce que personne ne conteste sans doute), ils en ont également une à l'agressivité et, sous une forme atténuée, à l'égoïsme… Mais la séduction de la thèse « naturaliste » est si forte qu'elle masque la faiblesse du raisonnement.
Ainsi encore, certains comportements nous paraissent tellement évidents et « naturels » qu'ils ne sont pas ou plus interrogés comme des constructions sociales : les émotions par exemple sont très souvent considérées, même dans des travaux sociologiques, comme des réactions primitives, pratiquement incontrôlables, et la peur, la colère, le sentiment d'injustice, le ressentiment, l'agressivité, la joie, la tristesse notamment semblent profondément enracinés dans la nature humaine. Certains psychologues ont d'ailleurs défendu la thèse de l'universalité de certaines émotions [40] (et donc leur « naturalité »). Néanmoins, des anthropologues [41] , des historiens et des sociologues [42] ont plus récemment contesté cette thèse et souligné les différentes manières dont chaque société considère les émotions [43], dont elle les « gère » en favorisant ou non leur expression, dont elle les articule à travers de multiples régulations [44]… Ce regard critique, s'il veut rester prudent, doit cependant conclure à l'impossibilité actuelle de faire en ce domaine un partage net entre la « nature » et la « culture » ou plus exactement entre la base neuronale des émotions et leur dimension sociale (et corrélativement entre d'une part les neurosciences et d'autre part les sciences historiques et sociales). La même problématique se retrouve d'ailleurs dans d'autres domaines essentiels de l'activité humaine comme le langage : un débat important a ainsi opposé en 1975 le psychologue Jean Piaget, qui a toujours mis l'accent sur la dimension d'apprentissage dans le développement langagier de l'enfant, et le linguiste Noam Chomsky soulignant quant à lui que les compétences linguistiques sont innées chez l'enfant et de ce fait universelles (au sein de l'espère humaine) [45]. On constate effectivement que les grands singes, qui sont censés être les plus proches de nous, ne parviennent pas à acquérir le langage humain, et, à l'inverse, qu'un enfant qui n'est pas (ou ne serait pas) baigné dans un bain linguistique ne peut pas maîtriser la langue et ses mécanismes (nous parlons « spontanément » la langue de nos parents ou de notre entourage, et non celle d'une population qui nous serait totalement étrangère). Mais le débat entre Piaget et Chomsky n'a (évidemment ?) pas pu déterminer s'il existe un « noyau » linguistique inné ni quels seraient ses composants éventuels. Le débat s'est d'ailleurs élargi aux capacités cognitives générales de l'être humain dont il est impossible actuellement de déterminer la part innée et celle acquise (difficulté qu'on surmonte habituellement en parlant d'une d'interaction nécessaire entre les capacités cognitives et l'apprentissage).
Les derniers exemples évoqués permettent cependant de relever un fait important : nos conceptions de la « nature » ont largement évolué sous l'effet des nouvelles découvertes scientifiques, mais sans effacer totalement les anciennes représentations. Ainsi, ce sont les développements de la génétique et en particulier de l'ADN qui ont imposé l'idée qu'un certain nombre de traits de l'espèce humaine (comme de toutes les autres espèces animales et génétiques) sont innés et transmis héréditairement. Dire aujourd'hui que c'est « génétique » signifie que c'est inné et que c'est non-modifiable (au niveau de l'individu) puisque notre patrimoine génétique est inscrit dans chacune de nos cellules… Et cela explique les débats autour de l'existence ou non de gènes (ou combinaison de gènes) pouvant déterminer certains comportements comme le crime, l'agressivité, l'alcoolisme, des maladies mentales comme la schizophrénie, la dépression, l'hyper-émotivité ou même la foi. L'attention portée en ce domaine à des découvertes récentes de l'épigénétique, qui étudie comment « l'environnement […] pourrait moduler l'activité de certains de nos gènes pour modifier nos caractères, voire induire certaines maladies qui pourraient être transmis(es) à la descendance » [46], s'explique certainement par cette croyance (sinon même le désir de montrer) que la génétique n'explique pas tout…[47]
Il faut cependant remarquer que la génétique illustre une forme particulière de lois naturelles qui sont supposées universelles et invariables. Le modèle de ce type de lois s'est établi avec la révolution copernicienne et le renouveau de la physique qui culmine avec les théories newtoniennes : les lois de la nature imposent un déterminisme strict aux choses qui seraient ainsi figées dans un ordre apparemment immuable et rigoureusement calculable comme l'orbite des planètes. De telles lois ont été découvertes dans d'autres domaines scientifiques comme la chimie avec le principe de la conservation de la masse affirmé par Lavoisier ou en biologie avec les lois de Mendel dont les principes ne seront cependant tout à fait expliqués qu'avec les découvertes des chromosomes puis de l'ADN.
Néanmoins, il serait abusif d'affirmer que tous les domaines scientifiques — même dans les sciences dites pures — sont fondées exclusivement sur de telles lois. Ainsi, la sélection naturelle, un principe fondamental de l'histoire naturelle, ne détermine pas l'évolution de façon exacte et précise, et nombre d'explications basées sur ce principe sont hypothétiques puisqu'il faut à chaque évolution puis sélection démontrer un avantage adaptatif. Mais bien d'autres domaines peuvent être caractérisés d'approximatifs sans que cela ne nuise à leur caractère scientifique. Ainsi, la météorologie s'appuie sur une série de notions bien définies (dépression, haute pression, température, taux d'humidité, couches de l'atmosphère, etc.) et peut prédire l'évolution de certains phénomènes comme les ouragans même si, on le sait bien, ces prévisions sont approximatives. Semblablement, la géologie a fait une découverte majeure avec la tectonique des plaques qui permet de comprendre la formation et la dérive des continents, mais on sait bien qu'elle ne peut pas prédire avec précision un tremblement de terre même si elle explique pourquoi certaines régions sont plus affectées par de tels phénomènes que d'autres. Ainsi encore, le médecin qui conseille à son patient d'arrêter de fumer et de modérer sa consommation d'alcool ne peut évidemment pas lui promettre avec certitude que, s'il suit ses conseils, il vivra centenaire. Le caractère probabiliste d'un grand nombre de domaines recourant aux instruments statistiques ne signifie pas que ces savoirs n'ont pas de caractère scientifique.
Au contraire, les probabilités définissent des « lois » de la nature qui ont la même valeur prédictive la physique newtonienne [48]. Pour reprendre un exemple très simple en génétique, l'on peut prédire que les enfants d'un couple d'humains ont une chance sur deux d'être de sexe masculin ou au contraire féminin, mais nous ne savons évidemment pas quel sera précisément le sexe de l'enfant qui va naître… De la même manière, les observations de Mendel qui lui ont permis de distinguer les caractères hérités (appelés aujourd'hui gènes) récessifs et les caractères dominants reposaient sur une approche statistique qui lui a permis de constater qu'à la première génération, le caractère récessif apparaissait seulement une fois sur quatre (224 plantes à fleurs blanches contre 705 à fleurs rouges ou pourpre). Seule une conception hyper-déterministe de la nature prétendrait que de telles lois ne constituent qu'un savoir partiel, et que même le résultat d'un jet de dé pourrait être prédit si nous avions une connaissance parfaite de l'ensemble des lois de la mécanique et des facteurs constituant ce lancer de dé…
Autrement dit, contrairement aux apparences, les « lois » de la nature (au sens traditionnel du mot) ne déterminent pas toujours de façon simple des relations de cause à effet comme l'énonce par exemple le principe d'Archimède à propos de la force exercée sur un corps plongé dans l'eau… La variation est au cœur d'un grand nombre de phénomènes naturels, et le patrimoine génétique commun d'une espèce n'implique évidemment pas que tous les individus de l'espèce aient un comportement identique ou même similaire : les éthologues ont bien observé des différences entre individus au sein de nombreuses espèces observées, mais également entre groupes d'une même espèce (chaque groupe ayant sa « culture » propre). On ajoutera que ce sont ces différences qui expliquent (pour une part) l'évolution des espèces : si, « par nature », les herbivores étaient et devaient rester herbivores, il serait impossible de comprendre comment certains individus au sein de l'une ou l'autre espèce ont commencé à consommer de la chair animale et sont devenus (sans doute d'abord par charognage) carnivores, ainsi que leur descendance sous l'effet de la sélection naturelle [49]. Et l'on n'oubliera pas que certaines espèces carnivores ou omnivores sont devenues exclusivement herbivores comme l'ours panda. À l'image d'une nature supposée figée et immuable, il faut substituer celle d'une évolution continue depuis le Big Bang… Cela peut sembler une évidence, mais invoquer la « nature » des espèces (ou des choses…) pour expliquer, justifier ou au contraire condamner certains comportements est, on le voit à la lumière de ces quelques exemples, extrêmement problématique : prétendre par exemple qu'il serait préférable de manger de la nourriture crue parce que ce serait plus « naturel » et que nos ancêtres lointains ne connaissaient ni le feu ni la cuisson est évidemment absurde [50]. Tous les individus de l'espèce humaine — pas plus que les autres espèces animales — ne sont contraints de façon « mécanique » par leur supposée nature à adopter des comportements identiques ou même similaires : la diversité est au cœur des comportements humains, et le patrimoine génétique n'empêche pas plus les femmes que les hommes de piloter des voitures ou des avions.
Parler de la nature comme obéissant à des lois universelles et inflexibles par opposition à la culture qui serait une construction purement humaine et profondément variable est donc simpliste. Les sciences humaines découvrent en effet des régularités statistiques dans les comportements humains qui ne sont pas fondamentalement différentes de celles que l'on découvre dans la nature : on sait par exemple que, dans les sociétés occidentales, l'origine sociale des élèves a une forte influence sur leur réussite scolaire (même si la catégorie socioprofessionnelle des parents désigne en fait un agrégat de caractéristiques comme des différences de richesse mais également de ressources culturelles, sociales, cognitives multiples) [51]. La spécificité des sciences sociales est évidemment de rechercher des causes sociales (c'est-à-dire dans l'organisation sociale) aux phénomènes humains, et non des causes biologiques, génétiques ou neurologiques. Les déterminations ainsi mises en évidence ne sont pas absolues ni mécaniques, et les sciences sociales ne peuvent prétendre expliquer la totalité des comportements observés mais plutôt des différences de comportement (entre groupes) [52]. De manière générale, elles privilégieront des analyses multifactorielles dans l'explication des phénomènes observés, mais une telle approche n'est pas du tout propre à ce champ de recherche et se retrouve dans tous les domaines scientifiques : pour prendre un exemple élémentaire en médecine, l'on sait bien que la même maladie provoquée par un virus ou une bactérie (qu'on pourrait désigner comme cause « première » ou principale) aura des effets très différents sur différentes populations selon qu'elle auront déjà été en contact à cette maladie et qu'elles sont partiellement immunisées, mais également selon leur état de santé général (une population affaiblie par une disette alimentaire ou par de rudes conditions climatiques sera beaucoup plus affectée par certaines maladies). C'est évidemment le rôle de l'épidémiologie de prendre en compte ces différences entre populations, mais aucun épidémiologiste ne considérera que ces différences sont la cause unique d'une maladie [53].
D'un point de vue scientifique, il est donc peu pertinent d'opposer la nature et la culture, ni de prétendre en particulier, dans une perspective d'apparence sociologique, que les réalités humaines sont des constructions sociales arbitraires. Ce dernier point mérite cependant une explicitation. L'affirmation que les réalités sociales sont des constructions sociales arbitraires a évidemment une portée politique puisque cela implique qu'on puisse les modifier dans un sens différent. Mais d'un point de scientifique, l'affirmation n'apporte aucun savoir effectif. L'on peut même dire que l'objectif de la science et en particulier de la sociologie est de montrer quelles sont les nécessités qui sont à l'œuvre dans les phénomènes sociaux et qui expliquent que ceux-ci se présentent sous la forme qui est la leur actuellement.
L'exemple de la langue ou plus exactement des langues permet de comprendre cela facilement. Ferdinand de Saussure dans son Cours de linguistique générale a ainsi affirmé que la relation entre le signifié et le signifiant était arbitraire puisque le même concept /chien/ est désigné par des « mots » différents en français « chien », en allemand « Haushund » ou en japonais « inu ». On remarquera immédiatement que de telles relations arbitraires existent aussi dans le domaine naturel : la relation entre la couleur de la peau extérieure de la pomme et celle de sa chair intérieure est également variable et donc arbitraire. Cette couleur de la peau dépend évidemment d'autres caractéristiques biologiques qui ne sont pas immédiatement accessibles à l'observation comme l'est cette couleur apparente. Que la relation entre le signifié et le signifiant soit conventionnelle ou arbitraire n'implique pas que toute la langue soit une construction arbitraire qu'il serait dès lors possible de modifier plus ou moins facilement : le rôle de la linguistique et de ses différentes approches est précisément de comprendre quelles sont les nécessités qui expliquent aussi bien la formation que l'utilisation réglée des différentes langues. Si en France, l'on parle d'un chien et non d'un « Hund » comme en Allemagne, cela s'explique historiquement par le fait que le français est une langue romane dérivée du latin comme l'italien ou le portugais qui utilisent des mots apparentés comme « cane » ou « cão ». Et si la fantaisie me prenait d'utiliser le mot « Hund » à la place du mot chien, je risquerais bien l'incompréhension avec mes interlocuteurs francophones ! [54] Si l'on considère la langue synchroniquement (c'est-à-dire à un moment de son histoire), l'on constate de façon similaire que, si l'ordre des mots est (partiellement) arbitraire en latin, il obéit à de très fortes nécessités en français ou en anglais : dire que « Pierre a frappé Jules » n'a pas du tout le même sens que « Jules a frappé Pierre » ; et dans ce dernier exemple l'on voit bien que le signifié de la phrase n'est pas du tout conventionnel par rapport à l'organisation générale du signifiant. Autrement dit, le rôle des sciences sociales comme la linguistique n'est pas de répéter que les réalités sociales sont des constructions arbitraires mais de comprendre au contraire quelles sont les nécessités qui les organisent même si cela n'implique pas que les choses doivent rester en l'état. Pour ceux ou celles qui en douteraient, on rappellera que l'œuvre principale de Karl Marx est Le Capital qui vise précisément à comprendre comment fonctionne le système capitaliste, quelles sont les « lois » qui s'y manifestent (comme la baisse tendancielle du taux de profit) et auxquelles les acteurs eux-mêmes ne peuvent échapper, quelles sont enfin les conditions qui ont permis l'émergence de ce système (en particulier l'accumulation primitive du capital). Cela n'empêche évidemment pas Karl Marx de souhaiter l'abolition de ce système. Sans doute, la conception extrêmement déterministe de l'histoire qui était la sienne peut paraître aujourd'hui fort mécanique, mais son analyse vise bien à expliquer les nécessités, les « lois », qui sont l'œuvre dans ce système économique et social.
Encore une fois, les déterminations révélées par les sciences humaines (qui recourent largement aux instruments statistiques) n'ont pas le caractère de lois éternelles et universelles comme celles la physique, mais l'on a déjà souligné que ce n'était pas là une caractéristique propre à ces savoirs et qu'elle était partagée par un grand nombre de domaines relevant des sciences dites naturelles. Autrement dit, il est faux d'un point de vue scientifique d'opposer deux ordres de choses, naturel d'une côté, culturel de l'autre, le premier obéissant à des lois nécessaires et universelles, l'autre étant foncièrement « arbitraire » et contingent. En une formule simple mais frappante, l'on pourrait dire que tout ce qui est culturel (ou social) est nécessairement naturel, et les savoirs que produisent les sciences humaines ne sont donc pas fondamentalement différents de ceux qu'élaborent des sciences dites naturelles comme la météorologie, l'éthologie, la médecine ou la biologie. Et l'on ajoutera avec les éthologues que les sociétés humaines et leurs cultures n'impliquent pas de discontinuité absolue avec le règne animal, même si les continuités (notamment si on les considère dans une perspective historique) sont faites d'un très grand nombre d'étapes, plus ou moins importantes [55], qu'il n'est pas possible actuellement de reconstituer avec précision ni certitude : on connaît par exemple les nombreux débats qui entourent l'émergence de la bipédie chez les hominiens [56]. À la figure simple d'une opposition entre la nature et la culture ou encore de « la Thèse de l'exception humaine » parmi toutes les autres espèces animales [57], il convient donc de préférer celle d'une inclusion de la culture (ou plus exactement des cultures humaines) dans la nature, en rappelant encore une fois la diversité des organisations sociales comme des comportements individuels sans que ces organisations ni ces comportements ne soient régis par une nécessité simple ni abandonnés à un pur arbitraire. Enfin, si les sciences humaines mettent en évidence (le plus souvent de façon partielle et limitée) les déterminations sociales qui organisent les sociétés et qui s'imposent aux comportements individuels, elles ne peuvent en aucun cas transformer ces déterminations en lois morales (en affirmant par exemple que certains comportements seraient plus naturels que d'autres) ni en justifications ou en injonctions politiques (en transformant par exemple l'histoire effective en nécessité absolue) [58].
La conviction d'une discontinuité radicale entre la nature et la culture prend cependant encore une autre forme, à savoir l'opposition entre le patrimoine génétique et l'apprentissage, ou encore entre l'inné et l'acquis. De façon caricaturale, l'on aurait, d'une part, les tenants d'un déterminisme strict de l'héritage génétique et, de l'autre, les partisans d'un esprit humain conçu à l'origine comme une table rase, entièrement façonné par l'environnement et en particulier la société. Comme on l'a vu avec l'exemple de la langue, ces deux positions extrêmes sont intenables, mais il faut aussi reconnaître que nous n'avons aujourd'hui que des connaissances partielles et hypothétiques des interactions entre les prédispositions génétiques et l'environnement sociale et culturel qui permet l'apprentissage. S'il y a souvent des effets d'annonce notamment aujourd'hui dans le champ des neurosciences, il importe pour les profanes de rester prudent dans ce domaine ; il est en particulier très difficile de relier des données biologiques (par exemple génétiques ou des imageries cérébrales) à des comportements observables. On en donnera un seul exemple, celui de « l'instinct maternel ».
Cette dénomination ancienne (qui date sans doute du 19esiècle) n'est plus guère utilisée aujourd'hui tant elle implique une conception déterministe des comportements humains (et plus particulièrement féminins). C'est d'ailleurs contre cette conception que s'est élevée Élisabeth Badinter dans un ouvrage retentissant L'Amour en plus, publié en 1980 [59]. Partisane d'un constructivisme radical, elle affirmait qu'il s'agissait là en fait d'un mythe masquant un comportement social, apparu tardivement en Occident, soutenu par différentes instances sociales (comme l'État) mais masquant derrière une fausse universalité une très grande variété de comportements et d'attitudes (comme par exemple des infanticides commis en grand nombre en certains lieux et à certaines époques). Il ne s'agira pas ici de mettre fin péremptoirement au débat ainsi ouvert [60] mais d'expliciter les présupposés qui fondent et parfois enferment cette discussion en fonction notamment des contraintes disciplinaires des uns et des autres [61].
Du côté des biologistes et des éthologues, l'on souligne le rôle de la sélection naturelle qui a dû favoriser des comportements de maternage et plus largement de soins à l'égard des petits humains qui n'ont pas, à la naissance, la maturité nécessaire pour survivre seuls avant six ou sept ans. Cela ne signifie pas qu'il y a un « instinct maternel » mais une tendance affective qu'on peut qualifier de manière générale d'empathie [62]. Cette empathie peut d'ailleurs se porter sur d'autres enfants que les enfants « naturels » (dans le cas de l'adoption mais aussi de celui des parents proches, tantes et grands-mères [63]) mais également sur des individus d'une autre espèce comme certains animaux domestiques. Cette empathie est d'ailleurs favorisée par certains comportements des jeunes enfants comme les pleurs ou au contraire les sourires qui suscitent des réactions de compassion [64]. En outre, cette empathie n'est certainement pas propre aux femmes (ou généralement aux femelles des mammifères) et peut être partagée par les hommes : l'amour paternel, aujourd'hui valorisé dans une société qui prône l'égalité entre les genres, n'est sans doute pas de nature différente de celui des mères. Mais cette capacité d'empathie, aussi fondamentale puisse-t-elle paraître, n'est pas exclusive ni mécanique. On observe dans le règne animal des comportements agressifs, notamment de la part des mâles adultes, à l'égard des petits, mais également différentes formes d'abandon, de désintérêt ou même de maltraitance de certaines femelles pour leurs petits.
Du côté des sciences humaines, l'on constate une très grande variation dans les comportements, même s'il est beaucoup plus difficile d'évaluer les sentiments qui leur sont éventuellement liés. Les abandons d'enfants par exemple ont été très fréquents dans certains sociétés comme dans la Rome antique où l'on évalue que les abandons à la naissance ont pu concerner entre 20 et 40 % des enfants [65]. L'infanticide est même une pratique courante dans certaines sociétés de chasseurs-cueilleurs d'Amazonie [66]. Selon les lieux et les époques, l'on observe donc une très variation des comportements comme en témoigne la mise en nourrice des enfants dans les couches aisées en France sous l'Ancien Régime (et au-delà) comme le souligne Élisabeth Badinter). Si l'on considère les représentations sociales, l'amour maternel est certainement une construction récente, la valorisation d'un rôle essentiellement féminin qui émerge au 18e siècle. Il est en revanche beaucoup plus difficile de connaître quels sont les comportements réels des individus, notamment à des époques et dans des groupes sociaux où la mortalité infantile notamment était importante. Même s'il y a d'incontestables variations, les mères dans leur grande majorité, nourrissent leurs enfants, les soignent, les accompagnent, les changent, restent très proches d'eux, avec ce que cela suppose de fatigue, d'accaparement et sans doute d'énervement, alors même que les femmes effectuent par ailleurs toutes sortes de tâches et de travaux [67]. Il reste que certaines pratiques comme l'emmaillotage peuvent nous paraître étranges sinon « barbares », ce qui signifie que ce ne sont pas seulement les représentations mentales qui changent selon les époques mais également les gestes et attitudes. L'amour maternel, pour autant qu'on puisse y accéder (nécessairement de façon indirecte), est extrêmement modulable et dépend grandement des conditions sociales où vit la mère : il suffit de penser à la situation des mères célibataires dans les sociétés traditionnelles pour comprendre combien un tel sentiment est soumis à tout le contexte social où il est susceptible d'apparaître.
Et il ne faut pas être grand psychologue pour constater qu'aujourd'hui, un certain nombre de femmes ne désirent pas avoir d'enfants (sans que cela puisse être considéré comme une pathologie) et que d'autres après l'accouchement ne ressentent pas d'amour spontané pour leur enfant [68] ou encore qu'elles préfèrent certains de leurs enfants (aîné, cadet) à d'autres. À l'inverse, des couples homosexuels masculins souhaitent aujourd'hui avoir des enfants avec l'amour (qu'on qualifiera alors de parental) comme principale motivation explicite [69]. Même si l'on admet l'existence une prédisposition génétique favorisée par la sélection naturelle, cette prédisposition, on le voit bien, est loin d'être universelle et sujette en outre à de multiples variations. À la variété historique et sociale d'envisager l'amour maternel comme de le mettre éventuellement en œuvre [70] s'ajoute ainsi une diversité individuelle (sans doute plus grande dans notre société que dans les sociétés traditionnelles), sans qu'il soit d'ailleurs possible de faire une claire distinction entre les deux.
D'un point de vue scientifique, il paraît donc évident que la sélection naturelle a favorisé chez les humains comme chez d'autres mammifères des comportements d'empathie à l'égard des petits, qui ont par ailleurs été encouragés dans certaines sociétés et à certaines époques (par exemple avec la glorification de « l'instinct maternel »), mais moins dans d'autres circonstances. D'une part, l'on constate donc une grande variété tant individuelle que sociale des comportements, et de l'autre, l'on doit reconnaître qu'il est pratiquement impossible de faire le partage entre une éventuelle composante génétique à la base de ces comportements et l'effet (ou les effets) de l'apprentissage ou plus largement des circonstances extérieures.
Que conclure de cette longue discussion ? L'opposition de la nature et de la culture n'a pas de véritable fondement objectif, et elle est essentiellement réaffirmée au point de vue scientifique pour des raisons disciplinaires : la sociologie s'est ainsi constituée, grâce à Émile Durkheim, par une décision épistémologique [71] consistant à ne considérer que les composantes sociales dans l'étude des comportements humains. Cette décision épistémologique fut extrêmement fructueuse d'un point de vue scientifique parce qu'elle a mis en lumière un ensemble de composantes — organisations, causalités, « structures » sociales… — qui avaient été jusque-là largement négligées et qui doivent être étudiées pour comprendre une part importante (mais indéterminée…) des comportements humains. Mais, par ailleurs, cette décision laissait ouverte la question des autres composantes de l'action humaine (psychologique, biologique…) comme de la continuité (et des discontinuités) entre les sociétés humaines et animales. Les différents champs disciplinaires ainsi constitués, il n'y a pas ou peu de dialogues entre les représentants des uns et des autres, et les rares échanges débouchent sur des confrontations dues à un sentiment d'empiétement indu ou sur une réaffirmation d'un division épistémologique insurmontable [72]. Bien entendu, les études empiriques permettent de mesurer de façon plus précise le poids des différentes composantes sociales dans un certain nombre de comportements humains, et, pour reprendre un exemple classique, il serait absurde d'étudier la réussite scolaire (ou l'échec…) sans tenir compte de la structure du système scolaire mais également de l'environnement social où évoluent les différents élèves. Mais ces études, aussi pertinentes et instructives soient-elles, ne permettent pas de tracer de manière générale et absolue la frontière entre la nature et la culture : ce que révèlent ces études, c'est au contraire que les explications proposées sont partielles et n'éclairent qu'une partie (même si elle peut être importante) des comportements. Cela ne signifie pas que « l'autre part » relève nécessairement du biologique ou du psychologique, mais que les déterminismes que mettent en évidence les sciences humaines ne sont pas de nature « mécanique » et s'articulent nécessairement avec d'autres facteurs explicatifs [73]. Et cela n'implique pas que les polémiques entre spécialistes des différentes disciplines soient stériles dans l'abord de questions particulières : il est évidemment tout à fait pertinent de savoir si la réussite scolaire dépend essentiellement de facteurs sociaux ou résulte principalement d'une intelligence individuelle innée…
On le voit, l'opposition entre la nature et la culture a peu de valeur scientifique [74] et ne permet pas de tracer de limites claires entre des ordres distincts de réalité. Il s'agit essentiellement d'une instrument rhétorique (au sens ancien du terme) qui est utilisé à des fins opposées, soit comme légitimation d'un ordre supposé immuable des choses, soit au contraire comme libération par rapport à des normes établies. On comprend ainsi pourquoi cette opposition conceptuelle, aussi boiteuse soit-elle, est aussi prégnante dans les débats sur la question des genres (masculin, féminin, transgenre…). Sur cette question, les sciences humaines et historiques permettent seulement de souligner la diversité des situations sociales et des différentes manières d'organiser et de penser les rapports entre les sexes, les relations de filiation ou encore les différences de genre. Mais ces situations multiples sont elles aussi facilement instrumentalisées pour plaider une cause en négligeant le contexte où elles prennent place : ainsi, des internautes se sont emparés de l'idée que les Amérindiens reconnaissaient l'existence de trois ou même de cinq sexes différents ainsi qu'une forme de mariage gay, des affirmations largement mises en cause par les ethnologues qui soulignent notamment que dans la plupart des société amérindiennes la division sexuelles, notamment celles des tâches, était extrêmement prégnante, même s'il « existait des personnes qui adoptaient les attributs vestimentaires et aussi certains comportements de l'autre sexe, suivant des modalités qui variaient considérablement selon les groupes » [75].
Doit-on alors parler de faux débats lorsqu'on évoque l'opposition entre nature et culture ou que l'on invoque une nature dévoyée par le progrès (comme on l'a fait en ce début de chapitre) ? Certainement pas. Car les questions par exemple des droits des LGBT+ [76] ou, dans un domaine tout à fait différent, des aliments dits ultratransformés (que l'on qualifierait facilement de « non naturels ») sont évidemment importantes d'un point de vue social et plus largement humain. Mais les sciences naturelles et/ou sociales n'apportent que des réponses partielles et souvent hypothétiques à des telles questions, et ne peuvent que faiblement appuyer des argumentations qui relèvent essentiellement de choix éthiques, moraux ou politiques [77].
Dans une perspective d'éducation permanente, l'on voit l'intérêt à clarifier des concepts comme ceux évoqués ici, le sport ou la nature. Il ne s'agit pas d'imposer une seule définition, mais au contraire de prendre conscience de la diversité de sens (en intension et en extension) de notions utilisées dans le débat public. Il s'agit aussi de souligner le caractère souvent imprécis de ces notions qu'on devrait plutôt désigner comme des prénotions. Enfin, il convient de « déplier » les différentes strates historiques de ces notions qui se sont très souvent constituées par accumulations successives sans que les acceptions anciennes ne disparaissent sous les nouvelles.
Un tel travail de clarification conceptuelle est sans doute nécessaire si l'on veut éviter que telles notions approximatives ne masquent les véritables enjeux (qui sont très généralement de nature politique ou éthique) dans les débats où les intervenants recourent à ce genre de notions comme à des évidences ou à des arguments d'autorité (notamment scientifique).
[1] Par exemple, Farhad Khosrokhavar dans son ouvrage de synthèse Radicalisation (Maison des Sciences de l'Homme, 2014). Gérald Bronner (La Pensée extrême, Paris, PUF, 2016, p. 136) en propose également une définition, différente cependant de celle de Khosrokhavar.
[2] Laurent Bonelli et Fabien Carrie, La Fabrique de la radicalité. Une sociologie des jeunes djihadistes français. Paris, Le Seuil, 2018.
[3] On a proposé ailleurs une analyse différentielle des notion de différence, inégalité, domination et pouvoir qui sont facilement confondues (Michel Condé, La Croyance aux médias. Liège, Les Grigoux, 2018, p. 41-44).
[4] Louis Gruel dans Bourdieu illusionniste (Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2005) a souligné la fréquente utilisation par le célèbre sociologue de l'expression « Ce n'est pas un hasard si… » : une brève réflexion sur la notion de hasard aurait sans doute révélé que le hasard pouvait avoir une large place dans les exemples cités par Bourdieu.
[5] Les philosophes nominalistes affirment que le concept est une construction mentale à visée générale ou universelle, mais qu'il n'existe que des individus concrets et singuliers. Les philosophes réalistes considèrent que les concepts ou universaux ont une existence réelle en dehors de l'esprit des individus qui pensent les choses. Cette querelle, qui n'est pas résolue même si la balance penche aujourd'hui plutôt du côté des nominalistes (qu'ils s'agisse du second Wittgenstein, de Nelson Goodman ou de Willard v. Quine), peut être ignorée pour notre propos.
[6] « L'essentialité » des qualités ou attributs (de la chose ou du concept) est évidemment en soi problématique… Un chat non carnivore (comme souhaitent certains militants du véganisme transformer cet animal) doit-il encore être considéré comme un chat ?
[7] Un exemple célèbre d'une telle démarche est celle de Michel Foucault dans son Histoire de la folie à l'âge classique (Paris, Gallimard, 1972).
[8] L'on ne rentrera pas ici dans le débat complexe sur la définition de la langue qu'il serait possible — ou non — de distinguer du contexte socioculturel où elle est employée.
[9] Philippe Descola, Les Lances du crépuscule, Paris, Plon, 1993.
[10] Ouvrage collectif, Paris, HF Ullmann Editions, 2001.
[11] Françoise Cordier, Les Représentations cognitives privilégiées : Typicalité et niveau de base. Lille, Presses Universitaires de Lille, 1993
[12] L'ouvrage de l'anthropologue Philippe Descola, Par-delà nature et culture (Paris, Gallimard, 2005), qui montrait que la manière dont nous pensons en Occident l'opposition entre la culture et la nature est loin d'être universelle, a sans doute eu un fort retentissement intellectuel mais n'a sans doute pas modifié nos conceptions communes en ce domaine. On y reviendra.
[13] Il faut savoir qu'au Moyen Âge notamment la nature (non domestiquée) était perçue comme inquiétante et malfaisante, résultant de la Chute de l'homme hors du paradis. Cette conception perdure longuement et se retrouve notamment dans l'image menaçante du loup qui vit dans les forêts, incarnation d'une sauvagerie naturelle. On sait combien la conscience écologique contemporaine a modifié cette image du loup dans un sens positif.
[14] Comment ne pas se souvenir à ce propos de la célèbre Partie de campagne de Jean Renoir (1946) ? L'exode rural de la fin du 19e siècle et du 20e siècle peut sembler lointain, mais beaucoup de citadins (même nés en ville) ont conservé des attaches campagnardes à travers leurs parents ou grands-parents, ce qui explique sans doute cette nostalgie de la vie « campagnarde », perceptible dans un film plus récent comme Jean de Florette de Claude Berri (1986).
[15] La forêt de la Bialowieza à cheval entre la Pologne et la Biélorussie est l'un des derniers lieux importants des forêts primaires en Europe. Largement préservé, cet espace est néanmoins traversé de routes et construits en plusieurs endroits. C'est également un lieu de tourisme important.
[16] Ici encore, le cinéma nous en offre un bel exemple avec le film au titre révélateur de Sean Penn, Into the Wild (2008) inspiré d'une histoire authentique : rejetant la société contemporaine, un jeune homme, Christopher McCandless, effectuera un long périple dans les marges des États-Unis avant de partir en Alaska où il meurt après avoir ingéré par erreur une plante toxique.
[17] Pour rappel, les trappeurs n'étaient pas des explorateurs mais des chasseurs d'animaux à fourrure (pris à l'aide de trappes préservant la fourrure). Leur activité dans le Grand Nord n'était cependant pas solitaire, et les Amérindiens furent partie prenante de cette activité commerciale de vaste ampleur à cause d'une demande européenne toujours croissante à tel point que certains historiens affirment que dès le 18e siècle les populations améridiennes faisaient partie de cette économie-monde (selon l'expression de Fernand Braudel) centrée sur l'Europe (James Daschuk, La Destruction des Indiens des plaines, Québec, Presses de l'Université Laval, 2015). Ces relations commerciales furent par ailleurs une source d'entrée pour les épidémies qui allaient décimer les Autochtones non immunisés contre les maladies venues le plus souvent du vieux continent.
[18] Le béton est un « mélange de ciment, de granulats, d'eau et d'adjuvants » (Wikipedia), mais le durcissement du béton (qui peut prendre plusieurs jours) résulte d'un processus chimique. On dit que le béton « sèche » mais il ne s'agit évidemment pas d'un phénomène (physique) d'évaporation. C'est au début du 19e siècle qu'ont été inventés les ciments cuits à base de calcaire nécessaires à la fabrication du béton.
[19] L'on sait cependant que la nourriture trop cuite notamment sur barbecue entraîne la formation de substances cancérogènes. Mais cela ne suffit sans doute pour que la plupart d'entre nous pour considérer la cuisson des aliments comme « non naturelle ».
[20] L'on ne se situe pas ici dans le cadre d'une étude historique ni littéraire de la pensée de Jean-Jacques Rousseau qui est évidemment plus complexe que cette brève évocation. Mais pour toutes celles et tous ceux qui n'ont gardé qu'un souvenir scolaire du grand écrivain, sa pensée se résume sans doute de façon sommaire à une critique du « progrès » (au sens le plus large du terme).
[21] On entend ici rhétorique au sens classique de l'art de la persuasion par le discours.
[22] Comme pour Rousseau, on tiendra compte du fait que nous ne sommes pas ici dans une histoire de la pensée, en particulier celle de Darwin qui n'a jamais prétendu que l'homme descendait du singe mais seulement que les humains et les grands singes devaient avoir un ancêtre commun.
[23] Cette courte nouvelle a été adaptée sous forme d'un film d'animation de Frédéric Back en 1987.
[24] On remarque que cette forêt est replantée par un seul homme. L'individu proche de la nature est solitaire et rejette toute forme de société organisée (selon l'opposition entre la solidarité mécanique et la solidarité organique conceptualisée par Durkheim). On retrouve la même conception de l'action individuelle dans la fable du colibri de Pierre Rabhi : « Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre. Seul le petit colibri s'activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit : "Colibri ! Tu n'es pas fou ? Ce n'est pas avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu !" Et le colibri lui répondit : "Je le sais, mais je fais ma part." ». Le rapport à la nature (sinon son « sauvetage ») est conçu comme un rapport individuel (même s'il peut être le fait d'une collection d'individus) sinon personnel, alors que la « destruction » de la nature est perçue comme le fait d'une société englobante. Autrement dit, le « retour à la nature » (sous ses différentes formes) peut être vu comme une réaction au sentiment de perte ou d'absence d'autonomie due à une société hautement complexe et diversifiée et donc comme une forme de « reprise en main » de son propre destin. Concrètement, on voit bien par exemple pourquoi le jardinage (au rendement sans doute assez faible) est aujourd'hui souvent pratiqué et fortement valorisé face à une agriculture industrielle dont nous ne serions plus que les consommateurs « passifs ».
[25] La chute de l'empire romain, la peste noire qui décime l'Europe au 14e siècle induisent notamment un ralentissement de la déforestation. Mais il s'agit d'un processus continu bien qu'irrégulier qui s'étend certainement sur plus de deux millénaires. Voir notamment Jed O. Kaplan, Kristen M. Krumhardt, Niklaus Zimmermann, « The prehistoric and preindustrial deforestation of Europe » in Quaternary Science Reviews 28 (2009) p. 3016–3034.
[26] On assiste dans plusieurs pays comme la France, l'Allemagne, la Belgique ou la Suisse à une augmentation (parfois légère) des surfaces forestières à partir du 20e siècle. Mais ce n'est évidemment pas le cas dans d'autres régions du monde où la déforestation est importante.
[27] « Une nature accueillante » est un slogan touristique largement employé.
[28] Il faut noter que le mythe du progrès n'a jamais été absolu : au contraire, les critiques et le scepticisme se sont manifestés très tôt au point de dominer l'opinion intellectuelle à la fin du 19e siècle en France (Marc Angenot, Mille huit cent quatre-vingt-neuf: un état du discours social. Montréal/Longueuil, Éditions du Préambule, 1989).
[29] Comme évoqué précédemment, l'œuvre de Jean Giono illustre le passage d'une pensée que l'on peut qualifier de « passéiste » (plutôt que de réactionnaire au sens politique) à une consciences écologiste ou pré-écologiste.
[30] Dans le compte rendu de l'ouvrage d'une journaliste qui « raconte comment elle a tenté la survie en forêt », on lit par exemple qu'il s'agit de « faire corps avec la Nature » avec au final un « retour aux sources qui lui apporte de la sérénité (un autre apport au temps), de la douceur, du sens et la vérité. [L'expérience] a réveillé en elle "la femme archaïque" ». On voit facilement comment cet article s'appuie sur une série d'oppositions et d'équivalences qui ne sont que faiblement questionnées entre nature/civilisation, passé archaïque/présent éphémère, vérité/non-sens, bien/mal (ou malheur), fusion (« faire corps »)/division, terre/vie citadine… (Le Nouvel Obs)
[31] Il y a là en fait une erreur logique qui consiste à identifier une succession d'événements ou d'états à une relation de cause à effet (ou en termes plus savants une corrélation statistique à un relation de causalité). Ce n'est pas parce qu'ils sont « modernes » que certains procédés industriels sont plus « mauvais » que des procédés antérieurs mais parce qu'ils consistent par exemple à ajouter des additifs qui peuvent être nocifs aux aliments. C'est le fait d'ajouter des conservants ou des colorants à une confiture qui est critiquable, mais il est tout à fait possible de produire industriellement la même confiture sans additifs qui aura alors les mêmes qualités qu'un produit artisanal. C'est ce que font d'ailleurs les producteurs (industriels) d'aliments bios (transformés).
[32] Cette thèse est défendue par des auteurs comme Jared Diamond & Clive Dennis (https://clairetlipide.wordpress.com/2011/09/05/la-pire-erreur-de-lhumanite-lagriculture/ ), Richard Manning (Against the Grain: How Agriculture Has Hijacked Civilization, 2004) ou Robert Sapolsky (Why Zebras Don't Get Ulcers, 2004)
[33] Et l'on rappellera que la nature identifiée à la vie n'est elle-même pas éternelle et qu'elle est sans doute apparue il y a 3,5 milliards d'années.
[34] On peut consulter notamment l'ouvrage de Jacques Tassin, La Grande Invasion : Qui a peur des espèces invasives ? Paris, Odile Jacob, 2014 et son interview ainsi que cet article de la RTBF.
[35] D'un point de vue logique, on a ici une généralisation abusive puisque les équilibres naturels d'un point de vue scientifique ne concernent que des écosystèmes définis et limités (d'un point de vue spatial et temporel). On ne peut pas parler d'un équilibre général de la nature puisque ces équilibres sont toujours en transformation. Cette remarque (qui vise plus particulièrement « l'hypothèse Gaïa ») ne concerne pas du tout la thèse du réchauffement climatique : celui-ci n'est pas un déséquilibre de la « Nature » globale mais un déséquilibre qui affecte un élément particulier de la Terre, à savoir l'atmosphère (même si celle-ci recouvre l'ensemble de sa surface), et qui, s'il se poursuit, aurait ou aura des conséquences importantes sur les espèces vivantes.
[36] Les Essais, Livre I, chapitre XXXI : « Des cannibales ».
[37] Bien qu'il soit difficile de dater avec précision son apparition, ce slogan a été largement popularisé à la suite des événements de mai 68 et, s'il était au départ disruptif, il est aujourd'hui admis par une part importante de l'opinion publique. Il était et est toujours en accord avec les principes fondamentaux de la sociologie qui affirme qu'il existe un « ordre social » différent de la biologie comme de la psychologie et que tous les comportements humains sont pour une part des constructions sociales. On remarquera que la pensée dite « déconstructionniste » (de Michel Foucault à Jacques Derrida et leurs épigones) partage la même conviction épistémologique que tous nos concepts, tous nos savoirs, toutes nos valeurs sont des constructions sociales arbitraires qui masquent plus qu'elles ne révèlent une réalité (devenue elle-même pour certains une pure construction sociale).
[38] La même problématique se retrouve dans la question de l'origine éventuellement génétique ou hormonale de l'homosexualité (masculine) (Cf. notamment Jacques Balthazart, Biologie de l'homosexualité. On naît homosexuel, on ne choisit pas de l'être, Wavre, Mardaga, 2010). Pour les défenseurs d'une telle origine, il est absurde de vouloir « aller contre la nature », et les thérapies dites de conversion qui prétendent « guérir l'homosexualité » (en sous-entendant que l'orientation sexuelle résulte d'un libre choix individuel) sont une absurdité (et une maltraitance). Ici aussi, on aperçoit facilement la faiblesse de l'argumentation : être homosexuel (ou non) est une liberté fondamentale dans toute société démocratique, et on ne saurait faire dépendre une telle liberté (qui est sociale sans que l'on préjuge d'une quelconque liberté subjective d'être ou ne pas être homosexuel) d'un quelconque substrat biologique. Ou alors, l'on devrait démontrer pareillement qu'une pratique sexuelle comme la sodomie (homo ou hétérosexuelle), encore condamnée aujourd'hui dans certains États américains, devrait avoir une base biologique pour ne pas être interdite…
[39] Fans de Waal, L'âge de l'empathie : Leçons de la nature pour une société solidaire, Arles, Actes Sud, 2011.
[40] C'est la position du psychologue américain Paul Ekman qui a d'abord distingué six émotions de base avant de l'élargir à seize.
[41] Vinciane Despret, Ces émotions qui nous gouvernent. Ethnopsychologie des émotions. Paris, Les empêcheurs de penser en rond/Le Seuil, 2001.
[42] On peut se reporter à la synthèse récente « Controverses sur l'émotion. Neurosciences et sciences humaines » (coordonné par Quentin Deluermoz, Thomas Dodman et Hervé Mazurel), Sensibilités, n° 5, novembre 2018.
[43] Une des caractéristiques de la pensée occidentale est précisément de faire un grand partage entre les émotions supposées intimes, spontanées et naturelles, et la pensée supposée raisonnable, construite et proprement humaine. Ce partage (bien illustré par le Traité des passions de Descartes) ne se retrouve pas dans d'autres modes de pensée (comme les Samoans, les aborigènes Gindjigali d'Australie, les Chewong de Malaisie… selon le psychologue James A. Russell, cité dans la revue Sensibilités).
[44] Loin d'être purement intimes, les émotions ont une fonction sociale évidente : si je me mets en colère, je cherche très généralement à impressionner mon « adversaire » même et surtout si cette colère semble « incontrôlée ». Dans la même perspective, on peut relever que la peur, qui semble une réaction primaire ou primitive, peut être surmontée par exemple par les soldats au front, non pas tellement sous l'emprise de la raison mais plutôt d'autres émotions comme le sentiment de camaraderie.
[45] M. Piattelli-Palmarini, Théorie du langage et Théorie de l'apprentissage, le débat entre Jean Piaget et Noam Chomsky, Paris, Seuil, 1979
[46] Dans Le Monde. Il s'agit là d'hypothèses qui sont à ce stade très fragiles et perçues par leurs critiques comme un retour des thèses de Lamarck qui croyait au caractère héréditaire des caractères acquis. Ces thèses ont définitivement été invalidées par la découverte de l'ADN qui est le support de l'hérédité biologique.
[47] Ce que bien sûr la génétique, si elle est raisonnable, ne prétend pas. Les conflits sur l'inné et l'acquis ont très souvent, comme on l'a dit, une composante politique mais résultent également de conflits entre champs disciplinaires. Les sciences sociales sont par principe même opposées aux déterminismes de type biologique (ou même psychologique) et font l'hypothèse d'une espèce humaine essentiellement façonnée par l'apprentissage. On retrouve la même défense disciplinaire dans la querelle sur les causes de l'autisme : si ces troubles sont essentiellement d'origine génétique (ou en tout cas organique et non pas psychologique), les thérapies psychanalytiques ne peuvent pas prétendre y porter remède, si ce n'est sur des symptômes secondaires.
[48] On sait peut-être qu'il y a en mécanique quantique un indéterminisme fondamental et que seul le calcul des probabilités nous permet d'avoir des connaissances assurées en ce domaine. Mais ce domaine, qui échappe totalement aux non-spécialistes, n'est sans doute pas très éclairant pour notre propos. D'autres champs comme eux évoqués dans le corps du texte sont beaucoup plus accessibles aux profanes et permettent facilement de questionner notre conception générale de la nature.
[49] Un exemple contemporain serait celui des hippopotames dont certains spécimens consomment des carcasses d'animaux.
[50] Bien entendu, l'on sait que certains modes de cuisson peuvent favoriser l'apparition de substances cancérigènes, mais certaines nourritures « naturelles » non cuites peuvent également être toxiques ou néfastes pour la santé.
[51] Voir par exemple Meuret Denis, Morlaix Sophie, « L'influence de l'origine sociale sur les performances scolaires : par où passe-t-elle ? », Revue française de sociologie, 2006/1 (Vol. 47), p. 49-79. DOI : 10.3917/rfs.471.0049.
[52] Ce point a été explicité dans notre analyse intitulée « Médias et sociales ».
[53] Il faut bien voir que le choix d'isoler une cause supposée comme cause « principale » ou « première » résulte très souvent d'une décision épistémologique qui résulte du domaine spécifique où travaillent les différents chercheurs : pour reprendre l'exemple évoqué à l'instant, pour un biologiste, le virus ou la bactérie (ou tout autre agent pathogène) sera considéré comme la « cause » (sans autre précision) de la maladie alors que pour l'épidémiologiste, ce sera l'état sanitaire général de la population. On remarquera qu'une telle « querelle » scientifique a aussi des conséquences politiques. On sait par exemple que la tuberculose s'est développée en Europe au 19e siècle dans la promiscuité des grandes villes et de leurs conditions de vie misérables, ce qui explique que ce soit les plus pauvres qui en ont été les principales victimes (mais pas exclusivement). Et c'est l'amélioration générale de ces conditions de vie et en particulier une meilleure hygiène qui ont diminué l'incidence de cette maladie avant l'arrivée des antibiotiques qui ont permis de guérir un grand nombre de malades. Mais aujourd'hui encore, c'est parmi les populations les plus précarisées comme le SDF que l'on voit apparaître des formes de la maladie résistantes aux antibiotiques.
[54] Ici encore, on voit facilement l'importance des déterminations sociales dans l'acquisition possible d'une deuxième langue : ces déterminations peuvent être de l'ordre de la nécessité (si l'on émigre dans une autre société), de l'intérêt (commercer avec des étrangers), de l'opportunité (apprendre l'anglais pour voyager) ou du simple contexte (l'anglais est partout présent en Europe alors que les Européens ont sans doute peu d'occasions d'entre en contact avec le swahili ou le thaï). Et l'on n'oubliera pas qu'il est plus facile d'apprendre une langue quand on est jeune que lorsqu'on est plus âgé. De façon abstraite, l'on peut estimer que nous sommes « libres » ou (plus ou moins) capables d'apprendre n'importe quelle langue, mais, dans les faits, le contexte social nous impose notre langue maternelle et contraint fortement le choix d'une deuxième ou troisième langue.
[55] Cette idée est largement développée par Frans de Waal dans L'Âge de l'empathie : leçons de nature pour une société plus apaisée, Paris, Les Liens qui libèrent, 2010. Il est évident qu'il y a des différences entre les sociétés humaines et les sociétés animales, mais, dans une perspective historique, l'on doit nécessairement supposer que les sociétés humaines ont évolué à partir des premiers groupes d'hominiens (ou même plus anciens), mais les étapes de cette évolution sont très certainement multiples et largement hypothétiques. Ce qui est absurde d'un point de scientifique, c'est de supposer une rupture radicale qui signerait la « naissance » de l'homme et de la femme actuels. Même les différences génétiques n'ont pas empêché les échanges entre l'homme de Neandertal et l'homo sapiens.
[56] C'est sans doute une évidence, mais, face à l'affirmation du caractère fondamentalement arbitraire des cultures humaines, on peut souligner l'importance de la bipédie sur un très grand nombre de créations humaines comme le mobilier ou même les manières de se tenir en face-à-face (à l'inverse, c'est parce que nous sommes bipèdes que se mettre à quatre pattes devant quelqu'un est un signe de soumission). Bien entendu, comme Marcel Mauss l'a souligné, une telle caractéristique partagée par tous les humains (sauf les bébés !) est sujette à des modulations multiples selon l'organisation sociale en cause : les militaires marchent au pas, ce qui n'est pas le cas des civils ! Marcel Mauss, « Les Techniques du corps » dans Sociologie et anthropologie, Paris, PUF, 1978 (5e éd.), p. 365-386.
[57] Cf. sur cette « Thèse » qui fonde notre vision occidentale du monde, l'ouvrage de Jean-Marie Schaeffer, La Fin de l'exception humaine, Paris, Gallimard (Essais), 2007.
[58] De manière générale, les sciences humaines et parfois les sciences « naturelles » (comme la génétique) sont facilement utilisées pour légitimer des opinions morales ou politiques : « ce qui est » devient « ce qui doit être » ou au contraire « ce qui ne doit pas être ». En outre, le jugement moral que l'on porte sur les faits (par exemple, le terrorisme) est très souvent reporté sur les causes supposées de ces faits (l'injustice, la discrimination, la victimisation, le fanatisme sectaire…) sans tenir compte du caractère hypothétique des causes mises en avant et de la multiplicité des causes.
[59] Élisabeth Badinter, L'Amour en plus : histoire de l'amour maternel (XVII au XXe siècle), 1980, rééd. Paris, Le Livre de Poche, 2001.
[60] On remarquera que l'ouvrage d'Élisabeth Badinter a été fortement critiqué non pas par des biologistes mais par des historiens qui n'y voient qu'une thèse mal soutenue historiquement : voir les articles suivant (a & b) dans la revue Persée.
[61] Historiens, biologistes et éthologues n'ont que peu de dialogues entre eux. Les plus prudents reconnaissent seulement que leur discipline n'éclaire qu'une partie des comportements en cause.
[62] Cf. l'ouvrage de Frans de Waal, L'Âge de l'empathie déjà cité.
[63] Une hypothèse dite « l'effet grand-mère » vise à expliquer l'apparition de la ménopause chez les femmes : cette perte de fécondité semble un désavantage d'un point de vue reproductif mais pourrait favoriser la transmission des gènes dans la mesure où la grand-mère favoriserait alors par des comportements maternants ses petits-enfants (et donc son patrimoine génétique).
[64] Les chats et les chiens domestiques ont d'ailleurs le même genre de réactions quand on les caresse (ronronnements, manifestations de plaisir…) qui expliquent l'attachement que peuvent leur porter leurs maîtres ou maîtresses.
[65] D'après l'historien John Boswell cité par Jean-François Dortier https://www.scienceshumaines.com/y-a-t-il-un-instinct-maternel_fr_2849.html
[66] D'après l'anthropologue Sarah Blaffer Hrdy, Les Instincts maternels, Paris, Payot, 2004. Ce sont généralement des enfants handicapés ou très faibles qui sont victimes de telles pratiques. Mais Jacques Lizot signale que les filles en sont préférentiellement victimes chez les Indiens Yanõmami où il compte environ huit filles pour dix garçons. Lizot Jacques. « Compte rendu de mission chez les Indiens Yanõmami », L'Homme, 1970, tome 10 n°2. pp. 116-121.
[67] Morel Marie-France, « L'amour maternel : aspects historiques », Spirale, 2001/2 (no 18), p. 29-55.
[68] C'est un sujet largement débattu sur les forums consacrés la maternité.
[69] Cet exemple permet d'ailleurs de questionner les modèles psychologiques que privilégie la sociologie (ou au moins une forme sommaire de sociologie), à savoir l'inculcation de normes de comportement ou l'imitation de modèles idéaux (comme ceux de la publicité), c'est-à-dire des formes simples d'imitation ou de reproduction. Les homosexuels qui souhaitent adopter ne reproduisent évidemment pas des normes sociales dominantes, et ils inventent de nouvelles formes de parentalité (en conflit avec les normes anciennes) : il y a de leur part au moins une réinterprétation de ces normes dans une configuration inédite. La « reproduction » est rarement simple et les « héritiers » transforment le plus souvent les héritages (notamment culturels) qui leur sont faits…
[70] Sur ce point, on peut se reporter notamment à Sarah Hrdy, Les Instincts maternels, Paris, Payot, 2004 (éd. or. anglaise : 1999), beaucoup plus convaincant que les thèses sommaires d'Élisabeth Badinter.
[71] Très souvent, les décisions épistémologiques sont transformées dans les sciences humaines en faits supposés objectifs. Par exemple, chez Marx l'opposition entre la base matérielle (appelée chez les marxistes infrastructure), conçue comme déterminante en dernière instance, et les superstructures fondamentalement déterminées par la base matérielle. Une telle distinction est sans doute très éclairante pour penser la réalité, et la décision de considérer la relation de détermination entre ces deux instances de manière unilatérale permet certainement de comprendre un grand nombre de phénomènes sociaux, mais il est certainement simpliste sinon faux de transformer en « loi » universellement valable ce qui est en fait une décision épistémologique. On peut certainement faire la même remarque à propos de l'affirmation marxiste selon laquelle « L'histoire de toute société jusqu'à nos jours n'a été que l'histoire de luttes de classes ». Énormément de faits peuvent être expliqués dans une telle perspective, mais cela ne signifie pas que tous les faits historiques ou sociaux sont redevables d'une telle explication
[72] L'anthropologue Serge Tcherkézoff, à l'issue d'une discussion avec les tenants de la sociobiologie, affirme par exemple : « la question principale [de son point de vue d'anthropologue] est l'autonomie méthodologique de cette petite part du comportement humain que les sciences sociales se sont données pour objet. » On remarque la prudence inhabituelle de ce tenant des sciences sociales dans l'explication de certains comportements humains. Il est vrai qu'il traite alors de la question du viol chez les Samoan (que Margaret Mead avait complètement négligée), et il ajoute : » En effet, voilà un type de (non-)relations sexuelles qui se rencontre partout. Nous admettrons volontiers que le fait de savoir pour quelle raison le viol est pratiqué par un homme sur une femme (ou sur un homme, ou sur un enfant) et non par une femme sur un homme, est une question pour la biologie des hormones ou pour la sociobiologie des dominances dans l'asymétrie des sexes. Mais l'ethnologie-anthropologie ne s'occupe pas du tout de cette question. Si un de ses représentants se rend parmi les Samoans et leur demande l'hospitalité, ce n'est pas pour observer un phénomène dont on sait qu'il est déjà universel. C'est afin de voir ce qu'il y a de "samoan" dans ce phénomène. […] Il est aisé d'admette que l'agressivité sexuelle masculine relèverait de facteurs biologiques, mais cela n'a rien à voir avec le débat. Le rôle de l'anthropologie sociale est d'expliquer la forme samoane du viol et non le fait qu'il y ait des viols dans les sociétés humaines. Elle doit expliquer pourquoi les Samoans distinguent le fait de "forcer (une fille)" faamalosi et le viol nocturne moetotolo, pourquoi celui-ci se fait la nuit, en "rampant" tolo, avec des mots et des attitudes en rapport au monde des "esprits", etc. ». On remarque la prudence de Serge Tcherkézoff (à l'opposé de certains sociologues qui affirment que tout dans le comportement humain est « culturel » ou « construit socialement ») : il ne prétend d'ailleurs pas expliquer les comportements mais décrire seulement les différentes formes sociales qu'ils peuvent prendre (on signalera aussi qu'il néglige le fait que des femmes peuvent violer des enfants). Le dernier chapitre de son ouvrage revient longuement sur la différence entre nature et culture dans une défense assez classique des sciences sociales (Serge Tcherkézoff, Le Mythe occidental de la sexualité polynésienne, 1928-1999. Margaret Mead, Derek Freeman et Samoa. Paris, PUF, 2001, p. 205-220).
[73] On remarquera par ailleurs qu'une grande part du travail en sciences humaines (notamment en histoire) est de nature descriptive et non pas explicative. Ces descriptions — pensons seulement à tous les travaux élaborés dans une perspective ethnographique — sont souvent d'une grande importance mais la dimension descriptive est souvent négligée sinon dévalorisée face aux prétentions explicatives qui sont elles souvent démesurées.
[74] Outre l'ouvrage de Philippe Descola et celui de Jean-Marie Schaeffer (La fin de l'exception humaine) déjà cités, on consultera avec intérêt Principia Semiotica. Aux sources du sens du groupe µ qui, à rebours d'une tradition philosophique idéaliste, prétend établir « que le circuit de la signification prend son départ dans le monde naturel. Ce processus, qui part des stimulus issus de ce monde et qui aboutit à l'élaboration des structures sémiotiques, nous le nommerons anasémiose. La sémiose [la construction du sens en fonction de l'environnement], loin d'être un phénomène sans lien avec le corps, tire son origine de celui-ci. Et cet aspect de la corporéité du sens ne saurait être abordé qu'à travers les interactions qu'il entretient avec son contexte (dans l'acception large du terme, incluant l'expérience du monde et d'autrui) » (Bruxelles, Les Impressions nouvelles, 2015, p. 10). Alors que Ferdinand de Saussure a, par une décision épistémologique fructueuse, fondé le champ de la linguistique moderne (synchronique) en affirmant notamment l'arbitraire du signe et en rejetant comme non-pertinente la question traditionnelle de l'origine du langage, cet ouvrage s'interroge donc, dans des termes nouveaux, sur les fondements « naturels » ou plus exactement « corporels » de la sémiose. Bien entendu, les réponses apportées ne sont pas définitives.
[75] Dans Libération. L'exemple des sociétés amérindiennes est particulièrement significatif des utilisations polémiques de situations décrites par les ethnologues (qui eux-mêmes ne sont d'ailleurs pas exempts de préjugés). De bandes de sauvages assoiffés de sang et voleurs de femmes, telles que montrées dans les westerns classiques, ces populations sont devenues l'icône notamment de la spiritualité (les chamans) et d'un mode de vie en harmonie avec la nature (avec notamment ce slogan « La Terre ne nous appartient pas, ce sont nos enfants qui nous la prêtent » censé incarner la sagesse indienne).
[76] Dans Libération.
[77] L'on pourrait penser que la question des aliments ultratransformés est purement scientifique : sont-ils ou non néfastes pour la santé ? Mais cette question n'épuise pas la problématique, car il faut évaluer les risques que représentent ces aliments par rapport à d'autres risques sanitaires (comme ceux sans doute beaucoup plus importants que constituent par exemple la consommation d'alcool ou le tabac) ainsi qu'aux avantages éventuels de ce type d'aliments (ne serait-ce qu'en termes économiques). Il y a donc bien une évaluation nécessaire même si celle-ci doit s'appuyer pour une part sur des études scientifiques qui, rappelons-le encore une fois, sont partielles, souvent hypothétiques et parfois contradictoires. Sur la question de l'éducation à la santé et plus largement de la santé publique, on pourra se reporter à l'analyse des Grignoux consacrée au film 120 battements par minute de Robin Campillo.
Cliquez ici pour retourner à l'index des études et analyses.