





Une étude proposée par les Grignoux
et consacrée au thème
Cinéma et éducation aux médias
Quelles compétences sont nécessaires pour voir, comprendre et analyser un film ?
L'étude proposée ici s'adresse aux animateurs en éducation permanente qui souhaitent aborder la question des compétences en matière d'analyse de films à faire acquérir éventuellement par un large public. Elle vise plus précisément à déterminer la place possible de l'éducation au cinéma dans le cadre général d'une éducation aux médias.
Cliquez ici pour obtenir une version pdf facilement imprimable de ce document![]()
La nouveauté du cinéma au début du 20e siècle a rapidement entraîné l'idée d'une nécessaire éducation à ce nouveau mode d'expression que d'aucuns considéraient en outre comme un art nouveau (on attribue généralement l'invention de l'expression « septième art » à l'écrivain italien Ricciotto Canudo qui, dans Le Manifeste des sept arts publié en 1923, oppose déjà les « artistes » aux « industriels »). Mais quelques décennies plus tard, l'invention de la radio puis surtout celle de la télévision vont imposer la notion plus générale de médias (en sous-entendant généralement « audio-visuels ») et élargir le nouveau projet d'éducation à l'ensemble de ces médias : les travaux de Marshall McLuhan sur La Galaxie Gutenberg (1962) et Pour comprendre les médias (1964) imposent définitivement ce concept nouveau et en affirment l'importance essentielle avec notamment la célèbre formule « the medium is the message ». L'éducation au cinéma, à peine présente dans le monde scolaire, est-elle dès lors appelée à se dissoudre dans ce projet beaucoup plus vaste de l'éducation aux médias ?
Pour répondre à cette question, il faut d'abord définir ce que sont les médias et en déterminer la nature ainsi que les composantes éventuelles. À ce propos, même si les thèses de McLuhan ne sont pas admises par tous, la perspective nouvelle qu'il a adoptée est largement partagée par les spécialistes du domaine et repose sur trois convictions essentielles.
La formule « the medium is the message » ne signifie évidemment pas que le contenu des médias soit totalement indifférent et que la communication médiatique se réduise à une pure affirmation d'elle-même, mais que la diversité des contenus masque la manière uniforme et spécifique dont chaque média agit sur les individus [1]. Cela signifie que les médias se différencient les uns des autres par des caractéristiques génériques (comme l'opposition entre les médias « chauds » et « froids » selon McLuhan) plus importantes que les contenus des messages communiqués. Enfin, il est possible de déterminer l'effet spécifique des différents médias sur l'état des sociétés où ils trouvent place.
Ces convictions suscitent néanmoins un certain nombre d'objections.
La première concerne la définition même des médias : la réalité massive des nouveaux moyens de communication audiovisuels (cinéma, radio, télévision…) a conduit à une conception extensive des médias pour englober l'ensemble des moyens de communication d'hier et d'aujourd'hui. McLuhan prend ainsi en considération non seulement l'écrit, évidemment très ancien (et qu'il surnomme la galaxie Gutenberg), mais également les routes et les voies navigables qui permettent une transmission de l'information plus ou moins rapide. De façon plus élargie et plus surprenante encore, il considère que la lumière électrique est l'exemple même d'un média sans contenu puisqu'elle nous permet de voir ce qui, sans elle, resterait invisible ; et personne ne niera en effet que cet éclairage a profondément modifié notre façon de vivre. On comprend alors que la « médiologie », telle qu'elle est conçue par McLuhan et ses épigones plus ou moins directs, en vient à considérer que toute relation sociale, dans la mesure où elle suppose un processus de communication (et donc un média), relève de sa compétence d'analyse.
Mais, dans une telle conception extensive, les médias apparaissent comme une réalité très hétérogène qui semble difficilement redevable d'une seule et même approche théorique. En fait, les analyses dépassent rapidement le cadre théorique de départ — celui du média défini comme moyen de communication — et recourent à des considérations empiriques extrêmement diverses pour « comprendre » les différentes composantes du média en cause : quand McLuhan considère par exemple le chemin de fer ou l'avion comme moyens de communication indépendamment de ce qu'ils transportent et d'où ils sont déployés, il ne peut guère affirmer que leur importance « sociétale » en parlant de façon très vague de « l'accélération du rythme du transport », mais seule une analyse sociale, économique et historique relativement fine peut expliquer leurs effets réels et très diversifiés (selon les régions et les groupes envisagés) sur le monde moderne. Autrement dit, les « médias » apparaissent comme une réalité historique, variable, multiforme sinon hétérogène, plus que comme une notion théorique, clairement définie et délimitée ou comme un instrument d'analyse opérationnelle.
McLuhan a néanmoins proposé un nouveau concept, devenu rapidement célèbre, mettant l'accent sur l'opposition entre les médias « chauds » — qui transportent une grande quantité de données mais de ce fait qui sollicitent moins la participation du récepteur — et les médias « froids » — qui véhiculent moins d'information et doivent donc être « complétés » par l'action du public —. Cette opposition conceptuelle visait, on le voit, à dépasser le caractère empirique de la notion commune de médias et à en proposer une approche théorique et formalisée. Mais, si elle a été illustrée de multiples façons par McLuhan (parfois de manière surprenante [2]), elle se fonde beaucoup plus sur les intuitions du philosophe canadien que sur des critères objectifs et opérationnels. Le classement même des différents médias peut notamment donner lieu à de longues discussions : la parole serait ainsi un média « froid » comme le téléphone, mais la radio serait quant à elle un média « chaud » (sans doute en souvenir de la panique créée en 1938 aux États-Unis par la lecture d'Orson Welles de La Guerre des mondes sur la chaîne CBS) ; le cinéma serait « chaud », mais la télévision « froide » à cause de sa faible définition (mais l'on ne sait si elle est devenue « chaude » depuis qu'elle est en « haute définition »)… En outre, l'effet supposé différent des médias « chauds » et « froids » — effet supposé fonder la pertinence de cette distinction — est quant à lui entièrement laissé à l'appréciation de l'analyste : la « participation » plus grande impliquée par les médias « froids » n'est absolument pas mesurée de façon scientifique mais seulement illustrée par des exemples « frappants » mais faiblement étayés, gommant systématiquement la complexité des situations historiques évoquées (ainsi, selon McLuhan, l'imprimerie serait responsable des guerres de religion au 16e siècle…[3]). Rien ne permet par exemple d'affirmer que la vision d'un film à la télévision induit une plus grande participation que dans une salle de cinéma : cette participation dépend peut-être du média mais également du film, des spectateurs, du fait d'être seul ou en groupe, de l'humeur de chacun… Ainsi, les intuitions de McLuhan, souvent admirées, ont également été l'objet de nombreuses critiques à cause de leur imprécision et de leur caractère faiblement démonstratif [4].
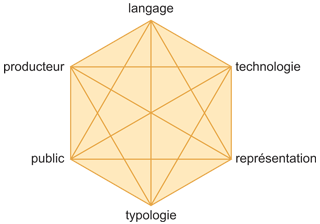
Les six thématiques de l'éducation aux médias
selon Len Masterman du British Film Institute
Si l'on examine par ailleurs les concepts proposés dans ce champ de connaissances (par exemple le schéma classique de la communication de Jakobson qui distingue six facteurs essentiels : le message, l'émetteur, le récepteur, le code, le contact et le contexte ; ou bien « l'hexagone » des médias de Len Masterman avec six composantes des médias : le langage, la technologie, les représentations, le public, le producteur et la typologie), ils sont essentiellement de nature descriptive et ne permettent pas d'articuler ces composantes, ni d'en comprendre le sens ou le fonctionnement : ainsi, si l'on veut étudier l'effet d'un média sur le public, on devra recourir à des schèmes d'interprétation ou d'explication qui seront extérieurs au champ lui-même, qu'il s'agisse de la psychologie (commune ou scientifique), si l'on s'intéresse plutôt aux réactions individuelles des récepteurs, ou de la sociologie, si l'on préfère comprendre les effets de « masse » sur différents groupes de récepteurs.
Par ailleurs, les médias constituant une réalité empirique, historiquement variable, on voit apparaître de nouveaux « objets » qui révèlent les limites de ces premières tentatives de conceptualisation : ainsi, dans le domaine du cinéma, les notions classiques de travelling et de panoramique (liés à l'usage d'une caméra sur pied) sont incapables de décrire l'usage multiforme du steadicam (un harnais permettant de porter une caméra avec fluidité et une grande liberté de mouvement) ; et, si le schéma de la communication permet sans doute de décrire sommairement l'utilisation du téléphone mobile (et d'insister sur la fonction « phatique »), il ne peut évidemment expliquer son extraordinaire popularité. Enfin, les jeux vidéos au succès croissant font littéralement exploser la notion de « communication médiatique » en impliquant de façon tout à fait nouvelle le joueur qui n'est plus un simple spectateur ou récepteur mais un acteur d'une interaction dont le « moteur » n'a sans doute plus rien à voir avec une « intention de communiquer »…
On remarquera encore à ce propos que l'on retrouve par rapport à ce même objet d'études — les médias — des approches concurrentes sinon conflictuelles : différentes « sciences » ou différents savoirs comme la sémiotique, la pragmatique (et ses variantes), la sociologie mais aussi la psychologie ou encore l'histoire peuvent prétendre être les plus aptes ou les mieux outillés pour rendre compte, en tout ou en partie, des phénomènes médiatiques, anciens ou nouveaux. (C'est le cas notamment des compétitions sportives, objet médiatique par excellence, qui relèvent pourtant beaucoup plus de l'analyse sociologique que d'une analyse de type proprement médiatique. [5])
Sans prendre position dans ces querelles théoriques qui sont sans aucun doute légitimes au niveau de la recherche universitaire, on voit néanmoins qu'il est difficile de proposer une approche unique des médias en situation scolaire ou d'éducation (on ne considérera ici que l'enseignement obligatoire censé assurer une base commune de connaissances et de compétences à tous) : ainsi, l'apprentissage de l'écriture et de la lecture restera certainement une activité largement autonome, exigeant une formation et un entraînement spécifiques, souvent longs et difficiles, et ne pourra certainement pas se fondre dans la nébuleuse de l'éducation aux médias, alors qu'il s'agit pourtant là — l'écrit — du plus ancien et du plus complexe des médias…
Les thèses de McLuhan ont exercé une grande fascination sur les esprits sans doute parce qu'elles rompaient avec le sens commun et proposaient un point de vue original, simple et unificateur, sur une « réalité » à la fois massive et multiforme. Par ailleurs, pour les nouveaux « spécialistes » des médias, le renversement de perspective proposé — the medium is the message — légitimait leur domaine d'analyse et ouvrait un champ d'investigation supposé spécifique, différent de celui des autres sciences humaines.
Mais un tel renversement de perspective ne suffit pas à fonder une théorie, car il repose sur une opposition conceptuelle faiblement pensée entre les « médias » et leur supposé « message », opposition qui, comme celle de la « forme » et du « contenu », est toujours floue et malléable. D'un côté, cela permet d'étendre, comme on l'a vu, de façon indéfinie le domaine des médias et d'y englober à la limite toute relation sociale ; et, de l'autre, de discréditer toute approche qui ne tiendrait pas compte de la dimension « spécifiquement » médiatique et qui s'intéresserait de façon privilégiée au « sens » ou au « contenu » en négligeant la forme ou le média considérés comme « essentiels ». Ainsi par exemple, à cause de cet a priori « formaliste », la critique historique des sources sera rarement considérée comme une analyse médiatique pertinente alors qu'il s'agit sans doute d'une des premières réflexions sur les médiations (au sens le plus fort du terme) qu'impliquent les documents écrits ; semblablement, une analyse centrée sur le scénario d'un film sera facilement accusée de négliger l'aspect « proprement » cinématographique qui résiderait essentiellement dans les positions ou les mouvements de caméra, le montage ou la bande-son ; ainsi encore, les spécialistes des médias s'estimeront facilement aptes à juger de la validité, de la vérité ou de la légitimité d'une représentation médiatique sans recourir à des savoirs spécialisés (sociologie, psychologie, histoire…) perçus comme non pertinents ou inutiles.

Cyrano de Bergerac de Jean-Paul Rappeneau
Le renversement de perspective proposé représente un parti pris sans doute légitime d'un point de vue épistémologique — « considérons les médias indépendamment de leur contenu » — mais ne peut en aucune manière être considéré comme une vérité établie de façon empirique ni même principielle : si McLuhan multiplie les exemples en faveur de sa thèse, cette accumulation ne vaut évidemment pas démonstration, et il ne serait pas difficile de trouver des faits qui contredisent son affirmation. Ainsi, de manière prudente, l'on constate que les productions au sein d'un même média — par exemple les différents films qui passent dans les salles de cinéma, les différentes séries télévisuelles ou les différents jeux vidéos sur la même console — connaissent des succès très variables qui ne peuvent s'expliquer que par des « contenus » différents ; en outre, on sait par plusieurs enquêtes que les publics sont eux-mêmes extrêmement variés et qu'ils ne réagissent pas de manière uniforme aux mêmes représentations médiatiques, et il est donc difficile d'étudier « l'effet » des médias sans une véritable sociologie et/ou psychologie [6] des publics ; enfin, il n'est pas sûr que le passage d'un média à l'autre — du théâtre au cinéma, du cinéma à la télévision, de la télévision à l'écran d'ordinateur… — modifie de façon essentielle la perception qu'en auront les différents spectateurs : le public qui a fait par exemple le succès du Cyrano de Bergerac de Jean-Paul Rappeneau en 1990 est-il fondamentalement différent de celui qui a applaudi à la pièce d'Edmond Rostand, un siècle auparavant ? Et a-t-il d'abord été sensible à la mise en images cinématographique avant d'être touché par le verbe de l'écrivain français ? On peut en douter [7].
Il ne s'agit évidemment pas de renverser la proposition de McLuhan en prétendant désormais que seul importe le « contenu » mais plutôt de reconnaître que les « objets » médiatiques comportent plusieurs dimensions (« forme », « contenu », « images », « sons », « texte »…) qui se relient elles-mêmes à d'autres réalités hétérogènes (celle qui fait l'objet d'une représentation directe ou indirecte, mais également la diversité des spectateurs et le pôle de « l'émetteur ») : il en résulte une interaction complexe qui n'a rien de « mécanique » et qui doit chaque fois être analysée de manière singulière.
Aucune approche ne peut donc être disqualifiée a priori, et il n'existe pas de point de vue privilégié ni de démarche spécifique qui devrait être systématiquement adoptée dans l'abord des « objets » médiatiques. Dans une situation pédagogique, qu'il s'agisse d'une réflexion sur un film, une émission télévisuelle, un jeu vidéo, un site web ou un morceau musical [8], il paraît donc préférable d'adopter une démarche interdisciplinaire qui tienne compte des spécificités de « l'objet » médiatique mais également des intérêts divers des participants et de leurs éducateurs éventuels. Et, dans le cadre proprement scolaire, il paraît prématuré — à notre estime — de promouvoir (au niveau de l'enseignement obligatoire) une nouvelle discipline ou un nouveau cours spécifiquement consacré aux médias alors que les approches, les méthodes, les objectifs et plus encore les évaluations sont aujourd'hui en ce domaine trop incertains, trop divers et trop faiblement étayés.
Face aux ambitions (sans doute démesurées) de cette nouvelle éducation aux médias, la réflexion pédagogique sur le cinéma s'est souvent retrouvée dans une position défensive, comme menacée de disparition, cherchant dès lors à défendre la spécificité ou l'originalité de son objet. C'est dans ce contexte qu'en France notamment (particulièrement impliquée dans la protection de sa production cinématographique et de son « exception culturelle »), des voix se sont élevées pour défendre l'idée que le cinéma doit avant tout être considéré comme un art [9] et non pas comme un simple objet médiatique ou de « culture » (au sens le plus large du terme).
Dans une perspective éducative, cette affirmation — pour laquelle on peut éprouver de la sympathie — paraît cependant maladroite, car elle présuppose une conception commune, largement partagée, de ce que sont ou seraient l'art et le cinéma. Or l'art (comme d'ailleurs les médias) est un objet historiquement constitué aux limites incertaines, à la définition floue, résultat de combats (symboliques) et de confrontations multiples, et dont il paraît difficile d'imposer une conception unique [10], nécessairement arbitraire en situation pédagogique. Quant au cinéma, malgré les apparences d'un système de production, de réalisation et de consommation relativement autonome au sein de l'ensemble de l'univers des médias, il est également le lieu de conceptions multiples, parfois contradictoires, et il n'est pas sûr qu'une approche artistique (mal définie) soit nécessairement la plus appropriée face à la diversité des films visibles : le cinéma est également, qu'on le veuille ou non, un lieu de distraction mais aussi un moyen d'information, de persuasion et plus largement un système de représentation qu'on ne peut sans doute pas réduire à la seule dimension artistique [11].
En outre, cette approche isole de façon relativement arbitraire le cinéma des autres médias (dont on suppose alors implicitement qu'ils ne peuvent pas prétendre au statut d'art) et néglige les interactions complexes entre ces différentes réalisations. Or, d'une part, certaines productions médiatiques (on peut penser par exemple aux nouvelles séries télévisuelles américaines comme The Wire ou The Sopranos) méritent certainement une approche en termes d'esthétique ; et, d'autre part, le cinéma, loin de se développer de façon autonome, prend position (au sens le plus fort du terme) dans un contexte qui est largement façonné par les différents médias : il suffit de penser à des réalisateurs comme Ken Loach ou les frères Dardenne et bien d'autres qui proposent précisément un autre point de vue sur la « réalité » construite par ces médias, et qui vont questionner chez les spectateurs ces images largement intériorisées. Dans ces conditions, il peut sembler arbitraire sinon maladroit de vouloir imposer un point de vue aussi restrictif sur le cinéma, en s'appuyant sur des concepts mal assurés (« l'art ») et des jugements de valeur implicites [12].
En outre, une telle approche creuse un fossé en apparence infranchissable entre le cinéma et les autres médias (supposés non artistiques), renvoyant ainsi à deux systèmes d'enseignement ou d'éducation qui devraient être fondamentalement différents. Si l'on peut admettre qu'une telle spécialisation soit nécessaire au niveau d'un enseignement supérieur ou professionnalisant, elle paraît beaucoup moins pertinente pour des spectateurs (jeunes ou moins jeunes) qui n'ont pas vocation à devenir des professionnels du cinéma, et il est sans doute nécessaire de déterminer quelle place le cinéma occupe au sein des médias, même si cet « univers » est, comme on l'a dit, flou et peu homogène. Comment dès lors articuler éducation au cinéma, éducation à l'audio-visuel, éducation à l'image, éducation aux médias… ? Si l'on réfléchit en particulier en termes de compétences et de capacités à transférer les savoirs éventuellement acquis dans un domaine particulier, on doit se poser la question de la place de l'éducation au cinéma dans l'enseignement et au sein de ses différentes disciplines (notamment artistiques, mais aussi la langue maternelle, ou l'éducation aux médias…) : y a-t-il des compétences communes à mettre en œuvre dans l'abord des différentes productions audiovisuelles, du cinéma, des différents genres cinématographiques [13], mais également de la littérature et des autres arts ?

Le Fils de Jean-Pierre et Luc Dardenne
© Christine Plenus
La compréhension des productions médiatiques (on n'abordera pas pour l'instant la question de la réalisation) suppose vraisemblablement de multiples compétences, certaines simples et d'autres plus complexes, les unes acquises précocement et d'autres tout au long de la vie. Si l'on considère un domaine relativement circonscrit et bien connu comme celui de l'écrit, l'on s'aperçoit facilement que sa maîtrise suppose des compétences fondamentales, nécessaires à tous les genres d'écrits (comme être capable de déchiffrer les caractères ou d'établir les relations anaphoriques), mais que la diversité des textes suppose également des compétences spécifiques acquises progressivement au cours des cursus individuels, parfois de manière partielle. Ainsi, la lecture d'un article de journal ne nécessite certainement pas les mêmes dispositions que celle d'un roman, d'un ouvrage juridique, d'un traité philosophique ou d'un recueil de poèmes. Dans ce dernier cas, on peut même avancer que la poésie du 18e siècle suppose une autre « attitude » de lecture que la poésie contemporaine [14]. Semblablement, les enfants aujourd'hui voient très jeunes, que ce soit à la télévision ou en salle de cinéma, des dessins animés dont ils ont sans doute une compréhension minimale, mais les schèmes de réception acquis précocement et souvent de façon spontanée, qui leur permettent d'apprécier ces premiers films, ne suffiront sans doute pas pour comprendre des œuvres plus ambitieuses, à la chronologie bousculée (comme Citizen Kane d'Orson Welles), à l'intrigue ambiguë ou ambivalente (Lost Highway ou Mulholland Drive de David Lynch), au propos complexe et peu explicité (Pierrot le fou de Jean-Luc Godard, Le Ventre de l'architecte de Peter Greenaway, Elephant de Gus Van Sant) ou à l'esthétique inhabituelle (Rosetta ou Le Fils des frères Dardenne, Le Goût de la cerise d'Abbas Kiarostami).
Il est donc difficile d'envisager une compétence unique et homogène, qui devrait être mise en œuvre dans l'abord de toutes les productions audiovisuelles. On doit au contraire supposer que les spectateurs disposent de compétences multiples, certaines relativement spécifiques et d'autres transversales (au sens où elles sont requises dans des domaines plus ou moins éloignés les uns des autres), les unes acquises précocement et d'autres plus tardivement, mais dans l'ensemble pour l'instant mal connues et mal définies [15]. De manière exploratoire, l'on proposera néanmoins ici une réflexion sur une « stratégie » de réception qui est, semble-t-il, nécessaire dans l'approche de toute production de type médiatique mais qui tient compte également de la spécificité de chacune d'entre elles (et donc en particulier de celle du cinéma).
Aujourd'hui, les enfants pénètrent spontanément dans l'univers des médias, essentiellement par le biais de l'image (puisque l'écrit suppose quant à lui un apprentissage beaucoup plus long), le plus souvent à travers la télévision (présente dans plus de 90% des foyers européens) mais également l'ordinateur (dont plus de 60% des ménages français ou belges sont aujourd'hui équipés) ou encore la photo imprimée (dans la presse et les magazines notamment). De manière intuitive, les enfants perçoivent sans aucun doute très tôt une différence entre les médias et la réalité quotidienne qui les entoure : s'ils reconnaissent précocement l'image de certains « objets » (êtres humains, animaux, paysages, habitats…) grâce aux schèmes de perception de la réalité qu'ils élaborent au cours des premiers mois et des premières années de leur existence [16], ces mêmes schèmes leur permettent également de distinguer ces représentations des objets réels. Ils peuvent reconnaître un chat ou un chien à la télévision mais ils comprennent aussitôt qu'ils ne peuvent pas le saisir à l'écran ; semblablement, ils appréhendent très tôt « la permanence de l'objet », et ils savent qu'ils peuvent retrouver le jouet qui a disparu de leur champ de vision, mais ils s'apercevront aussi rapidement que les « objets » à la télévision n'ont quant à eux aucune permanence et peuvent disparaître sans qu'on puisse jamais les récupérer… Ils n'iront pas chercher derrière l'écran leur héros favori, et ils devineront rapidement que l'animal dont ils ont entendu le cri n'est pas présent dans la pièce…
Il est donc certainement faux de prétendre que les enfants ne distinguent pas la « réalité » et les « représentations médiatiques », car les schèmes de perception acquis précocement suffisent à différencier l'image à l'écran des objets « réels », que ce soit ceux du monde environnant ou ceux représentés de façon imagée. Néanmoins, on devine aussi que cette différenciation reste souvent sommaire, schématique et faiblement explicitée. Au fil du temps, des expériences et de l'éducation, les enfants apprendront à distinguer progressivement un dessin animé d'un film en prises de vue réelles, un conte fantastique d'un récit à prétention réaliste, une fiction d'un reportage, une reconstitution d'un documentaire authentique… Il s'agit certainement là d'un processus « ouvert », en évolution constante et qu'on ne peut jamais considérer comme définitivement acquis.

Dead Man de Jim Jarmusch,
un western atypique
On a reconnu depuis longtemps, dans l'enseignement de la langue maternelle, qu'identifier différents types ou différents genres de « textes » était une compétence indispensable, mais on en a souvent limité la portée en ne prenant en considération que quelques catégories fondamentales comme le texte narratif, poétique, argumentatif, dramatique, etc. En outre, les analystes ont souvent été tentés par une approche formaliste, visant à définir des critères de différenciation décisifs, anhistoriques et transculturels [17] : si une telle approche se justifie sans doute d'un point de vue théorique (qui peut s'éloigner largement du sens commun), elle ne correspond pas nécessairement aux processus réellement mis en œuvre par les différents lecteurs (ou plus largement par les « consommateurs » de médias). La psychologie cognitive a montré en effet que la pensée courante ne recourt généralement pas à des ensembles logiques ou à des catégories formelles mais plutôt à des représentations approximatives où un exemplaire jugé significatif d'une classe « vaut » pour l'ensemble de cette classe [18] : c'est ainsi que, dans un dialogue quotidien sur les « oiseaux », on se référera au moineau ou à l'hirondelle plutôt qu'au goéland ou au pingouin, et l'on s'étonnera dès lors d'une phrase comme « j'ai été bousculé par un oiseau » (qui serait pourtant vraisemblable si l'oiseau en question était une autruche…). Et, quand on évoque le « western », l'on pensera plus facilement aux films de John Ford (si l'on est quinquagénaire…) ou à True Grit des frères Coen (2011) (si l'on est plus jeune…) qu'à Dead Man de Jim Jarmusch (1995) ou à Jeremiah Johnson de Sydney Pollack (1975) qui seront certainement jugés moins « typiques », car sans désert, ni poussière, ni shérif…
En outre, quelques grandes catégories ne suffisent pas à décrire la diversité des productions culturelles ni à nous orienter dans un paysage médiatique pléthorique et en constante évolution : nous sommes obligés, pour parler de cinéma, d'art, de télévision, de musique ou de spectacles de toutes sortes, d'utiliser des concepts approximatifs, faiblement formalisés, flous, ambigus et souvent polémiques… Il est en effet impossible de définir avec précision des notions comme l'art classique, le symbolisme, le cinéma hollywoodien, un soap opera, un film d'amour, le rap, un jeu « GTA-like », le free jazz, une « installation » (artistique)… De telles notions rendent sans doute mal compte des réalisations socioculturelles qu'elles évoquent et qui sont toujours diverses et en évolution, mais ce sont aussi les « mots de la tribu » indispensables pour pouvoir dialoguer avec nos contemporains et simplement parler du monde qui nous entoure.
Enfin, ces concepts, à la fois flous et indispensables, ne peuvent pas être utilisés sans une connaissance concrète et individuelle des réalités évoquées : ainsi, je peux expliquer longuement à un (jeune) interlocuteur ce qu'est un thriller, mais ces explications ne lui permettront jamais de s'en faire une idée aussi précise que la vision d'un seul film de ce genre. Semblablement, un exposé sur la peinture impressionniste n'aura aucun sens si l'on n'a jamais vu un tableau de Monet, de Renoir ou de Degas, et il est impossible de se faire une idée — même vague — de l'opéra italien sans voir ni écouter un opéra de Rossini ou de Puccini. On pourrait objecter que cette difficulté est liée au passage d'un média (l'image, le son) à un autre (la parole), mais cela vaut également à l'intérieur d'un même « média » : une leçon sur la littérature réaliste restera tout à fait « abstraite », « théorique », creuse, si elle ne s'accompagne pas de la lecture de quelques romans (ou au minimum d'extraits) de Flaubert, de Maupassant ou des frères Goncourt [19].
Comprendre les « médias » ou les « représentations médiatiques » implique donc une maîtrise des différents genres, notions, catégories, types, ensembles, historiquement variables, conceptuellement imprécis mais indispensables pour se représenter la « géographie » diverse de ces productions. On pourrait penser cependant qu'il s'agit là de simples connaissances empiriques, qui s'acquièrent progressivement et qui ne constituent donc pas une « compétence » au sens propre du terme [20] ; mais un peu de réflexion révèle qu'une telle catégorisation suppose bien la mise en œuvre de multiples procédures, certaines simples et d'autres plus complexes, ainsi que la mobilisation de différents savoirs qui doivent être combinés de façon non automatique. Essayons d'éclairer ce point.
Lire un livre, voir un film, regarder une émission de télévision… implique qu'on situe ces productions dans l'ensemble de nos savoirs sur le monde et plus particulièrement du paysage audiovisuel, et cela pour pouvoir juger notamment de son originalité, de sa pertinence, de son statut et de son sens en général [21]… De façon sommaire et en première approche, on pourrait comparer ce processus de catégorisation avec un phénomène comme la dégustation de vins : pour une personne novice en ce domaine, il n'y a guère que deux ou trois grandes catégories (vin blanc, vin rouge… et rosé) ; en revanche, un amateur éclairé est capable de distinguer différents vins selon leurs cépages mais également selon leurs terroirs et même leurs millésimes. Bien entendu, un tel savoir s'acquiert progressivement, par une pratique de dégustation répétée (même si elle s'accompagne très généralement de la maîtrise d'un vocabulaire technique), et reste très variable selon les connaisseurs. Semblablement, un cinéphile est capable d'identifier un grand nombre de films différents, de distinguer des genres et des auteurs, de faire des nuances entre les œuvres d'un même cinéaste en fonction du moment de sa carrière où elles ont été réalisées. Un « amateur » est précisément celui qui est capable d'établir des distinctions dans un ensemble de productions perçues par d'autres de façon confuse comme un genre indistinct. C'est le cas pour des domaines prestigieux comme la peinture ou la musique classiques, mais aussi pour d'autres beaucoup moins célébrés sinon même dénigrés comme le cinéma fantastique ou les mangas japonais : ceux-ci par exemple ont eu pendant plusieurs décennies une mauvaise réputation en Occident où ils étaient perçus comme tous foncièrement semblables, fabriqués « à la chaîne » et sans « originalité » ; seuls quelques connaisseurs ont alors souligné la diversité de ces bandes dessinées, mis en évidence leurs différents genres et distingué leurs meilleurs auteurs.

La Traversée du temps de Mamoru Hosoda
un manga japonais qui se distingue de la production courante
Dans une perspective « génétique », on peut également penser que les enfants ne maîtrisent d'abord que quelques grands genres ou grands types de productions médiatiques (comme le dessin animé), mais qu'ils vont ensuite faire des distinctions plus fines à l'intérieur de ces genres mais également découvrir d'autres types de productions, en acquérant ainsi une connaissance progressive de la diversité du paysage médiatique. Ainsi, il est sans doute légitime d'un point de vue éducatif de faire découvrir aux jeunes spectateurs (mais aussi aux moins jeunes) des réalisations qu'ils méconnaissent spontanément parce qu'elles sont marginalisées par les systèmes dominants de diffusion : l'éducation aux médias implique, pour une part, une ouverture vers ces productions généralement négligées, qu'il s'agisse par exemple du cinéma d'art et essai, de formes artistiques « minoritaires », d'œuvres littéraires plus « difficiles » ou moins connues, d'auteurs, réalisateurs ou artistes peu célébrés ou provenant de régions perçues comme secondaires ou marginales. On soulignera encore une fois, même si c'est une évidence, que la connaissance de tous ces domaines ne peut se faire que concrètement, par la vision, la « consommation » ou la réception des réalisations en cause. Il ne peut y avoir de « connaissance » des médias sans une véritable découverte de la diversité de leurs productions.
Mais la comparaison avec la dégustation de vins risque rapidement de devenir réductrice. Un amateur en ce domaine ne s'appuie en effet que sur quelques critères limités, à savoir l'apparence du vin (sa couleur, sa transparence, son adhérence au verre), ses parfums et son goût, même si ces critères se différencient de manière extrêmement fine. En revanche, situer une production dans l'ensemble du paysage médiatique suppose la mise en œuvre d'un grand nombre de critères plus ou moins hétérogènes. Ainsi, on repère un film comme fantastique à de nombreux indices, principalement le récit raconté, mais aussi à d'autres éléments de mise en scène comme l'utilisation de la couleur ou des lumières (« inquiétantes »), à certains clichés ou stéréotypes (comme la simple évocation par un comparse de revenants ou de lieux hantés) ou encore au style de l'affiche. En outre, l'identification peut être multiple et se référer à plusieurs catégories qui se recouvrent sans cependant s'emboîter (comme l'est une taxinomie scientifique qui classe les animaux en espèces, formant des genres, puis des familles, des ordres, etc.) : Sleepy Hollow par exemple sera considéré comme un film de fiction mais aussi comme un conte fantastique (qui pourrait se présenter sous forme de roman ou de bande dessinée) ou encore comme une œuvre de Tim Burton (si on la situe dans la carrière de ce cinéaste) ou enfin comme une réalisation post-moderne (dans une perspective esthétique), c'est-à-dire que ce film appartient à des ensembles relativement hétérogènes et en principe non dénombrables… L'attribution d'une production à l'une ou l'autre catégorie dépend donc des compétences culturelles du spectateur capable de convoquer un plus ou moins grand nombre de « genres » médiatiques.
Enfin, ces processus de catégorisation, loin de se réduire à une simple identification (« c'est un film fantastique ») induiront des attentes et des modes de réception plus ou moins élaborés : ainsi, lorsqu'on reconnaît une production médiatique (texte écrit, film, émission télévisuelle…) comme une fiction (et non comme un documentaire, un reportage, un fait-divers journalistique ou un ouvrage historique), on suspend temporairement les critères habituels de vérité, et l'on fait semblant [22] pendant la durée de la lecture du roman de Flaubert ou de la projection du film de Claude Chabrol que Mme Bovary a pu exister dans la province française du 19e siècle, même si l'on sait par ailleurs qu'il s'agit d'un personnage littéraire né — au moins en partie — de l'imagination de son auteur. Autrement dit, l'attribution d'un genre implique la mise en œuvre de stratégies de réception relativement spécifiques et adaptées à ce genre. C'est ainsi encore que, dès que l'on perçoit dans une réalisation des indices de parodie, l'on essaie de reconnaître d'autres éléments qui peuvent être interprétés dans la même perspective, et d'identifier les différentes œuvres ou productions ainsi parodiées.
De manière générale, il ne faut pas concevoir l'attribution d'un genre ou d'une catégorie comme une identification stricte sur base de critères explicites et dénombrables mais bien plutôt comme un processus d'interprétation largement ouvert, reposant sur des inférences peu définies et faisant appel à un éventail de savoirs imprévisibles. L'exemple des tromperies médiatiques, qu'il s'agisse de courriels frauduleux (phishing), de canulars ou de légendes urbaines (hoaxes), révèle à la fois comment les différents genres médiatiques reposent sur des normes implicites qui guident l'interprétation spontanée des lecteurs ou spectateurs (en particulier selon le principe qui suppose que « l'énonciateur » est censé parler sérieusement et garantir la véracité de ce qu'il affirme), et comment les spectateurs les moins avertis, disposant du moins de ressources culturelles, seront dès lors le plus facilement victimes de ces tromperies : ainsi, quand la télévision belge francophone a annoncé lors d'une émission spéciale [23] que la Flandre venait de proclamer unilatéralement son indépendance, beaucoup de spectateurs ont été abusés car ils se sont fié aux indices habituels du journal télévisé (en particulier la présence du journaliste « vedette » de cette émission) en négligeant certains signes moins visibles (le mot fiction est plusieurs fois prononcé de façon ambiguë puis finalement affiché au bas de l'écran), mais ceux qui avaient une connaissance suffisante du monde politique et du système parlementaire belges [24] ont très rapidement constaté le caractère invraisemblable de cette nouvelle, cette invraisemblance étant alors confirmée par ces mêmes indices négligés par les autres spectateurs. Dans ce cas, on voit d'ailleurs que ce sont des connaissances extérieures au « système » médiatique et portant sur la « sociologie » du monde politique qui constituaient sans doute le meilleur « outil » pour découvrir la supercherie [25].
L'identification d'un « genre » se présente donc comme un processus complexe, largement ouvert et demandant une véritable « compétence » pour ne pas être erronée, sommaire ou unilatérale. Néanmoins, les différents cas évoqués jusqu'à présent reposent essentiellement sur ce que le psychologue Jean Piaget appelait une « assimilation » à des schèmes — ici des catégories génériques — déjà installés et maîtrisés : « l'objet » inédit est reconnu grâce à la « plasticité » de ces schèmes. La nouveauté peut cependant être suffisamment importante pour nécessiter une « accommodation » (dans la terminologie piagétienne), c'est-à-dire une modification importante et un réarrangement des catégories déjà installées. On peut prendre comme exemple d'un tel processus la différenciation progressive entre la « réalité » [26] et la représentation de la réalité : on a déjà dit que les enfants vraisemblablement maîtrisent relativement tôt la différence de nature entre les objets qu'ils voient à l'écran et le monde qui les entoure, mais cette différence reste évidemment très sommaire. Parmi les images qui leur sont proposées, ils vont ensuite apprendre à distinguer les représentations de choses ou d'événements réels (les reportages, les documentaires…) et celles qui appartiennent à l'imaginaire (les contes, les histoires fantastiques…) Mais la catégorie même de fiction est relativement complexe, car elle traverse différents médias (un conte oral peut être perçu comme une fiction), mais ne repose pas sur des critères explicites ou visibles (puisqu'il s'agit essentiellement d'une convention pragmatique de « feintise » [27]), même si un certain nombre d'indices permettent généralement de repérer le caractère fictionnel de certaines représentations ou productions. Ainsi, le début traditionnel des contes (« Il était une fois… »), l'aspect « irréaliste » des dessins animés [28], la description littéraire des états intérieurs (pensées, sentiments) de personnages nommés à la troisième personne, le discours indirect libre ou des infractions dans l'utilisation des temps verbaux (« Mais le matin il lui fallait élaguer l'arbre. Demain, c'était Noël ») [29] ou, au cinéma, l'évitement constant par les personnages à l'écran du regard à la caméra [30] (alors que, dans un reportage ou un film amateur, les personnes ont tendance à s'adresser à la caméra) révèlent au lecteur ou spectateur averti qu'il se trouve bien dans un univers de fiction, et que personnages, faits et événements ne doivent pas être considérés comme authentiques. Des connaissances extérieures permettent également de complexifier la conception première de la fiction, et l'on sait (ou l'on apprend) par exemple que le tournage d'un film de fiction se déroule de façon très différente de celui d'un documentaire, puisqu'on demande dans le premier cas à des acteurs d'interpréter des personnages, de répéter des scènes jusqu'à ce qu'elles soient réussies, de prendre place éventuellement dans des décors spécialement construits pour l'occasion, de se plier parfois à des « effets spéciaux », bien que tout ce processus de réalisation — totalement artificiel — n'apparaisse pas en tant que tel à l'écran : si un enfant ne s'étonne pas de voir à l'écran des événements qui n'auraient pas pu être « normalement » filmés, le spectateur prend bientôt conscience de la présence « invisible » de la caméra et de la dimension de mise en scène (au sens le plus fort du terme) des événements représentés. Ainsi, la dimension spectaculaire de nombreuses réalisations hollywoodiennes sera reconnue et appréciée en tant que telle par la plupart des spectateurs adolescents, familiers des « effets spéciaux » et autres trucages de plus en plus élaborés (notamment grâce aux outils informatiques qui ont sans doute mis fin à ce qu'André Bazin a cru être le réalisme foncier de l'image photographique).

Rosetta de Jean-Pierre et Luc Dardenne
un personnage « réaliste »
Mais la notion de fiction, qui se construit, comme on le voit, à travers différentes stratégies qui ne sont pas réductibles les unes aux autres [31], devra encore s'adapter à des réalisations qui amèneront le public (plus ou moins averti) à nuancer ou à complexifier des partages trop simples et trop tranchés : ainsi, les fictions « réalistes » — depuis les romans de Balzac jusqu'aux films de Maurice Pialat, de John Cassavetes ou de Ken Loach — ne peuvent pas être reçues comme de purs produits de l'imagination de leurs auteurs (comme un conte ou un récit fantastique) et entretiennent des rapports indirects avec le monde environnant. Si Rosetta, héroïne éponyme du film des Dardenne (1999), n'existe pas en tant que telle, on devine néanmoins que le personnage comporte une série de traits qui sont « empruntés » à la réalité, même s'il est difficile de faire un partage exact entre les éléments qui relèvent exclusivement de la fiction (et donc de l'imagination de ses auteurs) et d'autres que l'on pourrait considérer comme authentiques, résultant d'une véritable observation : ainsi, il peut y avoir une discussion pour savoir si le personnage est réellement représentatif d'un groupe social (le « quart-monde » ou les populations paupérisées en Occident) ou s'il est au contraire relativement exceptionnel notamment dans sa volonté farouche de décrocher un emploi à n'importe quel prix [32]. La notion même de fiction réaliste va donc imposer une redéfinition du partage entre représentation (supposée) véridique et fiction imaginaire, cette dernière pouvant même prétendre [33] atteindre par d'autres voies à une « vérité » plus grande ou différente de celle de l'histoire, du documentaire ou du reportage.
L'histoire même des genres et des productions médiatiques impose en outre des redéfinitions de toutes sortes, et l'on a vu ainsi récemment apparaître, dans le champ télévisuel et cinématographique, entre le documentaire et la fiction, des « docu-fictions » qui mêlent récit supposément authentique avec des images reconstituées avec une certaine vraisemblance même s'il est très difficile de faire la part exacte des choses : la plupart des spectateurs estimeront qu'une série télévisuelle comme Rome (réalisée notamment par John Milius, William J. MacDonald et Bruno Heller en 2005-2007) propose une image beaucoup plus « réaliste » sinon naturaliste de la vie quotidienne dans la cité antique que la tradition du peplum italien ou hollywoodien, mais seul un historien est sans doute capable de repérer les erreurs historiques et même les simples invraisemblances (les patriciennes romaines étaient-elles toutes des débauchées manipulatrices ? Le non-spécialiste sera bien en peine d'en décider sans sources extérieures).
On remarquera d'ailleurs que ces objets « hybrides» ou « ambigus » peuvent susciter certaines incompréhensions. Les spectateurs peu informés peuvent ainsi croire, face à des films à vocation réaliste (comme les films de Ken Loach ou des frères Dardenne), que les acteurs sont obligés d'endurer les épreuves des personnages qu'ils incarnent, par exemple prendre des coups ou être affectés par la même maladie ou le même handicap que ces personnages [34] : s'ils sont conscients qu'il s'agit bien globalement d'une fiction, ils perçoivent néanmoins l'exigence réaliste comme devant interdire pratiquement tout trucage, tout maquillage et toute distance au rôle. Une telle confusion peut d'ailleurs être appuyée par certains reportages sur le tournage de ce type de films, insistant sur la « mise en condition » des acteurs qui seraient obligés de « vivre » la vie même de leurs personnages pour atteindre à une réelle authenticité, l'interprétation se transformant alors en performance sinon en épreuve émotionnelle. Les processus de redéfinition (ou d'accommodation au sens piagétien) des catégories génériques peuvent donc être relativement longs et complexes, demandant notamment de nouvelles prises d'informations, entraînant parfois de véritables « révolutions » conceptuelles (comme ce fut le cas avec l'avènement d'Internet dans le champ des médias).
Enfin, lorsqu'on rapporte une réalisation médiatique à un genre auquel elle est censée appartenir, l'identification implique sans doute la reconnaissance de certains traits génériques, mais elle entraînera également la prise en compte des caractéristiques originales qui font la singularité de cette réalisation : alors que toutes les bouteilles d'une même cuvée délivrent en principe le même vin, l'amateur de westerns, de jeux vidéos, de bandes dessinées, de cinéma d'auteur, d'installations artistiques ou même de compétitions sportives, s'attend à découvrir de nouvelles productions qui conservent sans doute des éléments de son genre de prédilection mais qui présentent également suffisamment d'originalité pour justifier son intérêt répété [35]. Cette originalité peut être limitée, par exemple avec un nouvel épisode d'une série (qu'il s'agisse de télévision, de bandes dessinées ou de remakes au cinéma), ou beaucoup plus importante (si l'on considère par exemple la carrière de cinéastes comme Carl Dreyer ou Stanley Kubrick abordant des genres extrêmement différents), mais elle constitue un élément essentiel de toute réception médiatique et en particulier du plaisir qu'on y trouve [36].
Mais déterminer l'originalité d'une réalisation n'est pas un processus simple, car les objets à comparer sont souvent « complexes », comprenant de multiples dimensions et organisés de façon structurelle : cela suppose une analyse « interne » de cette réalisation nouvelle — par exemple, dans le cas d'un film, du récit, de la construction des personnages, du travail de mise en scène, du sens local et global, des différents aspects esthétiques… — dont les différents éléments seront ensuite mis en relation avec un paysage médiatique a priori illimité et très diversifié — on peut ainsi inscrire un film dans l'histoire du cinéma mais également de la littérature ou bien des idées, de la philosophie et de la culture en général —. Pour faire apparaître l'originalité de films comme Citizen Kane d'Orson Welles (1941) ou Voyage en Italie de Roberto Rossellini (1954), des critiques comme André Bazin ou Jacques Rivette ont dû mener une véritable analyse de ces œuvres, souligner des aspects qui avaient été négligés par les autres critiques, dégager un propos ou un projet esthétique resté inaperçu, s'interroger sur des éléments (notamment de mise en scène) négligés par beaucoup de spectateurs mais néanmoins significatifs. On peut ne pas être d'accord avec ces auteurs (dont les thèses sont aujourd'hui encore débattues), mais personne ne peut nier que de telles analyses visant à déterminer la nouveauté de ces œuvres (ou d'autres objets médiatiques) supposent de véritables compétences, qu'elles soient de nature esthétique, philosophique, « sémiotique », artistique ou autre.
Le « paysage médiatique » — si, du moins, une telle expression a un sens, tant les productions sont diverses et hétérogènes — ne se présente pas, on l'a bien compris, comme une taxonomie faite de catégories bien définies dans un ensemble cohérent et hiérarchisé : il s'agit plutôt de « genres » ou de « types » relativement flous aux limites imprécises, se recouvrant partiellement et soumis à des variations et des réorganisations fréquentes. En outre, ces différents genres sont soumis à la critique et à l'appréciation des « récepteurs », lecteurs ou spectateurs : dans cette interaction se construisent alors des critères d'appréciation ou des principes d'évaluation relativement hétérogènes. Même si l'on parle indifféremment de la « beauté » d'un match de football, d'une œuvre littéraire, d'une peinture ou d'un film, on devine facilement que les critères utilisés dans ces différents cas n'ont pas grand-chose à voir les uns avec les autres. La maîtrise cognitive et pratique des différents genres implique également celle des principes d'évaluation qui ont cours dans ces champs et qui se construisent progressivement dans les interactions entre les producteurs de médias (les « émetteurs ») et leurs publics (« récepteurs ») ainsi que les prescripteurs d'opinion (les critiques au sens le plus large du terme).
Les amateurs de bande dessinée par exemple vont s'intéresser à l'histoire racontée mais ils apprécieront également la qualité graphique des différentes réalisations ; en revanche, un « bon » journal (imprimé ou télévisuel) se jugera essentiellement en fonction de la qualité de ses informations et éventuellement de ses analyses ; les jeux vidéos quant à eux ont fait émerger de nouveaux critères comme la « jouabilité » qui désigne essentiellement la maniabilité des commandes qui permettent de contrôler les actions des personnages (ou des objets) à l'écran ; enfin, un site web se juge à présent d'après l'originalité de ses informations (alors que règne en maître le « copier-coller ») mais aussi d'après son accessibilité et sa navigabilité (c'est-à-dire la facilité à trouver l'information cherchée à l'intérieur du site).
On pourrait penser cependant que ces évaluations sont purement individuelles, et que les choix résultent essentiellement des préférences de chacun sans que l'on puisse parler de normes, de critères ou de principes extérieurs aux individus eux-mêmes. Les succès médiatiques semblent ainsi résulter du libre jeu des goûts divers du public qui se porte majoritairement vers telle ou telle production, souvent de façon imprévisible. Néanmoins, une telle conception est sans doute assez unilatérale [37] et néglige la dimension d'interaction sociale de toute consommation culturelle : on discute avec des collègues du roman ou de la bande dessinée qu'on vient de lire, on conseille un groupe musical, une exposition ou une série télévisuelle, on réagit à une information journalistique, on écrit sur un site Internet, on négocie avec un petit groupe d'amis devant la caisse du cinéma pour choisir le film à aller voir, on explique comment fonctionne un jeu vidéo, l'on parle du buzz dont tout le monde parle, et l'on transfère par mail un hoax (rumeur) non vérifié ou la blague qui nous a bien fait rire… Autrement dit, la consommation culturelle, loin d'être purement individuelle, est constamment sollicitée, guidée et orientée par d'autres consommateurs et/ou prescripteurs d'opinion : alors que l'offre médiatique se diversifie et devient surabondante (avec par exemple le remplacement des salles de cinéma uniques par les multiplexes, la multiplication des chaînes de télévision, les supermarchés du livre ou de DVD, et enfin la « bibliothèque universelle » d'Internet), nos choix se font en réalité dans un paysage culturel ou un contexte médiatique traversé sinon saturé par des évaluations explicites ou implicites qui se transforment dès lors en normes, en critères et en principes de jugement. Bien entendu, ces normes n'ont plus la force contraignante des traditions anciennes (supposées homogènes), et l'individu moderne [38] est confronté à une pluralité de principes d'évaluation, mais cette confrontation est immédiate et constante, même si la maîtrise de ces normes est très variable selon les individus et les domaines concernés. Ainsi, dès que quelqu'un se sent attiré par un genre médiatique (télévision, cinéma, jeux vidéos, littérature, bande dessinée…), il va, ne serait-ce que pour se repérer dans la surabondance de l'offre, chercher et recueillir des opinions, écouter des avis, solliciter des conseils, parcourir des catalogues et des critiques, consulter des magazines ou des sites spécialisés, qui lui permettront de comprendre les principes d'évaluation à l'œuvre dans ce champ : participer à un forum de discussion par exemple suppose la maîtrise des « mots de la tribu » c'est-à-dire des différents critères auxquels se réfèrent de façon plus ou moins explicite les différents intervenants.

Othello d'Orson Welles
un film connu des cinéphiles
Identifier un genre (médiatique, artistique, culturel…) suppose donc que l'on connaisse les principes d'évaluation à l'œuvre dans ce champ, même si les individus conservent une marge d'appréciation importante : ainsi, un amateur de bandes dessinées peut citer les noms célèbres de l'école belge, même s'il ne les apprécie pas tous de la même façon ; un cinéphile a entendu parler de grands cinéastes actuels (Steven Spielberg, Tim Burton,) ou passés (Stanley Kubrick, Orson Welles, Charles Chaplin…) même s'il n'a pas nécessairement vu tous leurs films ; un « gamer » consulte les revues spécialisées ou fréquente les sites et les forums sur la question, qui sont les lieux où se forgent une opinion et surtout une évaluation générale des jeux vidéos… Quant à l'amateur de vins, il ne se contente évidemment pas d'identifier les cépages et les origines, et il fait une différence essentielle entre les vins de qualité et la « piquette » dont il lui importe peu de reconnaître les différents millésimes…
La maîtrise des principes d'évaluation est donc une compétence essentielle pour s'orienter dans le « paysage médiatique » et ses multiples genres. Cette maîtrise est évidemment très variable selon les individus, et il y a certainement une différence entre des spectateurs qui se concertent en regardant les affiches à l'entrée d'un cinéma, ceux qui consultent les critiques (ou les « étoiles » ou autres notes d'évaluation) dans la presse quotidienne ou dans un hebdomadaire généraliste, et enfin ceux qui lisent des magazines spécialisés comme Positif ou Les Cahiers du Cinéma. Par ailleurs, si l'on voit émerger dans certains domaines, comme le cinéma, la littérature, les jeux vidéos, les arts ou encore la bande dessinée, des « autorités spécialisées » ou des « instances de légitimation autonomes » (selon l'expression de Pierre Bourdieu), d'autres restent essentiellement soumis à la « logique du nombre », du « succès » ou du « bouche-à-oreille » qui a si fortement impressionné les premiers observateurs des « mass media » : l'exemple le plus clair de cette tendance est celui d'Internet où, aujourd'hui, le moteur de recherche très majoritairement utilisé, Google, classe ses résultats en tenant compte du nombre de liens qui pointent vers les différents sites, c'est-à-dire de leur succès antérieur qui en est automatiquement augmenté… Bien entendu, la plupart des « genres » ou « domaines » sont traversés par des principes d'évaluation contradictoires, le succès du plus grand nombre étant concurrencé plus ou moins fortement par les avis autorisés des « spécialistes » (parfois autoproclamés) du domaine [39].
On ne réduira cependant pas ces principes d'évaluation à la seule dimension esthétique (au sens le plus large du terme), les critères utilisés dans certains domaines pouvant aussi bien être de nature politique, morale, « philosophique » ou portant sur la valeur de vérité (ou de fausseté…) des médias en cause : c'est le cas notamment des médias d'information (presse écrite, journaux et magazines radios ou télévisuels, Internet) soumis à une très forte concurrence et vis-à-vis desquels s'est développée une pensée « critique », jouant le rôle d'instance de légitimation (ou de délégitimation…) [40]. Dans ce cas, les normes d'évaluation, loin de fonder un consensus, sont elles-mêmes objet de polémiques répétées. Bien entendu, des champs médiatiques soumis en apparence à des critères essentiellement esthétiques (cinéma, bandes dessinées, littérature…) sont souvent traversés, même si c'est de façon plus ou moins souterraine, par des jugements de nature morale, politique ou philosophique, donnant lieu à débats et conflits qui restent généralement non résolus.
Enfin, comme on l'a déjà signalé, il est clair que la maîtrise des principes d'évaluation ayant cours dans un domaine n'est pas possible sans une connaissance concrète de ces réalisations ou productions : on ne peut pas apprécier la touche d'un peintre sans voir ses œuvres, ni juger de la qualité d'une musique sans l'écouter attentivement, ni mesurer le réalisme (ou l'absence de réalisme), l'humour ou le dynamisme d'une série télévisée sans en avoir suivi au moins une saison… Cela peut sembler évident, mais cela n'empêche pas des « critiques » de s'exprimer de façon générale et, le plus souvent, négativement sur des genres qu'ils ne maîtrisent que très sommairement (qu'il s'agisse, selon les époques, de cinéma, de bandes dessinées, de différentes musiques jugées « populaires » ou de jeux vidéos). L'autorité des spécialistes du domaine résulte d'ailleurs pour une large part de leur connaissance étendue de la diversité des productions récentes ou plus anciennes, connaissance qui leur permet notamment d'apprécier de façon plus juste l'originalité des nouvelles réalisations : cela vaut pour l'art, la littérature, le cinéma mais également pour le hip hop, les jeux vidéos, les spectacles sportifs, les mangas ou les logiciels « libres ». Les nouvelles productions entraînent en outre souvent une modification des critères d'appréciation comme en témoignent par exemple l'histoire de la littérature ou celle, plus récente, des jeux vidéos : si les œuvres de Corneille ou de Racine se jugeaient en fonction des « règles » de la poétique classique, la littérature romantique se signalera précisément par le rejet de ces règles ; quant aux jeux vidéos, la rapidité de l'évolution technologique, la puissance croissante des ordinateurs (et des fameuses cartes graphiques) ont considérablement relevé le niveau d'exigence des joueurs qui demandent un réalisme extrême des apparences (vêtements, décors, accessoires, mouvements…), des scénarios élaborés, une grande variété de situations, un nombre croissant d'options (pour construire le personnage, pour l'équiper, etc.)…
On remarquera pour terminer à ce propos que la maîtrise de l'évaluation des différents champs médiatiques, qui implique une part importante de connaissances concrètes du domaine en cause, suppose cependant d'autres compétences de nature communicationnelle : il ne s'agit pas en effet seulement de recevoir et d'apprécier une œuvre ou une réalisation mais également d'exprimer un avis, d'argumenter en utilisant des principes généraux partagés par tous les interlocuteurs, de déterminer des éléments pertinents pour l'analyse, de faire comprendre à d'autres des impressions ou des émotions qui ont été ressenties individuellement et souvent confusément. Ici aussi, l'on constate facilement la différence entre, d'une part, l'expression d'une simple opinion à la sortie d'une salle de cinéma [41] et, d'autre part, la production d'une véritable analyse susceptible notamment de déboucher sur un échange approfondi avec d'autres personnes. Bien entendu, il faut mesurer la pertinence pédagogique d'une telle compétence sans doute nécessaire pour des critiques professionnels mais moins évidente pour des spectateurs ordinaires : sans vouloir transformer ces derniers en spécialistes des différents médias, on peut cependant les amener à une meilleure maîtrise des principes généraux d'évaluation notamment lorsqu'ils s'appliquent à des domaines artistiques, culturels et/ou médiatiques [42]. (La position inverse qui affirmerait que jugement et analyse sont inutiles et que seule importe en définitive l'appréciation muette des œuvres ou réalisations est théoriquement possible — et a effectivement été défendue sous différentes formes — mais impliquerait que tous les individus sont capables d'une telle appréciation sans subir d'influence extérieure : s'il n'est sans doute pas nécessaire d'être musicologue pour apprécier un morceau de musique, d'autres productions médiatiques d'une séduction immédiate méritent cependant d'être interrogées, soumises à la réflexion sinon à la critique, qu'il s'agisse de publicités, de représentations biaisées de la réalité, d'informations partielles ou d'images plus ou moins tendancieuses. Le silence revient en effet aussi pour beaucoup à subir l'influence des représentations et des médias dominants. D'un point de vue pédagogique, on peut penser que le premier impératif est de susciter une distance réflexive par rapport à nos jugements immédiats et de prendre conscience de la diversité des échelles d'évaluation en matière de culture.)
Il faut relever une dernière différence entre les multiples « genres » médiatiques, celui de leur plus ou moins grande difficulté d'accès. Cette difficulté peut dépendre de conditions externes ou de raisons internes.
Les conditions externes relèvent essentiellement de l'inégale distribution des productions et des domaines médiatiques. Si l'offre médiatique s'est très fortement élargie dans les dernières décennies, il faut aussi noter que de multiples mécanismes — souvent peu visibles et méconnus — au niveau de la diffusion induisent des inégalités plus ou moins importantes entre les multiples réalisations. Face à une production « surabondante », la distribution joue en effet un rôle de filtre sinon d'« entonnoir ». Ainsi, dans le domaine cinématographique, la visibilité des films dépend d'abord du nombre de salles dans lesquelles ils sont projetés et de la durée de leur exploitation ; c'est également le cas pour les livres dont seule une petite partie (souvent les parutions récentes) peut être exposée en librairie ; à la télévision, les heures de diffusion (en « prime time » ou au milieu de la nuit…) jouent le même rôle de sélection entre les réalisations audiovisuelles (dont un très grand nombre ne passeront d'ailleurs jamais sur une chaîne quelconque). De nouveaux canaux sont sans doute apparus permettant d'augmenter l'offre, mais on y repère facilement le même type de mécanismes restreignant l'accès aux réalisations effectivement disponibles : par exemple dans le cas du cinéma, évoqué à l'instant, la diffusion en cassettes vidéo, puis en DVD et enfin par Internet (sous forme légale ou illégale), a certainement augmenté le choix de films disponibles (avec des qualités variables) mais ces nouveaux moyens de distribution opèrent également des sélections, et ce sont les films les plus vus en salle qui sont de façon générale les mieux distribués par ces canaux. Aux limitations imposées par la distribution s'ajoutent celles de la promotion et de la critique qui vont porter sur un nombre restreint de productions, même si ces différentes instances (distribution, promotion, légitimation critique) opèrent des choix qui ne se recouvrent qu'en partie. En effet, plus l'offre est vaste et apparemment égalitaire comme dans une très grande bibliothèque, moins elle détermine par elle-même les choix de consommation qui dépendent alors surtout de la promotion (au sens le plus large du terme) organisée par les médias numériquement dominants (télévision, grands organes de presse, sites Internet les plus populaires…) : sans publicité ni « critiques », sans « forum » ni référencement, sans presse ni « événement » ni autre « buzz », une quelconque production médiatique est condamnée à l'inexistence (même si la promotion elle-même doit être considérée plutôt comme un espace relativement diversifié de canaux d'importance différente plutôt que comme une instance homogène fortement centralisée).
Mais l'accès aux réalisations médiatiques dépend également de conditions « internes », c'est-à-dire de la maîtrise par les « récepteurs » des codes, savoirs et processus d'inférence de toutes sortes nécessaires à leur interprétation. L'exemple le plus évident de ces limitations d'accès est celui de la langue qui aujourd'hui encore constitue la barrière la plus importante dans l'univers des médias de masse : Internet, réseau mondial, est ainsi, malgré les apparences, fortement cloisonné, et, si l'anglais est sans doute dominant, servant généralement de lingua franca, les utilisateurs consultent essentiellement les sites dans leur propre langue [43]. Dans la même perspective, on relèvera que la maîtrise de l'écrit est indispensable pour la réception d'un grand nombre de réalisations médiatiques, même lorsqu'elles recourent principalement au « langage » audiovisuel. Aujourd'hui par exemple, la vision des grandes œuvres de la peinture classique européenne (depuis la Renaissance jusqu'au 19e siècle) suppose la connaissance — et donc la lecture au moins sommaire — de la Bible et des récits de la mythologie antique si l'on veut comprendre le sens de ces œuvres.
Mais le lecteur, spectateur ou consommateur peut rencontrer bien d'autres difficultés dans la réception de certaines productions, liées à leur « structure » interne plus ou moins complexe : ainsi, la lecture d'un fait divers dans un journal régional sera certainement plus aisée pour la plupart des individus, même faiblement scolarisés, que celle d'un roman comme Madame Bovary de Flaubert ou Du côté de chez Swann de Proust. Semblablement, la plupart des adultes peuvent suivre un journal télévisé mais seule une minorité sera capable de consulter un ouvrage de sociologie même s'il traite apparemment des mêmes sujets (« les faits de société »). Et si l'on compare des productions à l'intérieur d'un même domaine médiatique, on constatera par exemple que certains jeux vidéos sont facilement maîtrisés avec un minimum d'explication tandis que d'autres supposent un véritable apprentissage, parfois fort ardu : beaucoup de joueurs n'ont sans doute même pas réussi à faire décoller leur avion dans un simulateur de vol ! De la même façon, au cinéma, on reconnaîtra sans doute qu'un film d'action hollywoodien pose généralement moins de problèmes de compréhension qu'un film de Jean-Luc Godard, de David Lynch ou de Peter Greenaway. Enfin, l'interprétation d'un poème de Stéphane Mallarmé ou de Saint-John Perse est certainement plus ardue ou problématique que celle de Musset ou de Leconte de Lisle.

Elephant de Gus Van Sant
un propos énigmatique
En outre, certaines productions ou réalisations comprennent différents « niveaux » qui sont plus ou moins accessibles selon les compétences des spectateurs ou « récepteurs ». Ainsi dans le domaine de la peinture classique, le célèbre historien d'art Erwin Panofsky distingue trois « strates » d'interprétation, d'abord un premier niveau mettant essentiellement en jeu les mécanismes de perception qui nous permettent de distinguer sur une fresque plane un groupe de personnes attablées à une table (ce sont les motifs), puis un second niveau faisant appel à des conventions iconographiques largement répandues nous permettant de reconnaître dans ces personnages le Christ entouré de ses apôtres lors de la dernière cène (les thèmes), et enfin un troisième niveau consistant à comprendre la mise en forme singulière par Léonard de Vinci de ce thème religieux conventionnel ainsi que les significations particulières qu'il a voulu lui donner (le contenu symbolique). Ce troisième niveau, proprement iconologique, est évidemment le plus difficile à interpréter et est également le plus hypothétique [44]. Semblablement, face à des films énigmatiques comme Elephant de Gus Van Sant (2003) ou 2001 : l'odyssée de l'espace de Stanley Kubrick (1968), Meurtre dans un jardin anglais de Peter Greenaway (1982) ou encore Funny Games de Michael Haneke (1997), la majorité des spectateurs comprennent sans doute les événements mis en scène, leur déroulement chronologique, les propos échangés ainsi que le rôle des principaux personnages, mais ils peuvent être déconcertés par le sens global à donner à ces événements comme par le propos général supposé de l'auteur du film : certains niveaux ou aspects du film sont donc facilement accessibles mais d'autres, tout aussi essentiels, posent d'importants problèmes d'interprétation, entraînant alors un rejet possible de la part de certains spectateurs. Dans un tout autre domaine médiatique, celui de la recherche d'informations sur Internet, l'on constate également que la plupart des utilisateurs se contentent d'utiliser le moteur de recherche le plus usuel, Google, en proposant quelques mots-clefs et en se satisfaisant des premières réponses données ; seule une minorité utilise les outils de recherche plus avancés, disponibles en option, qui permettent d'accéder à des documents plus spécialisés et moins « populaires » (puisque ce moteur de recherche privilégie de façon générale les sites en fonction du nombre de liens qui pointent vers eux). De la même façon, l'utilisation des nouveaux réseaux sociaux comme Facebook est au départ extrêmement aisée — il suffit de s'inscrire avec une adresse e-mail — mais la maîtrise des différentes options, en particulier la confidentialité des données personnelles, est beaucoup moins aisée et est négligée par beaucoup d'utilisateurs. Enfin, beaucoup de jeux vidéos sont construits selon un principe d'étapes successives (des « mondes », des « époques », des « épreuves », des « clefs »…) généralement de plus en plus complexes qui doivent être accomplies jusqu'à leur terme avant de passer à la suivante, ce qui suscite une forte adhésion (le joueur veut passer à l'étape suivante) mais peut également susciter le découragement et l'abandon de la partie ; en outre, il existe souvent pour l'ensemble du jeu une option permettant de fixer le niveau de difficulté générale en fonction de l'habileté du joueur (avec des degrés depuis le plus facile comme « Piece of Cake », jusqu'au plus difficile « Damn I'm good »).
Ces difficultés d'accès aux différentes productions ou réalisations médiatiques sont, on le voit, très variables et dépendent de facteurs multiples, souvent assez mal connus et peu définis : ainsi, « l'abstraction » d'un ouvrage de philosophie est sans doute un obstacle pour beaucoup de lecteurs, mais il est plus difficile de préciser quels sont les mécanismes précis (conceptuels, linguistiques, sémantiques…) qui concourent à cette abstraction ; néanmoins, il est évidemment possible d'expliquer, par une pratique pédagogique plus ou moins intuitive, un tel texte. Autrement dit, l'absence ou la faiblesse de la théorie des objets médiatiques n'interdit pas un travail pédagogique — d'explication, d'analyse, de réflexion… — autour de ces objets.
Se pose ainsi la question de la pertinence pédagogique du choix des productions ou réalisations médiatiques à aborder avec un public de non-spécialistes. De façon abstraite, on peut sans doute affirmer que tout objet est digne d'intérêt et de réflexion, et qu'une chanson populaire ou une émission de télé-réalité mérite autant l'analyse qu'un chef-d'œuvre réputé du septième art ou un texte classique de la philosophie. De manière générale, les sciences humaines nous ont d'ailleurs appris à nous méfier de nos jugements de valeur spontanés (qui sont socialement construits) et à adopter un point de vue distancié, aussi neutre que possible vis-à-vis des productions culturelles qui nous entourent. Néanmoins, d'un point de vue pédagogique, le critère de la difficulté d'accès a une certaine pertinence. D'une part, l'on peut estimer que le rôle de l'éducation est de faire découvrir au public (jeune ou moins jeune) des réalisations méconnues, marginales ou minoritaires : ainsi, on peut préférer montrer des films d'art et essai ou en provenance des « 3 Continents » (Asie, Afrique, Amérique latine) à des spectateurs qui spontanément ne verraient pas ce genre de films. D'autre part, les éducateurs privilégieront sans doute des réalisations ou des médias qui posent des difficultés d'accès « interne » et qui nécessitent de ce fait un véritable apprentissage : ainsi, il est clair que l'école ne peut pas renoncer aujourd'hui à son rôle « traditionnel » visant à assurer la maîtrise la meilleure possible de l'écrit par un maximum d'enfants et d'adolescents. Dans la même perspective, l'on peut estimer qu'il est plus intéressant d'aborder une œuvre artistiquement originale, au contenu réfléchi mais d'un abord moins aisé, qu'une production facile d'accès, visible par n'importe qui et largement diffusée. Si l'objectif de l'éducation est bien de faire acquérir des compétences, celles-ci trouveront plus facilement à s'exercer face à des objets « problématiques » que devant des réalisations d'un accès immédiat et facile, même s'il est sans doute toujours possible de faire « apparaître » des niveaux d'analyse et de compréhension moins évidents (comme par exemple les conditions de réalisation effective d'une émission de télé-réalité, les stratégies de scénarisation utilisées, le travail préalable du casting et la mise en scène générale des épreuves, c'est-à-dire tout un processus de production qui n'apparaît que très partiellement à l'écran et dont la plupart des spectateurs n'ont qu'une faible conscience).
Le critère de la difficulté d'accès n'est sans doute pas décisif et ne doit pas servir en particulier à stigmatiser ou à dénigrer des productions qualifiées trop facilement de « populaires », « commerciales », de « simple consommation » ou de « pure distraction ». Mais il a certainement une certaine pertinence pédagogique dans la mesure, d'une part, où le temps d'éducation est nécessairement limité et implique donc des choix dans les « objets » qui peuvent être abordés, et, d'autre part, où l'acquisition de nouvelles compétences suppose que « l'apprenant » soit confronté à des « situations problématiques » et notamment à des « objets » qui posent effectivement des difficultés de réception.
On a essayé de montrer jusqu'à présent que les médias ne constituent pas un espace homogène et qu'une des compétences essentielles à acquérir dans leur abord est précisément d'en percevoir les différents « genres » et de maîtriser leur spécificité, leurs conditions particulières de réception, leur « langage » ou leur « structure » ainsi que les systèmes de valeurs qui les traversent. C'est dans cette perspective que l'on souhaite à présent revenir sur le cinéma comme genre spécifique, différent par exemple de la littérature, de la télévision, des jeux vidéos ou d'autres médias, avec lesquels il entretient néanmoins des relations plus ou moins diffuses.
La position adoptée ici se distinguera néanmoins des approches plus classiques visant à déterminer ce qu'est le cinéma (selon le titre du célèbre recueil d'articles d'André Bazin), ou bien à définir un quelconque langage cinématographique supposé différent des autres langages, ou encore une esthétique, une essence ou une ontologie qui distinguerait radicalement le cinéma des autres médias : la notion de genre — genre médiatique ou genre cinématographique — , telle qu'on l'entend ici, est essentiellement conçue de façon historique, sociale et culturelle, c'est-à-dire comme un ensemble de réalisations qui ont effectivement un « air de famille » [45] et qui constituent un « paysage » relativement homogène mais également diversifié, permettant précisément le passage, à travers certaines réalisations, d'un genre à l'autre (les films passent à la télévision, mais un film de « cinéma » se distingue généralement d'un téléfilm, même si certaines productions semblent à cheval sur cette frontière). Les réalisations d'un même genre se caractérisent par des traits saillants et significatifs, qui semblent essentiels à sa définition, mais seule une partie de ces réalisations possèdent effectivement tous ces traits alors que d'autres n'en partagent qu'un nombre limité, ce qui semble les positionner à la marge ou à la périphérie du genre.
En ce qui concerne le cinéma, le premier trait que l'on relèvera illustre bien la manière dont on conçoit un « genre » médiatique : le cinéma se caractérise en effet d'abord par un lieu, la salle de projection, bien qu'aujourd'hui beaucoup de films passent à la télévision ou sur écran d'ordinateur. Mais ce lieu, qui pourrait donc paraître secondaire, est celui qui assure les meilleures conditions de projection et qui est chronologiquement le premier en termes de diffusion des films.

le cinéma Churchill à Liège
un cinéma d'art et essai, lieu de rencontre des cinéphiles
La diffusion du cinéma se compose en effet aujourd'hui de plusieurs étapes, la salle d'abord, puis les ventes ou locations de DVD et Blu-ray (anciennement de cassettes vidéos), le passage sur les chaînes payantes de télévision et enfin sur les chaînes « généralistes » ; la diffusion sur Internet, actuellement en grande partie illégale, intervient généralement au moment du passage au DVD, dont le format numérique, faiblement protégé, est facilement copié. Mais la salle reste la première étape (sauf exception) qui détermine notamment le succès global du film qui se répercute ensuite sur les autres supports (même si certaines réalisations font exception) : c'est ce qui explique que beaucoup de films visibles en salles (même si c'est pour de brèves périodes ou lors de séances exceptionnelles comme dans des festivals) ne franchissent pas les étapes ultérieures de la diffusion (DVD, VOD…). Cette primauté de la salle est également technologique puisque l'exploitation a toujours veillé à assurer les meilleures conditions de projection [46] tout en accueillant les innovations technologiques majeures du cinéma, qu'il s'agisse du parlant (à un moment où les salles n'avaient guère que le théâtre comme seul concurrent), de la couleur, du Cinémascope, du son en stéréo et aujourd'hui de la 3D.
Le parc des salles cinématographiques n'est d'ailleurs pas homogène et voit s'opposer deux grands types d'exploitation, l'une essentiellement commerciale dominée aujourd'hui par des multiplexes généralement installés pour des raisons de coûts et d'accessibilité à la périphérie des grandes villes, et l'autre regroupant plutôt des salles d'art et essai qui se consacrent à des réalisations plus minoritaires (en termes de fréquentation), qu'il s'agisse de films d'auteurs, de films en version originale, de genres peu reconnus (comme le documentaire) ou de réalisations provenant de pays étrangers, autres que les États-Unis. Ces salles d'art et essai [47], plus ou moins spécialisées, présentes essentiellement dans les grands centres urbains, sont un lieu essentiel pour la découverte et la diffusion des œuvres les plus innovantes, les plus fragiles et les moins connues.
Dans une perspective pédagogique, il est donc important de faire découvrir aux spectateurs potentiels ces différents lieux, soit parce qu'ils n'ont jamais pénétré dans une salle de cinéma (comme on le voit notamment lorsqu'on s'adresse à un public défavorisé ou excentré), soit parce qu'ils ne connaissent que les salles les plus commerciales : la cinéphilie, qui ne concerne sans doute qu'une minorité de personnes mais qui doit être une possibilité offerte à tous, passe en effet de façon privilégiée par les salles d'art et essai qui sont des lieux de découverte avec leur dynamique propre et dont la fréquentation régulière est indispensable si l'on veut découvrir le cinéma «vivant » en train de se faire. On peut y ajouter d'autres lieux plus spécialisés comme les cinémathèques qui se consacrent à l'histoire du cinéma et en conservent la mémoire vivante [48].
D'autres caractéristiques différencient cependant le cinéma des autres « genres » médiatiques comme la télévision, dont il est relativement proche mais avec lesquels il ne se confond cependant pas. La comparaison avec la télévision est relativement éclairante puisque de nombreux films passent sur ces chaînes, ce qui pourrait donner à penser que la télévision est un simple canal de diffusion, indifférent aux contenus, qui ne posséderait pas ainsi les caractéristiques d'un « genre » tel qu'entendu ici. Une telle analyse serait cependant naïve dans la mesure où les chaînes de télévision sont en réalité des dispositifs complexes dont les techniques de diffusion ne sont qu'une des dimensions alors que d'autres contraintes (souvent inaperçues) influencent de façon déterminante les « contenus » diffusés : ainsi, on constate que la part des films diffusés sur les chaînes généralistes tend à se réduire au profit d'autres émissions comme les séries, les « talking shows » ou encore les émissions de télé-réalité, ce qui montre bien que la « logique » du passage des films à la télévision est (relativement) différente de celle des salles de cinéma.
Dans une telle perspective comparative, on relèvera en particulier que la télévision se présente aujourd'hui comme un « flux » continu, sans doute marqué par certaines scansions mais qui ne coïncident pas nécessairement avec le début ou la fin des émissions : la publicité par exemple prend place au milieu des émissions, et les émissions elles-mêmes se découpent de plus en plus comme des fragments relativement indépendants les uns des autres [49]. Ce mode de diffusion est lié à un mode de consommation assez lâche, qui permet de prendre les émissions en cours de route mais également de les quitter si elles déplaisent (un phénomène majeur du système télévisuel, lié d'une part à la multiplication des chaînes à partir des années 1970 en Europe et d'autre part à la naissance d'un instrument essentiel à la maîtrise paresseuse de ce choix, la télécommande qui se généralise dans les années 1980).
Le cinéma en revanche impose aux spectateurs la vision d'un film en entier tout en favorisant la participation ou la « focalisation » du public par des conditions particulières de projection (obscurité, écran de grandes dimensions, son « enveloppant »…). Autrement dit, le film au cinéma se présente comme un ensemble, un « tout » ayant, comme on dit, un début un milieu et une fin, et se rapproche en cela d'autres réalisations comme les romans ou les pièces de théâtre qui ne peuvent pas être reçues et appréciées par fragments. On peut parler à propos de toutes ces réalisations de « textes de haut niveau », c'est-à-dire d'ensembles sémiotiques fortement structurés, hiérarchisés, impliquant la mise en relation d'éléments éloignés les uns des autres dans le « texte » et jouant de ce fait de façon importante sur la mémoire active des spectateurs : ainsi, il est impossible d'être ému par la dernière séquence d'un film comme Les Temps modernes de Chaplin (1936), Rosetta des frères Dardenne (1999) ou même Titanic de James Cameron (1997) si l'on n'a pas vu l'ensemble du film et participé aux émotions (souvent multiples et contradictoires) distillées et accumulées au cours de la projection (bien entendu, certains spectateurs peuvent être restés totalement insensibles au film en cause et donc aussi à sa dernière séquence). Semblablement, le suicide de Madame Bovary dans le roman de Flaubert risque de laisser le lecteur indifférent s'il ne comprend pas que cet acte n'est pas seulement provoqué par des difficultés d'argent mais traduit l'échec de toute une vie et de ses rêves inaboutis face à une réalité asphyxiante, longuement décrite à travers les centaines de pages du roman [50].
Un film ne peut donc pas se voir par fragments et implique au contraire un « travail » de mémorisation, de mise en relation et d'interprétation de « haut niveau », même s'il peut arriver que nous n'en voyions qu'un extrait ou un morceau notamment en « zappant » à la télévision. Cela vaut pour l'intrigue mais aussi pour la compréhension des personnages qui peuvent évoluer au cours du film (par exemple dans Potiche de François Ozon, 2010) ou qui peuvent se révéler très différents de leur apparence première (comme dansFrench Connection de William Friedkin, 1971 [51]), ou pour l'esthétique du film : ainsi, il est facile de repérer dans Elephant de Gus Van Sant (2003) les plans-séquences tournés avec un steadicam (un système de stabilisation qui évite les tremblements de la caméra à l'épaule tout en permettant une grande liberté et fluidité de mouvements), mais cette manière de faire risque bien d'apparaître au niveau d'une séquence isolée comme un simple procédé plus ou moins artificiel ou maniéré, et ce n'est qu'en la rapportant à d'autres caractéristiques du film (comme la manière d'agencer les différents épisodes, le travail sur la bande-son ou le mutisme des différents personnages) qu'il est possible de lui trouver un sens esthétique [52].
Ces réflexions peuvent paraître évidentes, mais il faut bien voir que ce mode de réception du cinéma comme ensemble structuré est aujourd'hui concurrencé par une vision beaucoup plus éclatée et dispersée — promue essentiellement par la télévision — privilégiant des fragments retenus pour leur aspect spectaculaire, frappant ou immédiatement séduisant, vision proposée par exemple sur les sites de partage de vidéos sur Internet qui reprennent les meilleurs moments de films plus ou moins connus. Il y a donc un véritable travail pédagogique à faire pour convaincre aujourd'hui les spectateurs de consacrer du temps à voir un film en entier en acceptant par exemple que le développement d'une intrigue puisse passer par des épisodes moins marquants, ou que le portrait d'un personnage se dessine par petites touches dispersées tout au long du récit ou encore que des épisodes ultérieurs puissent modifier le sens ou la valeur de scènes antérieures.
On soulignera dans cette perspective que le cinéma, pour sa meilleure part, se présente comme un art, c'est-à-dire que chaque film est censé traduire des choix esthétiques, thématiques et expressifs qui lui donnent une cohérence d'ensemble. Bien entendu, tous les films ne sont pas des chefs-d'œuvre, et certaines réalisations télévisuelles (comme les nouvelles séries américaines déjà citées) peuvent également prétendre au même statut artistique. Mais, dans ses conditions actuelles de production, le cinéma donne au réalisateur une prépondérance dans l'ensemble des choix à effectuer, ce qui doit amener le spectateur à le considérer comme l'auteur du film au sens le plus fort du terme, même si la réalisation est aussi le résultat d'un travail collectif : on ne peut pas considérer de la même façon que le réalisateur d'un journal télévisé ou le rédacteur en chef d'un quotidien en sont les auteurs, ni que leurs choix sont de nature expressive, même si ces responsables prennent un grand nombre de décisions significatives [53].

Élève libre de Joachim Lafosse
des personnages malfaisants
D'un point de vue pédagogique, cela implique en particulier que l'on amène les spectateurs à dépasser le niveau de l'intrigue du film — l'histoire racontée avec ses rebondissements — et à prendre en considération le point de vue de l'auteur — le cinéaste — qui n'apparaît pourtant pas en tant que tel à l'écran (sauf exceptions). Ce travail de reconstruction des intentions supposées de l'auteur n'est pas nécessairement facile et suppose l'acquisition de compétences relativement complexes (il s'agit essentiellement de mettre en œuvre des processus d'inférence, faiblement codifiés, à partir d'indices dispersés dans le film). Si, par exemple, l'ironie d'un réalisateur est en général perçue par les spectateurs à travers la représentation de héros caricaturaux, il est moins évident de comprendre les intentions d'un cinéaste qui met par exemple en scène des personnages énigmatiques (comme dans La Notte d'Antonioni ou Elephant de Gus Van Sant), peu sympathiques ou même déplaisants (Citizen Kane ou La Splendeur des Amberson d'Orson Welles, le début de Rosetta des frères Dardenne, Un héros très discret de Jacques Audiard) ou carrément pervers et malfaisants (Salò de Pasolini, Élève libre de Joachim Lafosse). En ce domaine, les compétences sont très inégalement réparties entre les spectateurs, et l'on constate que nombre d'entre eux (notamment les plus jeunes et les moins éduqués) se contentent généralement de suivre l'histoire mise en scène sans jamais s'interroger sur le point de vue de l'auteur du film.
Dans une perspective aussi bien psychologique que sociologique, on peut considérer que les attitudes spectatorielles se déploient ainsi entre deux pôles : d'une part, une vision fragmentaire, affective, essentiellement centrée sur les personnages et les événements visibles à l'écran, surtout sensible aux effets immédiats de la mise en scène, et, d'autre part, une « lecture » globale, attentive aux enchaînements non visibles, cherchant à appréhender le point de vue de l'auteur, et percevant le film comme un ensemble construit de façon significative [54]. Mais cette dernière attitude, qui n'est supposée que par les œuvres cinématographiques les plus exigeantes (mais également par des textes de « haut niveau » comme la littérature romanesque), ne s'acquiert généralement pas de façon spontanée et suppose un processus d'éducation que ne demandent pas d'autres « genres » médiatiques comme la télévision ou Internet privilégiant une approche parcellaire avec un faible travail interprétatif.
Le mode de réception du cinéma se caractérise en outre par ce qu'on pourrait appeler la perception préférentielle de l'originalité filmique, c'est-à-dire que le spectateur sera d'abord sensible à la singularité de chacun des films qu'il a l'occasion de voir, plutôt qu'à leurs ressemblances : ainsi, le spectateur se souviendra d'un film précis avec son titre, son intrigue propre, ses acteurs, alors qu'il lui sera beaucoup plus difficile de se remémorer un journal télévisé parmi les milliers qu'il a suivis, ou de distinguer entre le troisième épisode de la saison deux et le deuxième épisode de la saison trois d'une même série télévisée… Bien entendu, cette opposition entre nouveauté et répétition ne doit pas être conçue de façon absolue et tranchée : si je continue à regarder le journal télévisé, c'est évidemment parce que je m'attends à ce qu'il m'apporte des informations nouvelles ; de la même façon, mon intérêt pour une série télévisuelle dépend du caractère inédit des épisodes qui me sont régulièrement proposés. À l'inverse, les spectateurs de cinéma peuvent privilégier certains genres (ou sous-genres) comme les westerns, les films de guerre, les films fantastiques, dans lesquels ils aiment à retrouver les mêmes thèmes, les mêmes situations, le même type de personnages ou les mêmes acteurs. Et l'on sait que les grands succès cinématographiques sont rapidement suivis de leurs suites (ou « sequels » selon la terminologie anglophone) qui se signalent rarement par une grande originalité (même s'il y a des exceptions célèbres comme la série des Parrains réalisés par Francis Ford Coppola).
Néanmoins, l'on voit bien que les continuités sont beaucoup plus grandes dans les phénomènes des séries (comme les gags en bandes dessinées ou les mangas reprenant inlassablement les mêmes héros, les mêmes situations et le même graphisme avec un minimum de variations [55]) qu'au cinéma où les spectateurs sont surtout sensibles à l'originalité des différents films : même si Hitchcock est réputé de façon générale comme le maître du suspense, tous les spectateurs feront facilement la différence entre Vertigo, La Mort aux trousses et Psychose dont ils garderont également des souvenirs très différents même si ceux-ci restent relativement imprécis. On pourrait néanmoins penser que la recherche d'originalité concerne avant tout un cinéma d'auteur soucieux de « distinction » et de singularité, mais le cinéma qui vise un « large public » (en particulier hollywoodien) travaille également à produire des réalisations qui marquent les esprits de façon unique, que ce soit par leur dimension spectaculaire (Star Wars dont les fans distinguent nettement les différents épisodes), leur caractère épique ou romantique (Autant en emporte le vent, Titanic), l'ampleur des moyens mis en œuvre (Titanic, Cléopâtre, Intolérance), le renouvellement des « codes » ou des clichés du genre (Danse avec les loups, Saving Private Ryan, Slumdog Millionaire, Kill Bill) ou même l'invention de nouvelles formes ou de nouveaux genres (le cinéma italien, encore muet, invente pratiquement le peplum, Terence Fisher de la société Hammer crée en 1957 un nouveau style de film d'horreur, le film de kung-fu apparaît à Hong-Kong dans les années 1960, etc.).
L'approche pédagogique d'un film est donc différente de celle d'autres productions médiatiques comme les journaux télévisés : alors que la réflexion peut porter par exemple sur n'importe quel exemplaire du journal télévisé d'une même chaîne (tous étant globalement construits sur un même modèle), l'analyse filmique implique en revanche que l'on s'attache à la singularité du film abordé dont on essaiera de déterminer avec autant de précision possible l'originalité par rapport au paysage cinématographique (ou plus largement culturel) où il s'inscrit. L'originalité en question ne sera pas uniquement de nature esthétique et concernera également le propos du film, au sens le plus large du terme : si le « style » d'un cinéaste comme Ken Loach ne change sans doute pas profondément d'un film à l'autre, les questions qu'il soulève sont évidemment fort différentes dans Raining Stones (1993), Land and Freedom (1995), Sweet Sixteen (2002) ou encore Looking for Eric (2009).

Sweet Sixteen de Ken Loach
un thème original
Si l'originalité de chaque réalisation filmique est perçue de façon très intuitive par les spectateurs (et est évidemment très variable selon les films), elle est sans doute plus difficile à déterminer de façon explicite et objective, car elle suppose notamment une comparaison avec d'autres réalisations, de la même tradition ou de genres apparentés, dont l'éventail peut être extrêmement large : ainsi, un spécialiste du cinéma connaissant un grand nombre de films trouvera certainement de nombreuses références possibles à une réalisation qu'un spectateur moins averti estimera facilement innovante. Par ailleurs, pour déterminer les caractéristiques effectivement originales, il faut procéder à une analyse de cet objet complexe qu'est le film et en repérer les différentes composantes : un des paradoxes de l'originalité est précisément de « déjouer » les attentes spontanées des spectateurs et de mettre en jeu des habitudes, des traditions ou des conventions qui ne sont pas nécessairement perçues en tant que telles. L'innovation peut donc passer inaperçue [56] ou être jugée dérangeante sinon même maladroite [57] !
Si une des caractéristiques des compétences est de pouvoir faire face à des situations inédites, l'on peut alors penser que le cinéma orienté vers une recherche distinctive d'originalité donnera plus facilement l'occasion d'exercer de telles compétences que d'autres médias qui répètent de façon générale dans leurs productions les mêmes dispositifs, les mêmes structures et les mêmes procédés. Si l'on se réfère en outre au critère de la difficulté d'accès aux productions médiatiques (pour ce qu'on a appelé des raisons de complexité interne), on voit que les films offrent par leur diversité un plus grand nombre de situations problématiques que des productions médiatiques basées sur la reprise des mêmes schèmes : la différence est sans doute plus grande entre deux films qu'entre deux journaux télévisés, et le paysage cinématographique apparaît comme beaucoup plus diversifié que d'autres champs ou domaines médiatiques comme la presse ou la télévision. Bien entendu, une telle affirmation n'a pas de valeur absolue et ne permet pas de décider de la pertinence pédagogique de l'une ou l'autre analyse : outre la nature même des objets envisagés (il y a des films inintéressants et des émissions télévisuelles remarquables), d'autres éléments comme les objectifs poursuivis ou le public auquel on s'adresse doivent être pris en considération pour déterminer l'intérêt d'aborder telle ou telle production médiatique.
Parmi les caractéristiques de genre du cinéma, on relèvera un dernier trait, déjà évoqué, à savoir la dimension fictive du plus grand nombre de réalisations filmiques. Ici aussi, il faut rappeler la conception « souple » du genre, défendue ici, puisque de nombreux films considérés comme des documentaires ne relèvent évidemment pas de la fiction. Mais l'on sait aussi que le cinéma, né avec les frères Lumière comme machine d'enregistrement de la réalité, n'a connu son extraordinaire développement que quand il est devenu à partir de Méliès une « usine à rêves ». Aujourd'hui, pour les spectateurs, « aller au cinéma » signifie très généralement voir un film de fiction, alors que la diffusion de documentaires passe désormais par des circuits de diffusion restreints et marginaux.
On a déjà souligné que la fiction constitue un schème d'appréhension qui s'installe sans doute assez tôt chez les enfants de façon intuitive et pratique, mais qui sera ensuite amené à se complexifier et à se nuancer en fonction de la diversité des objets auxquels il devra s'appliquer (notamment des objets « mixtes » comme les fictions réalistes, les docu-fictions, les « biopic », etc.). On a également relevé que la fiction ne se définit pas par un seul critère (comme la stratégie pragmatique de feintise mise en évidence par Grice) et s'appuie par ailleurs sur des indices « textuels » plus ou moins probants (l'évitement des regards à la caméra et l'ignorance générale par les personnages de la présence de la caméra), des conventions explicites (« toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé… »), des considérations de vraisemblance générale (« les fantômes n'existent pas », « un tel comportement est caricatural »…) et des connaissances extérieures sur le dispositif cinématographique (le film est le résultat d'un travail de mise en scène de toute une équipe, même s'il n'apparaît pas en tant que tel à l'écran).

Sleepy Hollow de Tim Burton
de quoi avons-nous peur ?
Dans une perspective pédagogique, le statut de fiction au cinéma pose par ailleurs un important problème d'interprétation, à savoir la relation entre la représentation fictive et la réalité (au sens le plus large du terme) représentée : en d'autres mots, quelle est l'éventuelle valeur de vérité de la fiction ? Citizen Kane est un film mis en scène et interprété par Orson Welles, et aucun (?) spectateur ne croit que ce personnage a « réellement » existé, mais nous pensons tous aussi qu'il s'agit là d'une évocation du magnat de la presse William Hearst, même si le portrait dressé par le cinéaste comporte une part d'invention. Mais l'on comprend aussi que cette évocation est indirecte et que le rapport éventuel à la « réalité » doit être largement (re)construit par les spectateurs en fonction notamment de leurs connaissances préalables du monde : ainsi, l'on peut estimer de façon très diverse qu'il s'agit là d'un portrait historique de Hearst, ou de façon plus large d'un magnat de la presse ou encore d'un capitaine d'industrie capitaliste, ou bien au contraire que la référence à ces différentes figures n'est qu'un leurre pour masquer un enfant qui n'a pas réussi à grandir… La fiction impose donc toujours une médiation dans l'interprétation des films, même les plus réalistes, et l'on peut par exemple se demander en regardant Elephant de Gus Van Sant (2003), une évocation de la tuerie au lycée de Columbine survenue en 1999, si les meurtriers mis en scène dans ce film ressemblent effectivement aux auteurs de ce massacre ou si le cinéaste a accentué (par exemple) leur banalité apparente. À l'inverse, les films les plus manifestement fictifs interrogent aussi, même si c'est de façon visiblement détournée, notre rapport à la réalité : si nous aimons les contes de fées, est-ce pour nous consoler d'une réalité trop médiocre, et, si nous frissonnons devant des monstres terrifiants venus de l'espace, serait-ce pour échapper à nos propres peurs nées du monde où nous vivons ?
La question de la vérité de la fiction entraîne dès lors deux grands types de réponses opposées : la première, qui se veut « critique », considère la fiction comme intrinsèquement mensongère ou illusoire et met en œuvre de multiples stratégies de soupçon, dénonçant entre autres les partis pris inavoués de l'auteur, la représentation biaisée ou faussée de la réalité, l'occultation de faits dérangeants ou contradictoires au propos du film ; la seconde en revanche prétend que le « détour » de la fiction n'est pas un obstacle à sa vérité et même qu'il permet un accès à une vérité plus haute, plus essentielle ou plus authentique (parce que débarrassée précisément d'une soumission à des faits de détail). Dans le cas du cinéma, cette position s'appuie notamment sur le fait que la caméra étant une machine d'enregistrement sans intervention humaine capte nécessairement (une part de) la réalité, même si celle-ci est mêlée de mise en scène et d'artifice : la vérité peut être par exemple celle d'un acteur mis en situation de réagir de façon non préméditée à une situation imprévue [58] ou celle plus générale d'une réalité — personnages et décors — qu'un dispositif cinématographique volontairement minimaliste veut débarrasser de toute interprétation préalable, de toute signification extérieure, en privilégiant l'ambiguïté, l'attente, la contemplation, l'opacité d'un réel épuré [59].
Entre le tout et le rien, entre l'adhésion immédiate et le scepticisme généralisé [60], l'éducation au cinéma doit sans doute viser à donner aux spectateurs les moyens de prendre une mesure plus exacte, plus nuancée, plus complexe et peut-être plus incertaine [61] de l'éventuelle valeur de vérité des différents films envisagés. Cette vérité peut être de nature psychologique, sociale, historique, politique, éthique ou simplement humaine, mais elle n'est jamais donnée en tant que telle ni saisissable immédiatement. Les spectateurs devront en effet d'abord prendre conscience que leur connaissance de la réalité n'est pas immédiate mais s'est construite, pour une très large part, à travers de multiples représentations médiatiques (au sens le plus large du terme) : c'est évident pour tous les faits historiques que nous n'avons pas vécus directement, mais également pour les réalités étrangères (nous connaissons « l'Amérique » même si nous n'y avons jamais mis les pieds) ou au contraire plus ou moins proches (nous avons l'impression de savoir ce que sont les « banlieues », même si nous n'y vivons pas nous-mêmes). Juger de la « vérité » d'un film (ou au contraire de sa fausseté) ne consiste donc pas à confronter une représentation cinématographique à la « réalité » (qui nous échappe pour une très grande part), mais à comparer entre elles de multiples représentations plus ou moins fiables de la réalité. Et cette comparaison ne jouera pas nécessairement en défaveur du cinéma de fiction : souvent, l'on pourra estimer que celui-ci est plus « juste », plus « authentique », plus « sincère » que d'autres représentations médiatiques, par exemple télévisuelles.
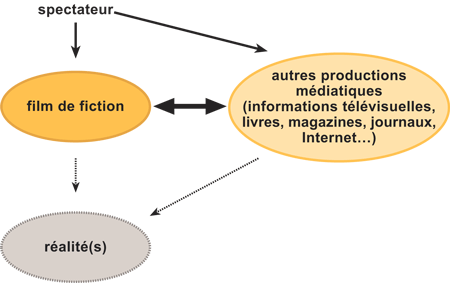
Mais une telle comparaison implique la maîtrise de multiples savoirs et leur mobilisation adéquate face à cet objet nouveau que représente chaque film.
Si ces réflexions sont exactes, il serait sans doute maladroit de vouloir ramener l'éducation au cinéma à une éducation aux médias globalisante en supposant que toutes les productions médiatiques impliquent les mêmes compétences. Les genres médiatiques (tels qu'entendus ici) demandent des modes de réception différents, des approches qui tiennent compte de leur spécificité relative et une capacité générale à « moduler » l'analyse, la « lecture » [62] et l'interprétation en fonction de la diversité des productions médiatiques. On a vu aussi combien cette « modulation » doit être nuancée et plurielle, les différents genres n'étant pas des catégories étanches et se recouvrant de façon complexe. Si l'on doit considérer le cinéma comme un « genre » relativement circonscrit et bien défini, c'est en fonction de certaines caractéristiques importantes comme le recours aux multiples formes de fiction, la complexité de l'organisation « textuelle » du film ou encore le rôle implicite mais essentiel de son « auteur », bien que certaines de ces caractéristiques puissent se retrouver dans d'autres productions médiatiques. Mais la reconnaissance de ces caractéristiques significatives ne constitue encore qu'une première étape dans un processus de réception qui implique la mise en œuvre de compétences fines et multiples, variables selon les films.
Comprendre le cinéma comme un « genre » ne signifie pas, on le voit bien, enfermer l'ensemble de ses productions dans une catégorie toute faite mais implique au contraire une démarche active pour déterminer leur spécificité sinon leur originalité : les caractéristiques que nous avons commentées ici ne représentent donc pas une quelconque « essence » du cinéma, et l'abord de certains films peut nécessiter de prendre en compte d'autres caractéristiques pour l'instant négligées. Une telle approche générique, qui nécessite en particulier la mobilisation de multiples savoirs, doit donc être comprise comme l'exercice d'une compétence toujours en construction, ouverte en particulier sur le devenir du cinéma.
1. Voici le texte original : « This fact merely underlines the point that "the medium is the message" because it is the medium that shapes and controls the scale and form of human association and action. The content or uses of such media are as diverse as they are ineffectual in shaping the form of human association. Indeed, it is only too typical that the "content" of any medium blinds us to the character of the medium. » (Marshall McLuhan, Understanding Media: The Extensions of Man, 1964). Il existe une tendance « radicale » dans l'analyse des médias, plus ou moins présente chez McLuhan, qui consiste effectivement à dénier toute importance ou toute efficace au « contenu » ou au « message » qui disparaîtraient dans un univers médiatique devenu auto-référentiel : on se souvient par exemple de l'affirmation du philosophe Jean Baudrillard selon laquelle « la guerre du Golfe n'a pas eu lieu », signifiant sans doute par là que la réalité a été masquée par les « simulacres » des médias qui prétendaient pourtant en rendre compte. Ce soupçon généralisé (que d'aucuns perçoivent cependant comme un scepticisme cynique) ne constitue qu'une tendance dans l'étude des médias.
2. Le philosophe canadien affirme ainsi que « les bas résille sont beaucoup plus sensuels que les bas nylon parce que l'œil doit agir comme la main pour remplir les vides et compléter l'image, exactement comme devant la mosaïque de l'image de télévision. » (Pour comprendre les médias, Paris, Seuil (Points), 1977, p. 48, traduction revue du texte original : « The open-mesh silk stocking is far more sensuous than the smooth nylon, just because the eye must act as hand in filling in and completing the image, exactly as in the mosaic of the TV image »).
3. L'idée n'est pas du tout absurde, car l'imprimerie a évidemment facilité la multiplication des pamphlets, libelles et autres écrits de propagande ainsi que l'esprit guerrier qui les accompagnait. Mais l'analyse doit prendre en compte bien d'autres facteurs pour rendre compte des guerres de religion. Par comparaison, le travail d'un historien comme Guy Bechtel, qui analyse le rôle de l'imprimerie dans la diffusion au 16e siècle d'un portrait type de la sorcière chez les juges et les lettrés, permettant la mise en œuvre et la multiplication standardisée des procès de sorcellerie (La Sorcière et l'Occident. La destruction de la sorcellerie en Europe des origines aux grands bûchers, Paris, Plon, 1997), met en évidence l'influence de bien d'autres facteurs (comme l'inquiétude religieuse de l'époque) dans cette chasse aux sorcières qui dura plus d'un siècle. Cet exemple montre d'une part que l'historien est tout à fait apte à prendre en compte le rôle d'un média comme l'imprimerie, et d'autre part que l'analyse « purement » médiatique ne peut quant à elle déterminer seule les effets réels d'un média (ou d'un nouveau média) sans tenir compte d'autres facteurs de type sociologique, historique, psychologique ou autre.
4. On peut notamment se reporter à l'ouvrage d'Umberto Eco, La Guerre du faux, Paris, Grasset, 1985.
5. Cf. par exemple Norbert Elias et Eric Dunning, Sport et civilisation, la violence maîtrisée, Paris, Fayard, 1994, ou Paul Yonnet, Systèmes des sports, Paris, Gallimard, 1998.
6. Les émotions sont depuis le début des années 2000 un sujet fort étudié en psychologie (on pourrait même parler de mode), mais ces recherches (souvent ardues) sont largement ignorées dans l'analyse des médias, qui a toujours recours à des schèmes d'interprétation psychologique qui sont ceux du sens commun.
7. Voir par exemple le dossier pédagogique réalisé par les Grignoux sur le film de Jean-Paul Rappeneau.
8. On sait par exemple que la consommation mais également la production de musique (par exemple le rap avec le recours aux sampleurs) ont été profondément modifiées par les nouvelles technologies et les nouveaux médias. Il reste que, sans connaissances musicales, il est bien difficile de faire une analyse approfondie de ces mutations en se limitant uniquement à leurs dimensions médiatiques.
9. Alain Bergala est un des premiers à avancer cet argument (qui peut pourtant sembler ancien) dans son ouvrage L'hypothèse cinéma : Petit traité de transmission du cinéma à l'école et ailleurs publié en 2002 dans la Petite Bibliothèque des Cahiers du Cinéma. La thèse a ensuite été largement reprise par les responsables des différents dispositifs d'éducation au cinéma en France.
10. En ce domaine prévaut actuellement un assez large éclectisme qui masque des différends souvent profonds. Mais il suffit d'aborder des productions comme celles des « arts premiers » (anciennement primitifs…) ou encore « l'art brut », « l'art naïf » ou « l'art différencié » pour faire apparaître des fractures et des rejets.
11. Cf. les remarques que nous avons déjà faites ailleurs sur le « cinéma comme art ».
12. Dans notre culture, l'art est implicitement valorisé : dès lors, définir le cinéma comme art suppose que l'analyse vise d'abord à démontrer le caractère artistique de son objet, c'est-à-dire la « valeur » proprement esthétique du film abordé. Mais, si l'on considère que l'art est une réalité sociale, historiquement construite, il faut respecter un principe de neutralité axiologique et suspendre (au moins temporairement) de tels jugements de valeur au profit de l'analyse factuelle d'une telle conception ; dans cette perspective, l'objectif de l'éducation au cinéma ne serait pas d'abord de montrer ou de démontrer la « qualité » artistique (ou autre) du film abordé, mais plutôt d'amener les participants (et dans certains cas l'éducateur lui-même) à adopter une distance réflexive par rapport à leurs jugements spontanés (notamment en prenant conscience de la diversité des opinions que peut susciter le même film) et à procéder à une analyse aussi objective que possible, ce qui implique notamment de prendre en considération des aspects qui auront pu être négligés lors d'une première vision. Concrètement, on doit déconseiller à tout éducateur de se présenter en « défenseur » d'un film auprès du public, car les relations complexes entre enseignant et enseignés (ou éducateur et « éduqués ») ne manqueront pas de « polluer » la relation au film (un élève va par exemple « détester » un film parce qu'il n'aime pas le professeur qui le lui a fait voir). En revanche, l'éducateur peut exposer les arguments des défenseurs du film en cause (et notamment mettre en évidence des aspects qui ont pu être négligés par certains spectateurs) tout en laissant à chacun sa liberté d'appréciation finale. (Une position particulièrement intenable consiste à vouloir démontrer à des spectateurs enthousiastes — jeunes ou moins jeunes — que le film qu'ils admirent serait un « mauvais » film, « bassement commercial », « stupide », « facile » ou construit avec des « ficelles éculées » : les spectateurs ont toujours de « bonnes raisons » pour apprécier (ou détester) un film, qui ne sont pas celles de l'enseignant ou de l'éducateur, et qu'on ne peut pas « réduire » ou modifier par une argumentation « logique » ; il faut d'abord permettre une explicitation de ces « raisons » cachées, souvent diverses et peu évidentes, avant d'en discuter l'éventuelle pertinence.)
13. Les défenseurs du cinéma comme art sont généralement obligés de minimiser les différences entre les genres cinématographiques — notamment entre documentaire et fiction, ou entre cinéma d'animation et cinéma à prises de vue « réelles » — et de surestimer celles entre le cinéma (réputé artistique) et les autres productions audiovisuelles, notamment télévisuelles (« non artistiques »). On voit cependant facilement que la dimension artistique d'un film d'animation est très éloignée de celle d'un documentaire et s'analyse surtout dans de tout autres termes. Par ailleurs, il y a d'évidentes continuités entre les films d'animation sur « grand écran » et ceux réalisés spécifiquement pour la télévision. S'il ne faut sans doute pas tout mélanger dans un grand « bain médiatique », il est également nécessaire de penser de façon plus fine les continuités et les différences entre les productions et les genres de médias.
14. Cf. Michel Condé, « Note sur la poésie française au XVIIIe siècle », Études françaises, vol. 27-1, 1991, p. 25-47.
15. On trouvera dans le dossier réalisé par les Grignoux et consacré au film La Régate de Bernard Bellefroid une première réflexion sur la notion de compétences ainsi qu'une tentative de définition de ce que pourrait être une compétence en analyse filmique.
16. Cf. les travaux de Jean Piaget notamment sur La Construction du réel chez l'enfant, Paris, Delachaux et Niestlé, 1937.
17. On peut songer à la typologie textuelle de Jean-Michel Adam qui distingue quelques grands prototypes de séquences — narrative, descriptive, explicative, argumentative et dialogale — tout en précisant qu'aucun texte, de par sa complexité, ne se ramène à un seul prototype. Cette tendance formaliste a encore été plus accentuée à l'époque structuraliste où l'on cru pouvoir définir de façon formelle un « genre fantastique » (par Tzvetan Todorov, Introduction à la littérature fantastique, Paris, Seuil, 1970) ou une « fonction poétique » (Roman Jakobson, « Linguistique et poétique », dans Essais de linguistique générale, Paris, Éditions de Minuit, 1963).
18. Cf. Françoise Cordier, Les Représentations cognitives privilégiées. Lille, Presses universitaires, 1993.
19. On a trouvé dans des recommandations officielles aux professeurs de français de la Communauté française de Belgique un exemple d'activité censée mettre en jeu des compétences communicationnelles (« l'écriture informative ») consistant à demander à des élèves de consulter une farde de documents écrits traitant du « réalisme au cinéma », puis d'en faire un résumé de 400 mots environ, « exposant les grandes caractéristiques de la tendance réaliste au cinéma, en illustrant chaque caractéristique par un exemple et en diversifiant les exemples », sans oublier de « faire figurer dans l'article une des photos trouvées à la fin du dossier »… À aucun endroit, il n'est dit que la première chose à faire est de voir quelques-uns des films évoqués ! Faut-il souligner l'absurdité de la consigne et l'artificialité de la démarche (censée pourtant être une « tâche complexe » dans un contexte « écologiquement » pertinent) ? Faut-il répondre que la seule démarche de communication pertinente serait effectivement ici de passer aux interlocuteurs visés par cette « situation de communication » un film de Ken Loach ou des frères Dardenne ? Et s'il reste quelques minutes après la projection de faire un court exposé en se basant sur les caractéristiques du film vu…
Dans un autre domaine, on a vu beaucoup d'études sur la représentation de la Shoah au cinéma, destinées aux élèves de l'enseignement secondaire, qui évoquent une multitude de films — Nuit et Brouillard de Resnais, Shoah de Claude Lanzmann, La Liste de Schindler de Steven Spielberg, Kapo de Gilles Pontecorvo, la série télévisuelle Holocauste, et bien d'autres — que la plupart des jeunes spectateurs n'ont pas vus. Ces comparaisons savantes (même accompagnées de la vision de l'un ou l'autre extrait) sont évidemment d'une faible pertinence pour des adolescents, et l'on ne peut que recommander aux enseignants de voir plutôt avec leurs élèves l'un ou l'autre de ces films en entier avant d'entamer une réflexion plus approfondie sur « la représentation » de la réalité au cinéma…
20. Une compétence désigne la capacité à mettre en œuvre différents savoirs dans des situations variées. En tant que telle, la compétence (ou l'absence de compétence…) ne peut s'observer que face à une « tâche complexe » exigeant pour être résolue la mobilisation de multiples savoirs. La notion reste néanmoins fort floue : ainsi, la plupart des « défenseurs » des compétences estiment que comprendre un texte n'est pas une compétence mais un « simple » exercice : il faudrait par exemple rechercher de l'information dans plusieurs textes pour qu'on puisse parler de compétence. Contrairement aux apparences cependant, la compréhension d'un texte (complexe) suppose la mobilisation de multiples savoirs, linguistiques, grammaticaux, ainsi que des capacités à établir les relations anaphoriques ainsi que des références contextuelles (notamment à des éléments extérieurs au texte) sans oublier une appréciation stylistique qui implique très généralement une comparaison avec d'autres textes du même genre. Si lire un texte de trois lignes peut sans doute être considéré comme un simple exercice, on voit bien qu'apprécier un poème de Baudelaire ou comprendre un traité de Spinoza suppose une véritable compétence…
21. Nous suivons ici les conceptions d'Oswald Ducrot et de François Rastier qui distinguent la signification d'un texte, constituée des relations internes au texte (qui unissent par exemple le sujet et le verbe ou que constituent les relations anaphoriques entre phrases), du sens résultant des relations entre ce texte et le contexte culturel (compris de façon très large). Ainsi, un mythe antique a la même signification (« les douze travaux d'Hercule ») hier et aujourd'hui, mais n'a sans doute pas le même sens pour un Grec ancien (pour qui il s'agissait d'une croyance religieuse) et pour nos contemporains (qui considèrent qu'il s'agit d'une fable ou d'une histoire inventée). Et de façon caricaturale, on peut dire qu'un urinoir garde toujours la même signification (un endroit pour uriner) mais pas le même sens s'il se trouve dans les toilettes d'un lieu public ou s'il est exposé dans un musée… (On n'entrera pas ici dans les querelles entre tenants de la sémantique ou de la pragmatique, ces derniers considérant plutôt que le sens du discours relève d'une théorie plus générale des actes du langage : on parle pour informer mais aussi pour influencer l'interlocuteur, pour lui donner des ordres ou des conseils, etc.)
22. L'on suit ici l'analyse de la fiction par Paul Grice comme un discours qui feint d'affirmer certaines choses — par exemple l'existence de Madame Bovary — mais sans s'engager sérieusement quant à la véracité de ses affirmations — personne ne recherchera dans les registres d'état civil cette supposée Madame Bovary —. La fiction repose donc sur une convention partagée avec le lecteur ou récepteur et qui implique essentiellement une suspension temporaire des règles de la conversation courante (comme « Que votre contribution soit véridique » et « N'affirmez pas ce que vous croyez être faux »). (Paul Grice, « Logique et conversation », dans Communications, n° 30, 1979, p. 53 et s.)
23. Un compte-rendu de ce canular peut être consulté sur le site Wikipedia. Il méconnaît cependant très largement tout le contexte politique — et plus précisément les mœurs politiques d'une démocratie parlementaire comme la Belgique — qui rendait totalement invraisemblable une telle déclaration d'indépendance de la Flandre. C'est cette méconnaissance qui a permis à un tel canular de « fonctionner » aux yeux de nombreux citoyens.
24. Si l'indépendance de la Flandre est tout à fait possible à moyen ou à long terme, la rupture de continuité sans raison majeure était irréaliste dans le chef de politiciens majoritairement habitués à la négociation institutionnelle. L'indépendance de la Flandre ne peut pas s'imaginer par exemple sans envisager son appartenance à la Communauté Européenne, ce qui suppose évidemment une négociation préalable avec les institutions européennes.
25. La familiarité avec les canulars (par exemple les traditionnels poissons d'avril dans la presse) facilitait également le soupçon.
26. Les guillemets se justifient dans la mesure où la réalité (distincte de sa représentation) est une construction et non pas un simple donné : les rêves, les images, la fiction, les représentations ont également une certaine « réalité » même si elle n'est pas de la même « nature » que celle des objets environnants. Cette différence se construit progressivement et connaît de grandes variations historiques et sociales.
27. Cf. l'analyse de Paul Grice, op.cit. On suivra ici les thèses « pragmatiques », mais il faut néanmoins relever que le net partage entre la vérité et la fiction est aussi le résultat d'un processus historique où la « vérité » est devenue progressivement le fait de différentes spécialités (sciences, histoire, philosophie…) qui ont déterminé de façon beaucoup plus stricte ce qu'est la « réalité » : au 16e ou au 17e siècle encore en Occident, on admettait couramment des interventions divines ou diaboliques dans le monde quotidien (comme en témoignent entre autres les chasses aux sorcières) ; et dans nombre de sociétés (mais aussi dans certains groupes marginaux dans les sociétés occidentales modernes), il n'y a pas de frontière étanche entre d'une part la « réalité » et d'autre part le « surnaturel », le « merveilleux », l'extraordinaire, le monstrueux… Et l'on n'oubliera pas que nous faisons croire pendant une période plus ou moins longue aux enfants que le Père Noël (ou Saint Nicolas selon les régions) va leur apporter des cadeaux s'ils sont bien sages… (Sur cette question, on peut se reporter aux réflexions éclairantes de Paul Veyne dans Les Grecs ont-ils cru à leurs mythes ? Paris, Seuil, 1983, et de Marcel Detienne dans L'Invention de la mythologie, Paris, Gallimard, 1981.)
28. Mais il existe au moins un film qui se présente à la fois comme un dessin animé et comme un documentaire : Valse avec Bashir d'Ari Folman (2008).
29. Ces trois derniers indices ont été relevés par Käte Hamburger dans Logique des genres littéraires (Paris, Seuil, 1986, éd. or. 1977). La citation littéraire est tirée d'un roman d'Alice Berend, Die Bräutigame der Babette Bomberling (1915) et a été faite originellement par Käte Hamburger dans son ouvrage. Les thèses de Käte Hamburger ont été discutées et critiquées notamment par les tenants d'une approche pragmatique. Son erreur est sans doute d'avoir transformé des indices de « fictionnalité » en critères supposés décisifs. Les traits qu'elle cite sont néanmoins pertinents et permettent au lecteur de percevoir ou de confirmer le caractère « romanesque » (c'est-à-dire fictionnel) du texte qu'il lit, même si certains d'entre eux — comme le discours indirect libre — ont par exemple pu être repris occasionnellement par l'écriture journalistique.
30. Aux débuts du cinéma, on relève néanmoins la tendance inverse, certains personnages adressant des regards et des signes de complicité à la caméra (et donc au spectateur) à l'écart des autres personnages, cette stratégie pouvant s'interpréter comme un décalque de l'aparté au théâtre où un personnage énonce à voix haute à destination du public une réflexion qu'il aurait « en réalité » toute raison de garder muette. Ceci confirme l'interprétation de type pragmatique de la fiction (comme celle de Grice) : il n'y a pas de signes propres au discours fictionnel, mais seulement une convention plus ou moins partagée entre auteur et spectateurs. On se souviendra également du Blair Witch Project de Daniel Myrick et Eduardo Sánchez (USA, 1999), une fiction qui affichait tous les signes d'un tournage en vidéo amateur : il n'y avait pas de signes « internes » désignant la fiction (des rumeurs alimentées sur Internet par une stratégie marketing ont même laissé croire pendant un moment qu'il s'agissait d'un authentique documentaire), et seules des connaissances externes (notamment des codes du cinéma d'horreur) permettaient aux spectateurs de recevoir ce film comme une fiction.
31. On rappellera à ce propos, à la suite de Richard Hoggart (La Culture du pauvre, Paris, Minuit, 1970, éd. or. The Uses of Literacy, 1957) que « le public constitué par [les] classes populaires est rarement dupe des fictions cinématographiques ou romanesques qu'il a élues, contrairement à ce qu'a longtemps avancé l'intelligentsia bourgeoise. Les expressions directement issues de la sémantique populaire comme "arrête ton cinéma" ou "se faire un cinéma" illustrent bien, dans leur usage le distinguo entre réalité et fiction que sont capables d'avancer ces groupes démunis des instruments culturels de l'assurance et de la certitude de soi, mais à qui, malgré tout, "on ne la raconte pas". » (Emmanuel Ethis, Sociologie du cinéma et de ses publics, Paris, Armand Colin, 2009, p. 13-14).
32. Cf. notamment la discussion dans Laurent Jullier, Qu'est-ce qu'un bon film ? Paris, La Dispute, 2002, p.122-127.
33. Cette prétention est celle notamment des romanciers réalistes depuis Balzac (à travers maintes préfaces), mais elle est plus affirmée que démontrée, car les voies par lesquelles la fiction réaliste donnerait accès à la réalité restent cachées. Dans les faits, c'est le lecteur ou spectateur qui aura la charge (parfois impossible à assumer) d'établir les relations entre cette fiction et ce qu'il pense être la réalité.
34. Il s'agit de réactions effectivement constatées lors de débats ayant suivi la projection de La Régate de Bernard Bellefroid (Belgique, 2010) et de La Permission de minuit de Delphine Gleize (France, 2011).
35. Bien entendu, l'amateur de vins peut lui aussi partir à la découverte de nouveaux crus…
36. Les enfants qui regardent un grand nombre de fois le même film ou qui demandent qu'on leur raconte pour la dixième fois la même histoire semblent échapper à ce « principe » de la nouveauté qui n'est peut-être pas général ni universel : il est possible en effet que la recherche continuelle de l'inédit soit en partie un effet de la « société de consommation » dans laquelle nous vivons, consommation sans fin qui s'applique également aux biens culturels. Mais la répétition demandée par les jeunes enfants peut également s'expliquer dans le cadre de la théorie du jeu de Piaget. Pour le psychologue genevois, le jeu s'explique par un exercice de schèmes (sensori-moteurs ou cognitifs) indépendamment de tout objectif pratique ou utilitaire (c'est ce qu'il appelle une assimilation sans accommodation) : ainsi, on peut renvoyer indéfiniment une balle contre un mur pour le simple plaisir de l'exercice et de la maîtrise de cette habileté. De la même façon, on peut penser que l'enfant répète la même expérience — regarder un dessin animé, écouter un conte… — essentiellement pour en acquérir une meilleure maîtrise cognitive mais aussi affective : la fiction déclenche en effet des émotions qui sont souvent désagréables — peur, angoisse, tristesse… — et que l'enfant va apprendre à « gérer » très progressivement grâce à la répétition. Mais une fois cette maîtrise acquise, la lassitude s'installe, et l'enfant, l'adolescent ou l'adulte part à la recherche de nouveaux « jeux » qui lui permettront d'exercer ses schèmes cognitifs et/ou affectifs. Dans cette perspective, on peut même penser que la recherche d'originalité (qui n'est jamais absolue) fait partie d'un schème qui s'installe progressivement et que nous « exerçons » pour notre plus grand plaisir : nous aimons être étonnés, nous aimons découvrir de nouvelles histoires, de nouveaux films, de nouveaux paysages, mais la nouveauté apparente masque sans doute la répétition des mêmes schèmes devenus extrêmement souples, complexes et susceptibles d'assimiler un grand nombre d'objets inédits et différents. (Jean Piaget, La Formation du symbole chez l'enfant : imitation, jeu et rêve, image et représentation, Delachaux et Niestlé, 8e éd. 1994.)
37. La conception inverse qui voudrait que les consommateurs soient les victimes plus ou moins inconscientes de la manipulation médiatique (et en particulier de la publicité) ne parvient pas à expliquer le succès inattendu de certaines réalisations — on peut penser à des films comme Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, Les Choristes ou même Bienvenue chez les Ch'tis mais aussi à des « genres » entiers comme le jazz ou le rap en musique, ou encore la bande dessinée, au début largement méprisée — ou de nouveaux médias — les téléphones portables, les jeux vidéos, Internet … — alors que d'autres « objets », productions, réalisations ou dispositifs bénéficiant d'une promotion équivalente ou même supérieure n'ont pas rencontré les faveurs du public (ou ont même connu des échecs retentissants comme l'émission de télé-réalité « Carré ViiiP » de la chaîne française TF1, interrompue après seulement deux semaines de diffusion à cause de son manque de succès en mars 2011). Il faut donc prendre en compte une demande latente, a priori largement indéfinie (bien qu'il soit toujours facile de l'interpréter a posteriori comme le font les critiques « prophètes après l'événement »). On remarquera que la théorie du complot médiatique — par exemple concernant les attentats du 11 septembre 2001 — est elle-même un succès médiatique, ce qui prouve bien que le « public » est loin d'être une masse homogène et passive, manipulée à volonté par les « puissants » de ce monde et qu'il peut rejeter (du moins certaines franges), parfois de façon hypercritique, les représentations médiatiques qui lui sont proposées.
Une autre approche théorique, illustrée essentiellement par les travaux de Pierre Bourdieu (La Distinction, Paris, Minuit, 1979) ou, de façon plus nuancée, par Bernard Lahire (La Culture des individus, Paris, La Découverte, 2004) met l'accent sur le rôle des instances de légitimation (essentiellement l'école mais aussi la critique, les institutions culturelles étatiques ou para-étatiques, les académies, les prix et jurys de toutes sortes…). Sans nier le rôle de ces instances, il serait sans doute faux de concevoir leur rôle de façon centralisée (en particulier sur le modèle étatique français ou comme un Appareil Idéologique d'État selon l'expression de Louis Althusser) : leur influence est relativement faible dans de nombreux domaines comme les jeux vidéos, la bande dessinée, la consommation de musiques ou aujourd'hui le réseau Internet. On voit d'ailleurs comment dans ces nouveaux domaines, certains spectateurs ou consommateurs, souvent passionnés, se transforment en prescripteurs d'opinion, comme ce fut le cas avec les « fanzines » pour la bande dessinée (dans les années 1970 et 80) ou les forums Internet pour les jeux vidéos aujourd'hui.
Sans entrer dans des querelles théoriques qui ne sont pas notre objet, on dira simplement que les principes d'évaluation dans les champs culturels et/ou médiatiques résultent vraisemblablement d'une interaction entre ces trois pôles : les producteurs (ou émetteurs), le public (ou récepteurs) et les instances de légitimation (partiellement liées aux deux autres pôles).
38. Bernard Lahire parle ainsi d'un « homme pluriel » qui fréquente de multiples sphères de socialisation et dont le comportement n'est donc plus déterminé par un seul principe (ou même par un principe dominant) : il serait porteur d'une « pluralité de dispositions, de façons de voir, de sentir et d'agir » (Bernard Lahire, L'Homme pluriel, Paris, Nathan, 1998). Cette conception est certainement partagée par beaucoup de sociologues contemporains.
39. La « loi du plus grand nombre », souvent dénoncée comme une forme d'abêtissement moutonnier, doit être relativisée. Le succès est toujours temporaire, et le public toujours avide de nouveauté (même si cette nouveauté peut être très relative), mais les réussites spectaculaires masquent également les déclins lents ou rapides. Et l'on n'oubliera pas que le succès en termes de ventes, de fréquentation ou de nombre d'entrées ne correspond pas nécessairement avec un degré équivalent de satisfaction (après lecture du roman à succès ou à la sortie de la salle de cinéma…). En outre, la concurrence entre médias, genres et domaines rend plus problématique les grands succès, le public se fragmentant en publics spécialisés ou se dispersant entre les différentes offres. Enfin, tout succès entraîne presque « mécaniquement » une réaction inverse, motivée par un souci de « distinction », qui peut à son tour se transformer en succès de plus ou moins grande ampleur : ainsi, dans un domaine apparemment aussi spécialisé que celui des navigateurs web, le succès initial d'Internet Explorer (dû en grande partie à la position dominante du système d'exploitation Windows) a été progressivement contrebalancé par un logiciel libre, Firefox, dont des passionnés et des spécialistes ont défendu les qualités auprès d'un cercle d'utilisateurs de plus en plus élargi.
40. Sous l'étiquette générale de critique des médias, tendance dont Noam Chomsky est actuellement le représentant le plus célèbre, on trouve essentiellement une critique des médias d'information, en particulier la presse et la télévision, et plus rarement la publicité ou les fictions. Si cette critique se fait essentiellement au nom de la vérité (supposée malmenée ou manipulée par les médias « dominants »), ses motivations sont essentiellement politiques.
41. « Well opinions are like assholes. Everybody has one. »
42. C'est l'un des objectifs que l'on a essayé de définir dans l'étude déjà évoquée « Analyse de films et compétences scolaires », publiée en première partie du dossier réalisé par les Grignoux et consacré au film La Régate de Bernard Bellefroid.
43. C'est un des facteurs qui expliquent la faiblesse culturelle des pays européens face aux États-Unis. Ceux-ci disposent d'un marché économiquement et linguistiquement unifié (même si la population hispanophone est en augmentation) qui permet aux producteurs médiatiques (par exemple en cinéma et en télévision) de rentabiliser facilement leurs réalisations grâce à un public potentiel de 300 millions de consommateurs. En revanche, les pays européens présentent des marchés culturels très segmentés, et les différents producteurs essaient d'abord de pénétrer leur marché national, beaucoup plus restreint. Il leur est ensuite difficile, contrairement aux producteurs américains dont les réalisations ont été rentabilisées sur le marché des États-Unis, de faire face aux coûts (financiers et humains) d'adaptation et de traduction en direction des autres marchés européens. Bien entendu, la domination médiatique des États-Unis s'est établie progressivement par accumulation régulière et grâce à des investissements croissants (notamment en termes de réalisateurs, producteurs, techniciens, etc.).
44. Le second niveau, celui des significations conventionnelles partagées par une même société peut également poser d'importants problèmes d'interprétation lorsque l'observateur est éloigné temporellement ou spatialement de la société des « émetteurs » ou réalisateurs : c'est le cas par exemple de l'art pariétal où l'on reconnaît notamment les figures d'animaux mais dont la signification générale nous échappe (fonction religieuse, magique, esthétique, sociale… ?) ; c'est le cas aussi de certains gestes dans la peinture du Moyen Âge ou de la Renaissance qui peuvent nous paraître anodins ou étranges mais qui avaient (sans doute ?) une signification conventionnelle reconnue par les contemporains (cf. par exemple E. H. Gombrich, « Le geste et l'expression rituels dans l'art », dans Huxley (Julian) [sous la direction de], Le Comportement rituel chez l'homme et l'animal, Paris, Gallimard, 1971).
45. On est proche ici de la notion de « jeux de langage » exposée par Ludwig Wittgenstein dans ses Investigations philosophiques : il s'agit là de pratiques sémiotiques, déterminées par un ensemble de règles qui doivent être maîtrisées intuitivement par les participants au « jeu » mais qui sont extrêmement variables historiquement et socialement. Certaines de ces règles sont rigides (comme les règles de grammaire ou du jeu d'échecs) mais d'autres sont beaucoup plus floues et malléables, et le même objet peut relever de multiples jeux de langage, plus ou moins hétérogènes (un film peut être vu comme une réalisation cinématographique, mais aussi comme une histoire fantastique, une performance d'acteur et une fable philosophique, ce qui constituent autant de jeux de langage différents). On remarquera que, même lorsqu'il y a explicitation de certaines règles comme dans le jeu d'échecs, d'autres restent néanmoins implicites, spontanément évidentes : par exemple, le joueur d'échecs cherche à battre son adversaire, mais il n'usera pas de violence physique pour y parvenir…
46. Bien entendu, les conditions de projection dans certaines salles peuvent être médiocres. Mais l'existence de ces « mauvaises » salles s'inscrit bien dans la conception d'un « genre » tel qu'on le conçoit ici, caractérisé par des traits « saillants » mais qui ne se retrouvent pas nécessairement dans tous les « exemplaires ».
47. En France, un décret du ministère de la Culture définit ainsi les salles d'art et essai sur base d'une série de critères précis en ajoutant certains labels plus spécifiques comme la « recherche et découverte » ou le « patrimoine et répertoire » (que n'obtiennent que certaines salles).
48. Ici aussi, il faut bien voir la différence entre l'offre en DVD et le rôle des cinémathèques qui est notamment de conserver et de proposer des réalisations qui ne sont visibles nulle part ailleurs. L'offre en DVD est une offre essentiellement commerciale qui, aussi large soit-elle, se limite aux œuvres les plus connues et privilégie notamment le cinéma américain. Elle ne joue donc pas un rôle de « découvreur » en s'appuyant sur les attentes et les connaissances antérieures des spectateurs (qui ont par exemple entendu parler par d'autres voies de grands classiques comme Citizen Kane ou La Règle du jeu). Une cinémathèque comme un cinéma d'art et essai a en revanche une fonction d'éducation permanente en proposant des films anciens moins connus ou des parcours inédits dans l'histoire du cinéma (avec des accompagnements possibles comme des entretiens ou des conférences).
49. C'est le cas par exemple des journaux télévisés francophones qui étaient déjà constitués d'une suite de reportages mais qui sont à présent souvent coupés en deux ou trois parties plus ou moins hétérogènes (par exemple la partie « actualités » séparée de la partie « magazine »).
50. Les émissions de télé-réalité semblent également jouer sur la mémoire des spectateurs puisque ceux-ci apprennent à connaître progressivement les différents « acteurs », mais cette mémoire est essentiellement intuitive, reposant sur la familiarité progressive avec les personnages : il ne s'agit pas de comprendre une intrigue ni de percevoir des motifs cachés ni de se souvenir d'épisodes éloignés, mais simplement d'éprouver une sympathie (ou une antipathie) croissante pour des individus dont « l'histoire » est secondaire sinon sans intérêt.
51. Ce film peut être interprété de différentes façons : Popeye, le policier joué par Gene Hackman, peut être vu comme une figure traditionnelle du flic de terrain dont les intuitions sont toujours justes mais qui est confronté aux lourdeurs du système judiciaire ; mais une lecture plus nuancée perçoit en revanche, notamment lors de la séquence finale, la « folie » du personnage enfermé dans une quête de plus en plus violente et mortifère.
52. Cf. le dossier pédagogique réalisé par les Grignoux et consacré à ce film.
53. Un journal traduit généralement une « ligne » politique ou idéologique qu'on retrouve notamment dans la hiérarchisation de l'information imposée par le rédacteur en chef. Mais celui-ci aura toujours tendance à « s'effacer » devant l'information, devant les « faits », devant aussi les demandes de son lectorat, alors qu'un cinéaste assumera beaucoup plus facilement (dans des interviews par exemple) ses partis pris idéologiques ou esthétiques. On rappellera d'ailleurs que le statut d'auteur ne fut que progressivement reconnu aux cinéastes, et que beaucoup de réalisateurs de l'âge classique hollywoodien se considéraient plutôt comme des artisans soumis avant tout aux exigences des producteurs et indirectement du public visé.
54. On voit bien par exemple la différence entre une approche du cinéma centrée sur les acteurs (notamment dans une presse de type « people ») et une autre privilégiant les cinéastes (démarche privilégiée dans les revues « cinéphiles »), même si ces deux approches ne sont pas exclusives l'une de l'autre.
55. Le simple changement de dessinateur peut ainsi entraîner la désaffection d'une partie des lecteurs, de la même façon que le renouvellement du décor du journal télévisé suscitera de nombreuses réactions négatives de la part de spectateurs dérangés dans leurs habitudes…
56. Les innovations esthétiques d'Orson Welles dans Citizen Kane et La Splendeur des Amberson sont largement passées inaperçues avant qu'André Bazin n'en fasse une analyse approfondie.
57. Ce fut le cas par exemple des faux raccords dans À bout de souffle de Jean-Luc Godard qu'un certain nombre de critiques ont perçus à l'époque comme des maladresses dues à l'amateurisme supposé de leur auteur.
58. Un exemple célèbre d'une telle stratégie s'est présenté lors de la réalisation d'À nos amours (1983) de Maurice Pialat : celui-ci était le réalisateur du film mais il interprétait également un rôle, celui du père de la jeune héroïne qui quitte abruptement le domicile conjugal ; plus tard (dans le film comme dans le tournage), prend place un repas de famille au cours duquel réapparaît de manière inattendue le personnage du père, fait que Pialat n'avait annoncé qu'à son opérateur ; et le père — ou Pialat lui-même — s'en prend alors violemment à l'un des protagonistes, c'est-à-dire à un acteur qui peut à ce moment difficilement distinguer entre son personnage et sa propre personne. On remarquera que le réalisateur s'est lui-même « mis en danger », car, si les autres acteurs ne s'attendaient pas à ce retour, il ne pouvait pas non plus prévoir comment ils réagiraient à cette irruption violente (certains auraient pu par exemple quitter brutalement le champ). Une analyse complète de cette séquence peut être lue dans l'ouvrage d'Alain Philippon, À nos amours de Maurice Pialat, Crisnée, Yellow Now, 1989, p. 25-28.
59. On reconnaît ici la défense du cinéma « moderne » par Jacques Rivette dans sa célèbre « Lettre à Rossellini », cinéma également illustré par des auteurs comme Michelangelo Antonioni, Jean Eustache, Abbas Kiarostami, Jean-Pierre et Luc Dardenne. De manière générale, cette défense consiste à opposer la monstration de la réalité (qu'opérerait ce type de cinéma) à sa signification et son interprétation, telles que l'impose notamment la télévision qui commente toujours abondamment les images qu'elle diffuse. (Sur cette conception du cinéma moderne, on peut notamment se reporter au texte publié par les Grignoux « Comment parler d'un film : le cinéma art du réel »).
60. On constate que l'éducation aux médias, en se voulant « critique », favorise chez un certain nombre de personnes un relativisme et un scepticisme généralisés par rapport à toutes les productions médiatiques, attitude qui débouche facilement sur des « théories du complot » et différentes expressions de « négationnisme » des faits les mieux avérés (et à l'inverse une crédulité à l'égard des thèses « conspirationnistes » de toutes sortes). Dans un tel contexte, on peut se demander si les « éducateurs aux médias » sont bien placés pour déterminer la valeur de vérité des différents contenus médiatiques. D'autres spécialistes notamment en sciences humaines et en histoire sont peut-être mieux outillés pour rendre compte de la manière dont se construisent les savoirs en ces différents domaines, ainsi que des critères utilisés pour juger de leur vérité et des outils nécessaires à leur construction (comme des instruments statistiques, des grilles d'observation psychologique ou sociologique, des techniques de critique historique, que ne maîtrisent sans doute pas les éducateurs aux médias).
61. L'incertitude crée une angoisse, ce qui peut expliquer que beaucoup préfèrent des solutions ou des réponses simples sinon simpliste (tout ou rien, soupçon généralisé ou scepticisme absolu) qui mettent fin à cette angoisse. Or, notre savoir sur le monde, et notamment sur le monde social, aussi vaste soit-il, reste évidemment très partiel et bien souvent incertain. Alors que les éducateurs se trouvent institutionnellement dans la position du « maître supposé savoir », leur rôle consiste peut-être d'abord à faire prendre conscience des limites de ce savoir.
62. Rappelons que nous n'avons envisagé ici que les processus de réception et non ceux d'une éventuelle production ou réalisation.